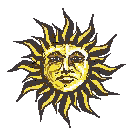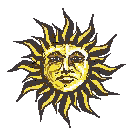Cahier XXIII
Début juillet à Bolgobol
Le 2 juillet
Monts flottant dans le vide
Le début d'été aura été
humide cette année. Il n'a pas beaucoup plu cette nuit, juste
assez pour noyer de brume la vallée de Bolgobol. Par endroits,
on ne distingue plus la silhouette des montagnes de celle des
nuages : monts flottant dans le vide, nuées plantées
au sol.
Le soleil est pourtant très chaud déjà,
dans le haut du ciel presque entièrement dégagé.
Un lambeau de nuage parfois projette son ombre au sol, accompagnée
d'un courant d'air glacé, et l'on se demande s'il restera
assez longtemps pour qu'il vaille la peine de mettre sa veste.
Le 3 juillet
Un générateur de paysages urbains
Le logiciel possède une petite bibliothèque
de cartes de terrain. On peut les modifier et, naturellement, en
créer. Il est aussi possible de les importer d'un programme
tiers, comme celui dont Douha avait été à
l'initiative (voir À Bolgobol cahier
2).
On utilise ensuite des modules d'architectures.
C'est encore une bibliothèque qui possède tout un jeu
de formes architecturales, de la cabane à l'immeuble de grande
hauteur, avec des monuments, des édifices industriels et
d'autres structures complexes. On trouve encore une bibliothèque
de styles d'architecture, qui s'appliquent aux premiers modules. Les
uns comme les autres peuvent aussi être modifiés.
Le logiciel répartira aléatoirement
les édifices sur la carte de terrain. On pourra la découper
en plusieurs territoires auxquels on allouera des pourcentages pour
certains types de constructions, maisons individuelles, grands
immeubles, hangars, etc. On définira un indice de rectitude
des voies, de densité de population, d'équipements
collectifs, et d'autres paramètres.
Comme pour tout modeleur vectoriel en trois
dimensions, on règle les sources lumineuses, la densité
des ombres, la nébulosité...
On est contraint de travailler en aveugle jusqu'au
moment où l'on arrête un angle de vue et où on
lance le rendu. Balayé par une ligne blanche qui la parcourt
de haut en bas, l'image devient lentement plus précise. Les
gros carrés de couleur se divisent jusqu'à une
résolution de soixante-douze points par pouce.
On attend longtemps, quelle que soit la puissance
de la machine. Le programme exige relativement peu de mémoire :
huit mégaoctets. Si on lui en alloue le double, on gagne
encore sensiblement de la vitesse, mais au-delà, le gain
devient de moins en moins sensible, jusqu'à n'être plus
perceptible à partir de soixante-quatre.
Comme il est rare qu'un résultat soit
satisfaisant du premier coup, on peut utiliser une méthode de
rendu plus rapide : distance render. La vue apparaît
alors en niveaux de gris, n'offrant que la silhouette des plans, un
peu comme un paysage dans la brume du petit jour. Cela peut suffire
pour opérer des rectifications.
Pour prendre en main le programme, le mieux est
d'utiliser les bibliothèques toutes prêtes. Les
possibilités sont infinies, de la cité néolithique
à la mégalopole contemporaine. Les villes sont
dépeuplées, aussi vaut-il mieux se contenter de vues
lointaines, sauf à rendre une impression bizarre d'après
apocalypse.
J'ai vite vu qu'un urbanisme complexe sur un
territoire fortement dénivelé était le plus
saisissant. En règle générale, on construit des
usines dans les plaines, ou au creux des vallées dans leurs
parties les plus larges. Il en va ainsi pour le centre des villes.
Même quand elles sont nées sur des éminences
fortifiées, comme il est fréquent dans le sud de la
France, leur centre se déplace vers des zones plus planes
quand elles grandissent.
Il est tentant d'utiliser le programme pour voir
ce que donnerait le contraire : des centres urbains, des hauts
fourneaux, à flanc de montagne, des raffineries, de la
construction navale, dans des calanques, des usines à gaz dans
des cirques rocheux.
Le programme génère des ponts, des
passerelles, de hauts murs de soutènements, des voûtes
de pierre, des arches de béton, des canalisations volantes ou
qui plongent dans le vide, il mêle des minarets à de
hautes cheminées au bord de précipices, le dôme
des cuves de gaz à celui des mosquées.
Le 4 juillet
Les enfants de Bolgobol
Dans le Marmat, on ne se demande pas où
sont les enfants. Ils jouent dans les rues, les parcs et les jardins.
Ils ne risquent rien. La ville est parcourue de
ruelles peu propices à la circulation motorisée, et
beaucoup sont coupées d'escaliers. Les automobilistes roulent
sinon lentement, s'arrêtent volontiers pour laisser traverser
le passant, bien que les signalisations soient rares, et que je n'y
aie jamais vu un agent de circulation. Les piétons seraient en
tout cas bien capables de se faire respecter, comme j'ai pu le
constater à quelques reprises, au besoin menaçant de
façon fort crédible le conducteur dangereux.
Ils agiraient de même envers des enfants qui
s'attarderaient dans de grands axes, ou y circuleraient
dangereusement, et les plus jeunes trouvent toujours une main pour
les faire traverser.
Les enfants courent partout dans les rues et les
parcs de Bolgobol, jouent dans les jardins devant les maisons. Ils
deviennent parfois un peu agaçants, dérangent les
conversations avec leurs cris et leurs gesticulations. Heureusement,
les adultes ont rarement à intervenir pour les calmer. Des
groupes d'adolescents s'en chargent. Ils sont très forts pour
rappeler à leurs cadets les règles élémentaires
de la civilité.
Les filles et les garçons se mélangent
peu. Enfants, ils n'ont pas les mêmes jeux. Adolescents, ils ne
se mêlent plus du tout. À cet âge, ce sont les
filles qui deviennent les plus bruyantes. Contrairement aux garçons
plus remuants, elles parviennent à produire un flot
impressionnant de décibels aigus en restant parfaitement
immobiles. Elles font concours de phrases courtes qui se coupent sur
un ton toujours plus haut, ponctuées d'éclats de rire.
Ignorant le palanzi, je n'ai aucun moyen de deviner ce qui les excite
à ce point. Ce sont toujours des jeunes filles, à peine
plus âgées, qui leur intiment de se calmer.
Le respect de l'âge, ici, n'est pas un vain
mot, et il joue évidemment dans les deux sens. Jamais on ne
met en péril l'autorité d'un plus jeune devant un plus
jeune encore. Si un groupe d'enfants vous dérange,
adressez-vous à celui qui vous semble l'aîné pour
leur demander d'aller jouer ailleurs.
Il est normal que des enfants soient bruyants et
agités. On ne peut pas les enfermer ni les empêcher de
vivre. Ils sont tous d'ailleurs d'une politesse remarquable : on
vous tient la porte, on vous cède le passage, on s'excuse très
civilement si l'on vous a heurté par inadvertance. Bien sûr,
on doit la leur rendre.
Je n'avais jamais remarqué avant d'arriver
ici combien les enfants recherchent le contact avec les adultes, et
les prennent pour modèles. Ils exercent alors sur nous une
influence réciproque, qui nous incite à bien nous tenir
sous leur regard, sans que ni les uns ni les autres aient seulement à
s'en rendre compte.
Le 5 juillet
Inférences de la raison et de
l'imagination
J'ai commencé à prendre en main le
modeleur de paysages urbains. Il est possible de supprimer des
bâtiments à l'unité. Il y a un outil pour cela.
Quand on le sélectionne, le curseur prend la forme... d'une
seringue ?... non, d'un marteau piqueur.
On peut encore ajouter des bâtiments à
l'unité. On va dans le menu Library, on sélectionne
Building et l'on choisit le type de construction qui convient.
Je ne peux m'empêcher de voir une seringue
dans le curseur. J'en ai d'abord été surpris :
pourquoi pas plutôt une pioche, un bâton de dynamite, un
détonateur, à la rigueur une gomme ?
Naturellement, j'ai fait immédiatement l'inférence :
ce ne peut être qu'un marteau piqueur.
L'identification de l'objet, du moins pour moi,
n'est pas immédiate. C'est un défaut de ce qu'on
appelle l'ergonomie cognitive, plus fréquente, hélas,
dans les programmes libres que dans ceux du commerce. Je dois passer
par une inférence. Derrière celle-ci, que dicte la
raison, une autre est chassée, d'une nature différente
— ce que j'appelle inférence de l'imagination :
l'inoculation d'un anesthésiant pour effectuer l'extraction
d'un bâtiment.
Le programme permet d'effectuer des ajustements
plus fins encore : supprimer un étage, avec la touche
contrôle enfoncée, supprimer une fenêtre, une
porte, une colonne... avec les touches contrôle et majuscule ;
et aussi bien en ajouter.
Est-il utile, dans la vue d'une ville entière,
de supprimer une seule fenêtre ? Que oui ! On est
étonné qu'un seul et si petit détail puisse
prendre une telle importance dans un ensemble complexe. Loin de le
noyer, cette complexité le renforce, converge par des
cheminements ténus sur ce seul point.
Une façade dominait les autres, moins par
sa taille ou son originalité, que par sa situation sur une
éminence, la déclivité qu'elle surplombait, son
éclairage. Elle attirait trop l'œil, elle étouffait
l'atmosphère intéressante de son environnement.
Ma première idée fut d'en faire
sauter un étage. L'ensemble du bâtiment perdait alors sa
saillance, et l'image entière, son pittoresque. Il était
bien préférable d'annuler l'opération et de
supprimer des fenêtres, renforçant alors ce qui d'abord
gênait. Plus saillante encore, la façade accentuait
maintenant l'harmonie de celles qui l'environnaient.
Ce curseur dans lequel je ne peux m'empêcher
de voir une seringue, crée une relation floue entre dents et
constructions, et force dans mon esprit une métaphore entre
l'architecture urbaine et la parole. Bien souvent, il m'arrive aussi
de corriger la construction de mes phrases en renforçant ce
qui d'abord heurtait la lecture.
Il y aurait là peut-être une règle
à découvrir, dont le modeleur de paysage urbain m'offre
comme une image, peut-être un modèle. Ce que je ne
perçois pas alors, c'est à quoi ressemblerait une telle
règle pour les langages de la logique et des mathématiques.
Le 6 juillet
Le koan du bouddha qui attendait le Bouddha
Un voisin de Kouka m'a dit ce matin le koan du
bouddha qui attendait le Bouddha.
Ces contes philosophiques extrêmement
compacts que l'on reçoit d'abord comme des histoires drôles,
entraînent l'esprit dans des inférences à longue
portée. La rhétorique des koans est à
l'intuition ce que les formules algébriques de la physique
sont à la déduction. Depuis ce matin, ce koan fertilise
toutes mes pensées et mes décisions.
Qu'est-ce que le koan du bouddha qui attendait le
Bouddha ? C'est un peu comme la parabole du messie qui attendait
le Messie. (Voir l'Évangile palanzi de la Retraite au
désert de Thomas l'Athlète.)
Le 7 juillet
Retour de Manzi et Douha
Cette année encore, Manzi et Douha sont
allés aux Rencontres Internationales d'Aggadhar (voir À
Bolgobol, deuxième partie). Peut-être aurais-je dû
les accompagner plutôt que de rester avec Ziddhâ qui ne
souhaitait pas y participer. Ils sont rentrés hier, et nous
avons déjeuné tous les quatre sur les rives de l'Ardor.
Ce que m'a dit Manzi au repas m'a troublé.
Tous ses propos faisaient résonner en moi les mêmes
questions : Que fais-tu ici ? Qu'attends-tu ?
Il ne m'a pourtant fait aucun reproche, aucune
critique, ni, en aucune façon, même à son insu,
ne m'a mis en cause. C'est le koan qui continue ses effets.
Qu'est-ce que je suis en train de faire dans le
Marmat ? N'ai-je aucun combat à mener chez moi ? Ne
me laisserais-je pas un peu complaisamment réduire à
l'impuissance, en échange d'une confortable attitude
critique ?
Curieusement, en même temps que se dissipait
cette vaine et confortable attitude, je voyais que tous les combats
dans lesquels je pouvais me sentir appelé n'étaient pas
moins vains, et que je n'avais jamais mieux agi que dans le non
agir.
« J'ai l'impression que ça t'a
fait plaisir de les revoir », m'a dit Ziddhâ. « Ton
regard est redevenu rieur. »
Le 8 juillet
Plat de truites au parc Ibn Roshd
Je pars après-demain. Je suis allé
commander un plat de truites au parc Ibn Roshd. Elles sont servies
avec des patates cuites sous la cendre. Pour manger la truite, on la
saisit par la tête et la queue, et l'on y mord dedans.
Près de moi, un petit enfant dans sa
poussette contemple les canards de l'étang. La bouche ouverte,
les yeux ronds, il pousse des cris de joie, qu'il ponctue de vagues
mouvements de bras. Sa grand-mère, je suppose, attablée
devant lui, le regarde un peu d'une même façon, sans
attirer davantage son attention que lui-même celle des animaux.
Elle ne ménage pourtant pas sa peine, fait tinter devant lui
un trousseau de clés, l'interpelle par des onomatopées,
lui fait des sourires.
Les femmes souvent sont sottes, et leurs efforts
pour séduire, dérisoires. Je repense, l'an dernier, à
mes conversations avec le logiciel Eliza (À Bolgobol
cahier
32) :
« Détends-toi, Jean-Pierre. — Si je
parais tendu, c'est sans doute parce que l'anglais n'est pas ma
langue maternelle. — Parle-moi de ta mère,
Jean-Pierre. »
Eliza n'avait pas tout à fait tort :
notre langue, c'est le don de notre mère, de notre nourrice.
C'est d'elle qu'on la reçoit ; elle nous nourrit surtout
de langage.
Pourquoi cette femme dont les gesticulations
finissent par m'agacer, ne donne pas à l'enfant les noms qu'il
devrait attendre d'elle ? Pourquoi ne parle-t-elle pas ? Ou
même ne chante-t-elle pas ? Même Dieu, après
avoir créé Adam, ne lui a-t-il pas donné les
noms ? Dieu le Père ? Ou Dieu la Mère ?
Les femmes sont parfois d'une maladresse folle
quand elles entreprennent de séduire. Elles agitent leurs
clés, elles agitent leurs fesses, elle fond des simagrées.
Elles devraient au moins lire le Traité
de l'Amour d'Ibn Arabî, et apprendre que ce qui nous séduit
à coup sûr, c'est la voix et le regard, surtout quand
ils nous sont adressés, mais certainement pas pour nous parler
de nous.
|