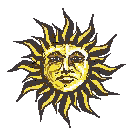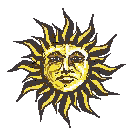Cahier VII
Bref passage à Tangaar
Le 20 mai
Coucher de soleil sur la route
Depuis longtemps, je n'avais plus vu de coucher de
soleil sur la mer. La région est relativement plate autour de
la mer d'Argod, surtout à l'ouest, sur l'autre rive invisible
d'ici. Là-bas sont d'immenses marécages où la
limite entre la terre et l'eau est imprécise, puis qui cèdent
rapidement la place au désert. Aussi la mer d'Argod, semble
plus vaste qu'elle n'est. On ne voit, au nord que les lointaines
cimes blanches de la péninsule du Darmir.
Dans l'air sec, très vite, à peine
le soleil devenu une goutte de sang qui s'écrase sur
l'horizon, la lumière se perd. On voit alors, juste au dessus
de lui, le fin croissant de la nouvelle lune. Depuis un temps si long
qu'on peut l'appeler toujours, de tels spectacles rythment le
quotidien, depuis bien avant l'homme. Aussi, je me demande pourquoi
il fallut si longtemps pour voir la terre tourner autour du soleil.
Je dis bien « voir ». C'est
visible au point qu'il me faut un réel effort d'imagination
pour m'efforcer de « voir » autrement. Si des
hommes ont cru la terre immobile, ce n'est pourtant pas faute d'avoir
observé, calculé et cherché à comprendre.
Les Indiens et les Chinois avaient déjà calculé
le mouvement de la terre, pourquoi les savants arabes, turcs et
mongols, ne l'admettaient-ils pas ?
« C'est un peu plus complexe »
me répond Douha sans tourner la tête, car elle tient le
volant à côté de Manzi. « Les
astronomes de langue arabe connaissaient cette hypothèse.
Beaucoup l'ont étudiée sans la réfuter ni
l'admettre non plus. Ils la jugeaient indécidable. »
« Indécidable, c'est vite dit,
lancé-je, quand tu songes à la difficulté de
modéliser le mouvement des planètes en prenant la terre
comme un point fixe. »
« Oui et non, fait-elle. La
représentation sur le papier est peut-être plus
complexe, mais songe à ce que serait un astrolabe
héliocentrique, et quelle serait son utilité. Tu ne
peux pas dissocier la connaissance de son usage pratique. »
« Les astronomes étaient
d'ailleurs très prudents sur le rapport entre leur modèle
et la réalité. » Reprend Manzi. « Dans
son Livre sur tous les procédés de la réalisation
de l'astrolabe, Al Bîrûnî montre que les
observations et les mesures qui servent à prouver le
géocentrisme peuvent aussi bien justifier le contraire. Ils
n'analysent que des mouvements réciproques, et ne permettent
pas de définir ce qui pourrait faire fonction de point fixe. »
« Al Bîrûnî, précise
Douha, avait même calculé la vitesse de rotation de la
terre, si c'était elle qui tournait. C'est ce qui le fit
justement trancher finalement pour le géocentrisme. Il n'avait
aucun moyen d'expliquer comment les oiseaux, avec une telle vitesse,
pouvaient voler indifféremment dans toutes les directions. »
« Évidemment, songé-je,
sans une formule de l'accélération qui suppose
conservation de l'énergie, et tant qu'on en restait aux
paradigmes de la physique d'Aristote, c'était inconcevable. »
« Pourtant, continué-je,
n'importe quel archer tirant à cheval fait l'expérience
que sa flèche conserve l'énergie. Il fait cette
expérience, ou il rate sa cible. Plus simplement encore, il
suffit de lancer sa monture au galop pour ressentir une forte poussée
en arrière, et la voir cesser presque immédiatement
alors que la vitesse se conserve et même continue de
s'accroître. »
« En somme, n'importe quel bon cavalier
peut arrêter sa monture pour regarder la terre tourner au
coucher du soleil, sans plus d'analyse ni de calcul. »
« Il semble donc, conclut Ziddhâ,
que les intellectuels musulmans, juifs et chrétiens étaient
de piètres cavaliers, et de médiocres archers.
L'histoire des guerres entre les empires d'Occident et d'Extrême
Orient en confirme l'hypothèse. »
Le soleil est passé sous l'horizon. Pendant
un instant, les vieux murs sableux d'un village tout proche ont pris
un éclat rouge qu'aucune photo tirée sur du papier ne
pourrait rendre, seulement peut-être l'écran d'un
ordinateur, dont la lumière vient du dedans.
« Ne vous y trompez pas, reprend Manzi,
les savants de langue arabe n'en étaient pas restés à
la physique d'Aristote. Elle fut critiquée et améliorée
bien avant l'Égire et la généralisation de
l'arabe comme langue scientifique. Des auteurs grecs et syriaques en
avaient déjà bien mis à mal certaines
prémisses. »
« Naturellement, admet Douha, on reste
dans les paradigmes de l'aristotélisme : mouvement
naturel, contrainte, lieu naturel. Un mobile adopte un mouvement
contraint, et si la contrainte cesse, l'objet reprend son
mouvement naturel. Cette conception a cependant été
pondérée par Jean Philipon au sixième siècle
à Alexandrie, qui suppose une transmission de la force d'un
corps à un autre. C'est le concept de kuwwa. »
« Kuwwa ne veut pas dire force,
relevé-je, mais puissance, potentialité, et même
virtualité quand les philosophes l'opposent à l'acte,
af fi'l. »
« C'est bien le problème,
reprend Manzi. Les physiciens arabes ont mêlé en un seul
les concepts de force et de puissance. Malgré leur souci
philologique, la morphologie de l'arabe a entraîné leurs
traductions dans des jeux de langage qui ont limité leur
analyse. Pour autant, al kuwwa n'est pas la traduction de
l'impetus scolastique. »
« Toute science, et cela Avicenne et Al
Farabi le savaient très bien, reprend-il, repose largement sur
celle du langage. La mathématique elle-même en est une,
et elle suppose pour propédeutique, une science de la langue
ordinaire. Ils le savaient si bien que tous leurs ouvrages commencent
par là. »
Nous arrivons à Tangaar dans un bleu de
Prusse qui se répand uniformément sur la mer, la terre,
le ciel et les installations portuaires.
« Chut. Écoutez. »
Dis-je à mes amis.
Dans l'habitacle, on n'entend plus que le bruit du
moteur et des roues sur l'asphalte. L'humidité de la mer, dont
nous sépare seulement une large bande de gravier et une plage
caillouteuse, à la fois porte et étouffe les sons.
« Écoutez quoi ? »
Demande Ziddhâ.
« Ce bleu. »
La nébulosité lointaine a commencé
à se changer en brume. Les lampes des chantiers s'allument peu
à peu avec les premières étoiles. Nous
continuons encore à nous taire.
Le 21 mai
Jésus et la chimie
Pourquoi la tradition associe-t-elle Jésus
à la chimie ? Cette question continue à me tourner
en tête. Ils sont indissociables pour les Chrétiens, qui
de toute façon associent leur messie à toute chose, ils
le sont aussi pour les Musulmans, et même pour les alchimistes
juifs. L'épisode de l'oiseau d'argile dans le Coran me semble
insuffisant pour l'expliquer.
Je soupçonnerais plutôt que
l'alchimie et le Christianisme soient apparus à la même
époque dans la même région : le cœur
du monde hellénistique, alors sous domination romaine. Marie
était une contemporaine du Christ, non pas sa mère, ni
celle qui vint vivre en pleine forêt dans la Baume qui
domine Marseille, Marie la juive, la chymiste, celle qui donna son
nom au bain-marie.
Le mot chimie est réputé venir de
l'arabe (Kam : combien, adverbe de quantité), ou
d'une langue voisine. Il désignait une science des proportions
et des mesures. Zozime d'Alexandrie compte parmi les premiers qui
l'ont pratiquée. Des auteurs la font souvent remonter à
Aristote et à son traité De la Génération
et de la corruption, ou encore au Traité de l'âme.
Traduit du syriaque au grec, puis en latin, le mot
s'écrivait naturellement chymia, et se prononçait
Kimia, comme dans chitine ou psychiatre. On
conserva le plus souvent l'article arabe, comme il était
coutume (alambic, alcool, alcalin, albâtre, albumine...) On
écrivait en français « alchymie »,
puis « alchimie » alors que la prononciation
changeait. Le 'y' ne disparut que très tard dans les langues
vernaculaires, et ne se généralisa pas avant la fin du
dix-huitième siècle en France.
Dans l'Évangile de Philippe, les
paroles de Jésus sont prolixes en paraboles sur la préparation
des teintures et des parfums, qui rappellent les écrits de
Zozime. La teinture des tissus et de différents matériaux
était alors une grande affaire sur les rives de la
Méditerranée orientale, où elle était
mondialement renommée. Selon les époques et les
régions, la chimie concerna plus particulièrement la
pharmacie, comme au Tibet et dans la Chine des Tang, la fabrication
de pierres précieuses, les alliages métalliques.
La chimie mit très longtemps à
trouver sa place dans les sciences modernes, qui étaient
d'abord les filles de la mécanique. La géométrie
unifiait autour d'elle l'astronomie, l'optique, la dynamique, la
balistique... Allez formaliser un modèle géométrique
de la chimie.
« Tout ce que tu dis là,
Jean-Pierre, m'a interrogé Ziddhâ, ne tient pas compte
de la dimension spirituelle de l'alchimie. »
Quelle dimension spirituelle ? Je n'en vois
ni plus ni moins que chez les fondateurs de la physique et des
sciences modernes. Les ouvrages de Newton, de Leibniz, de Pascal,
sont-ils vraiment dépourvus de considérations
spirituelles ? Elles ne sont pas moins inextricablement liées
à leurs recherches que dans les anciens traités de
chymie. Comment le contraire serait-il seulement concevable ?
Comment une science moderne se constituerait-elle sans éprouver
les prémisses d'une spiritualité ?
Je suppose qu'il s'est passé, il y a deux
mille ans, quelque chose de très semblable à la
révolution galiléenne.
Le musée de l'écriture de Tangaar
Le musée de l'écriture de Tangaar
est une très vieille fabrique de papier qui fonctionne encore
partiellement. Elle est l'une des plus anciennes qui ait existé
hors de l'empire chinois. Elle fut construite vers 750 après
J-C. On peut y observer la structure très singulière
des roues et des engrenages des moulins chinois, différente,
par la forme des pales ou des dents, de celle des fabriques que
commencèrent à construire presque à la même
époque les Persans et les Arabes.
La fabrique fonctionne encore et produit les types
de papier qui furent utilisés à différentes
époques. Le personnel est pour l'essentiel constitué
d'élèves et d'étudiants stagiaires. Les ramettes
sont vendues aux visiteurs, ou sont exportées dans les
différentes écoles d'art et de calligraphie des
environs.
Les papiers fabriqués selon les plus
anciennes techniques sont lourds, épais, souples, et presque
indéchirables. Ils étaient très souvent employés
pour la décalcomanie par frottage sur des supports de pierre
ou de bois.
Des techniques plus récentes ont produit
plus tard des feuilles extrêmement fines et légères.
La généralisation des pigeons voyageurs dès le
dixième siècle encourageait cette évolution.
Elle était déjà sensible avant. L'un des
principaux avantages du papier sur le papyrus est son plus faible
poids.
On dit que les écrits restent. Ils volent
au contraire, et ne demandent qu'à se disperser le plus loin
possible. Ces mêmes raisons firent aussi disparaître peu
à peu le pinceau au profit du calame de roseau qui permet une
écriture plus serrée. L'encre était fabriquée
à l'aide de fines particules de carbone et de sulfate de fer
liées par du blanc d'œuf pour la rendre indélébile.
Le stylo à pompe de Tangaar
En 1287, Ibn Af Firsî inventa un calame à
pompe. Plusieurs exemplaires sont exposés dans des vitrines.
Ils ont la forme générale d'un calame de bambou. Ils
sont en métal, presque toujours en or, du moins pour ce qui
est de la section et de la plume. Parfois le corps est simplement en
roseau. On trouve aussi d'autres matériaux : ébonite
rehaussé de mailles d'argent, pierres précieuses
serties dans un guillochage d'or.
J'ai appris que le premier stylo à
cartouche fut fabriqué dans les années 970 par le
calife fatimide Al Mucizz. Le premier modèle fut
perfectionné à plusieurs reprises, puis on n'en
entendit plus parler. Peut-être l'objet demeurait trop cher
— il était en or massif — comparé
à un simple bout de roseau qu'on peut trouver partout, choisir
et tailler à sa main.
Peut-être aussi, le gain de temps si cher au
calife pour s'épargner le geste perpétuel de tremper le
calame, était-il trop cher payé du plaisir de tailler
sa pointe.
Demain nous prendrons la mer
Ziddhâ et moi n'avons rien de particulier à
faire à Tangaar. Le hasard a croisé ma route avec celle
d'un pêcheur arrivé dans son voilier de Gourdâl,
un port sur la rive opposée à la péninsule du
Darmir, et que ses affaires appellent à rentrer par la route.
Il est prêt à payer pour que son embarcation soit
ramenée chez lui. L'idée me vient que nous pourrions
partir tous les deux, Ziddhâ et moi, et laisser ici nos amis à
leur congrès.
Je n'ai pas envie de recevoir de l'argent de cet
homme qui fait pourtant un point d'honneur à me payer. Je lui
propose alors, avec cette somme qu'il veut me donner, de négocier
pour moi un fusil à harpon, un masque et un tuba. Je les lui
offrirai en repartant. Il pourra s'en servir ou les revendre. Puisque
j'accepte son salaire, il n'a plus de raison de refuser un cadeau.
— Tu es sûr de savoir manœuvrer
ce voilier ? S'inquiète Ziddhâ.
— Toutes les voiles fonctionnent selon
le même principe.
— La mer n'est pas seulement une
étendue plane, Jean-Pierre, elle a des rivages, des récifs,
et d'autres embarcations la sillonnent. Es-tu certain de nous amener
à bon port ?
— Si Dieu le veut, Ziddhâ.
Le 22 mai
En felouque
L'embarcation est un petit voilier de bois, de
type felouque, bien moins réactif que ceux de plaisance où
j'ai appris, il y a bien longtemps, à manœuvrer. Nous
avons dû remonter au vent, et il n'était pas facile de
le serrer pour louvoyer dans le chenal parsemé d'îles
qui sépare les deux premières parties de la mer.
Le gréement est déroutant sur ces
felouques quand on n'y est pas habitué. La voile triangulaire
est montée sur une vergue attachée au mat. J'en ai été
perturbé avant d'en découvrir les avantages. Le plus
dur fut encore de sortir du port, non sans suées, sous le
regard inquiet de Ziddhâ. J'en ai encore connues ce soir pour
mouiller devant une petite plage de sable fin sans toucher le fond.
Mais Dieu est clément et miséricordieux, et je n'ai pas
non plus échoué à transpercer de mon harpon un
poisson inconnu qui nous a régalé. Maintenant, je pense
parvenir à entrer au port et à accoster sans dommage.
La felouque dispose d'une installation électrique
à la fois sophistiquée et simple. Pas de générateur
ni de batterie : une petite girouette en haut du mat alimente
une dynamo qui fournit l'alimentation principale. Elle est assistée
par une turbine sous la coque, à la proue, que je n'ai aperçue
qu'en plongeant, protégée par une petite cage
métallique. J'ai donc pu utiliser mon ordinateur, notamment
pour me diriger.
De la plage où nous avons fait du feu, on
aperçoit sur l'autre rive le massif du Darmir assez proche.
Quand nous en naviguions plus près, on n'y distinguait aucune
agglomération ni rien qui ressemble à des installations
industrielles ou à des terres cultivées, et, la nuit
tombée, aucune lumière ne s'éclaire. À
l'aube, derrière les premiers massifs couverts de forêts,
on voit les lointaines cimes rocheuses que dore la lumière. La
masse de leur reflet sur la mer que le vent strie, est étrangement
sombre.
La peinture à la souris
Comme je n'ai pas d'appareil photo, j'ai tenté
de reproduire le paysage avec un logiciel d'image de synthèse.
J'ai téléchargé la carte de la région de
Tangaar que j'avais d'abord utilisée pour naviguer. À
Tangaar, le Bureau de Cartographie permet de télécharger
en source libre des cartes topographiques en deux formats :
Digital Elevation Model (DEM) et Spatial Data Transfer
Standard. Mon logiciel peut lire les deux.
J'aurais pu directement la modéliser en
trois dimensions si j'avais fait le choix d'une vue aérienne.
Pour un panorama à partir du sol, la perspective était
trop lointaine, et j'ai dû tricher. J'ai écrasé
longitudinalement les massifs rocheux du fond. J'ai placé
devant eux des pentes boisées, et une côte plus escarpée
au sud-est.
Avec méthode, j'ai réussi assez
rapidement. Le plus dur fut d'aligner le plan d'eau et les différents
massifs. Ce n'est pas très évident quand on utilise une
vue en "fils de fer". Si la base des montagnes lointaines
n'était pas cachée par le premier plan, on les verrait
flotter très au-dessus du sol.
J'ai trouvé presque sans m'y reprendre la
bonne orientation du jour, le ton doré de la lumière,
la luminosité de l'eau, la nébulosité, la
densité des ombres... La vue finale restait un peu pâlotte.
Je l'ai parfaite avec un traitement d'image.
À ma grande surprise, tout cela ne m'a
guère pris plus d'une heure. Je doute d'ailleurs que j'y sois
parvenu en beaucoup plus de temps. Le geste juste ne tolère ni
le tâtonnement ni l'hésitation.
Depuis l'an dernier que je me suis familiarisé
avec l'image de synthèse, je me rends compte que la différence
avec le dessin à vue est minime, du moins une fois la
technique assimilée.
C'est le fruit d'un long travail que de parvenir à
ramener le monde réel que l'on a sous les yeux à des
surfaces de couleurs. Si nous en sommes capables, les techniques
particulières qui consistent à peindre à main
levée, à tracer des lignes de fuite, où à
dessiner des lignes en trois dimensions à l'aide d'un
logiciel, ne constituent pas des activités cognitives de
natures bien différentes.
Certes, on pourrait bien dire que le processeur
fait ici le travail à la place du peintre. À ce compte,
on pourrait aussi bien dire que ses organes sensoriels font ce même
travail pour lui. Pourtant, le processeur pas plus que nos organes ne
font grand chose, ne font du moins l'essentiel. Dans tous les cas,
l'essentiel est notre capacité de « voyance ».
Le programme, le processeur font le travail que
leur commande celui qui voit. Ils font aussi bien le patient et
machinal travail de la main quand le rendu passe lentement de taches
floues aux pixels apparents, à une image lissée.
Qu'est-ce que cela prouve, sinon que ce travail n'était pas si
essentiel ? La part d'automatisme, d'application de règles
ou le jeu du hasard n'y est pas profondément différente.
J'observe que mes images de synthèse ont un
air de famille avec ce que je pourrais faire avec de l'huile et des
pinceaux. Je m'en rends compte dans leurs faiblesses qu'elles ne
m'aident finalement pas tant à dépasser.
C'est très visible dans une autre image
faite à partir de mes souvenirs du trajet vers la mer d'Argod.
Je ne suis pas arrivé à distinguer nettement les arbres
de la roche au premier plan. Malgré le rendu numérique,
la vue reste confuse. Curieusement, l'image en acquiert une facture
manuelle. Ce n'est pas le cas de la dernière, comme on peut
s'en rendre compte
(http://jdepetris.free.fr/Livres/retour/images/3d.html).
|