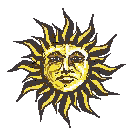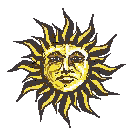Cahier VIII
Face au Darmir
Le 23 mai
La thèse de Ziddhâ
Sur le pont du voilier, Ziddhâ ne se dénude
pas comme moi pour profiter du soleil, au contraire, elle cache
jusqu'à son nez sous son large foulard. « Trop de
soleil est mauvais pour la peau, un peu lui fait du bien »
ai-je beau lui dire.
Ziddhâ m'a parlé de sa thèse
de doctorat : Matière et langage. Elle travaille
en ce moment sur le chapitre consacré à l'éthique :
Éthique matérialiste et éthique du bien-dire.
Elle travaille lentement. L'an dernier, elle en était au
chapitre sur le formalisme et l'intuitionnisme. J'y ai travaillé
avec elle lorsque nous sommes partis ensemble dans la vallée
de l'Oumrouat.
Le formalisme mathématique de Hilbert est
un genre de nominalisme qui identifie la mathématique à
son langage : les objets mathématiques sont des objets
linguistiques, et la discipline est entièrement autothélique.
On peut résumer cela en disant que s'il y a
dans les mathématiques matière à expérience,
celle-ci ne saurait être que linguistique, ou du moins
sémantique. Pour une grande part, c'est une évidence.
Pour autant, cette expérience aboutit à la
démonstration, c'est à dire à un « c'est
ça », dans lequel le « ç »
et le « ça » ne veulent pas dire grand
chose d'autre qu'un « voilà » (un « vois
là »). Je force à peine la traduction du
vocabulaire propre de Ziddhâ : It's this ; that
is.
La conception hilbertienne semble assez facile à
tirer vers un matérialisme linguistique. Pour autant nous ne
sommes pas très loin d'un idéalisme du signe.
Inversement, l'intuitionnisme de Gödel semble de prime abord
avoir quelque affinité avec l'idéalisme platonicien.
Pourtant l'intuition laisse ici entière la question de la
nature ce qui est effectivement intuitionné.
Or le plus intéressant dans cette impasse
où était tombée la philosophie des mathématiques
au début du vingtième siècle, est la façon
dont un disciple de Hilbert, Von Neumann, perturbé par les
théories de Gödel, déplaça entièrement
la question en inventant l'informatique. C'est à dire en
introduisant dans un dispositif matériel tout ce qui relevait
d'un formalisme mathématique, avec le succès que l'on
connaît.
— Dis-moi, Ziddhâ, c'est nouveau
cette idée de rajouter à ta thèse un chapitre
sur l'éthique. Tu ne m'en avais pas parlé l'an dernier.
— L'an dernier, je n'y songeais pas
encore. C'est toi qui m'en a donné l'idée.
— Moi ?
La crise du matérialisme au vingtième
siècle
La mécanique quantique a provoqué
une crise du matérialisme depuis la fin du dix-neuvième
siècle. Jusque là, deux voies conduisaient à la
connaissance de la matière : la chimie et la mécanique.
La grande révolution scientifique de la modernité
n'avait emprunté que la seconde. La première, la
chimie, avait fait de grands progrès à la fin du Moyen
Âge, mais elle demeurait irréductible aux modèles
géométriques des nouvelles sciences. La mécanique
quantique a produit les nouveaux paradigmes qui font des deux
disciplines une seule. Elle a unifié la chimie moléculaire
et la mécanique des particules.
La connaissance de la matière a évolué,
or cette matière elle-même finit par se dissoudre dans
cette connaissance.
Qu'était la matière dans l'antique
chimie ? Elle était des corps composés que l'on
cherchait à purifier jusqu'aux éléments les plus
simples ; elle était des corps purs que l'on cherchait à
fusionner, à marier pour fabriquer des matériaux
composites. On ignorait cependant combien existaient de corps
simples.
La chimie s'occupait de matériaux plus que
d'une problématique matière. Cette « matière »
n'a jamais été qu'une abstraction générique
des différents matériaux, comme on dit « le
nombre » alors que nous ne connaissons que des nombres
particuliers, ou « la couleur » quand
n'existent que des couleurs particulières. On pouvait toujours
imaginer une matière unique dont seraient faits les multiples
matériaux. Une telle conception s'accorde cependant fort mal
avec le matérialisme, qui suppose au contraire un nombre fini
de matériaux pouvant donner cours à une combinatoire.
La physique ne connaît pas non plus une
matière unique, mais des matériaux que caractérisent
leurs propriétés mécaniques. Cependant, elle
cherche des lois qui s'appliquent universellement à tous.
Cette physique s'est affinée en quatre siècles, jusqu'à
pouvoir déterminer l'ensemble des éléments
simples par leurs propriétés mécaniques.
En cela, il n'y a jamais eu de crise réelle
du matérialisme, sauf à en faire la croyance en une
matière unique et transcendantale. Justement, la réalité
de la matière n'a jamais été ailleurs que dans
les matériaux, dans les propriétés chimiques et
mécaniques des matériaux, et la capacité pour
l'homme de les percevoir et de les utiliser.
Bien sûr, on apprécie mieux ces
remarques en grimpant sur le pont en bois d'un voilier chauffé
par le soleil, après avoir surgi de l'eau glacée avec
un poisson qui s'agite encore à la pointe de son harpon.
Le port de Gourdâl
La vallée du Bénarophon se jette
dans la mer d'Argod, de l'autre côté du port de Gourdâl.
La mer ici n'est presque plus salée. On l'appelle le Lac
Supérieur. La vallée du Bénarophon s'enfonce en
direction du nord-ouest. Elle est coupée après son
premier quart par la vallée du Darmir qui donne son nom à
la péninsule, à peu près orientée
sud-ouest.
On trouve dans Gourdâl l'architecture
militaire traditionnelle tasgarde, avec ses épaisses tours de
pierres surmontées de bulbes pointus. Le bois ici est plus
utilisé dans la construction, même des remparts, et
donne à la ville un air différent des autres régions.
La péninsule du Darmir est peu peuplée, très
boisée, et il est assez facile de faire flotter des troncs
jusqu'à la mer.
J'ai bien fait d'accepter la proposition du
pêcheur. Son bateau n'est pas bien gros mais permet d'y dormir
confortablement sous le pont. En accostant à la tombée
du jour, nous n'avons pas eu à chercher un hébergement.
J'ai échangé à l'auberge trois beaux poissons
contre deux repas.
L'Évangile de Thomas
Jésus a dit : Si la chair a été
à cause de l'esprit, c'est une merveille. Si l'esprit a été
à cause du corps, c'est une merveille de merveilles. Mais moi
je m'émerveille de ceci : comment cette grande richesse
s'est mise dans cette pauvreté.
Évangile selon Thomas, 29
Thomas a été appelé
« l'apôtre des Parthes ». Les historiens
sont divisés pour décider s'il partit d'abord pour la
Perse, puis prêcha au-delà de l'Anatolie et de l'Indus,
ou s'il descendit d'abord en Égypte, remonta le Nil et
s'embarqua d'Afrique vers le Golfe Persique. Ce sur quoi presque tous
s'accordent est que son évangile est le plus ancien, et le
seul écrit par un apôtre ayant côtoyé
Jésus.
On connaît surtout sa version copte
retrouvée en Égypte. Il en existe une plus ancienne en
farsi. On suppose que la version originale était en araméen.
L'Évangile copte de Thomas appartenait aux
Ophites, une église gnostique qui était la branche
égyptienne des Naassènes (de l'hébreux nahash,
serpent), proches des Caïnistes, appelés encore
Béni Khaïn. Ils tenaient en grande estime le
serpent qui avait offert à l'homme le fruit de la
connaissance.
Ses disciples lui demandèrent : Qui
es-tu, toi qui nous dit cela ? Il leur répondit :
D'après ce que je vous dis, vous ne savez pas qui je suis ?
Vous êtes devenus comme les Juifs, car ils aiment l'arbre et
haïssent le fruit. - Évangile selon Thomas, 43
L'Évangile selon Thomas ne contient aucune
information biographique. On n'y trouve que des paroles de Jésus,
la plupart conformes ou ressemblantes à celles des quatre
évangiles romains.
— Dis à mes frères
qu'ils partagent les biens avec moi. — Ô homme, qui
a fait de moi un partageur ? Se tournant vers ses disciples :
Suis-je donc un partageur ?
Le Christianisme antique au Marmat
Il a existé aux premiers siècles
dans le Marmat une littérature constituée de recueils
de paroles de Jésus, comparables aux Hadith du
Prophète. On ne possède aucune indication historique
fiable sur eux. Ils contiennent aussi parfois des paroles attribuées
aux quatre frères de Jésus : Jacques, Joseph,
Simon et Jude.
Simon : Après ma mort, serais-je
près de toi en présence du Père ?
Îs'â : Quand tu m'as rejoint,
Simon, t'ai-je dit que je t'enseignerai ce qui est après la
mort. - Évangile palanzi de Jude
Ces paroles attribuées à Îs'â
et son frère rappellent celles du Bouddha Gautama à un
disciple qui l'interrogeait sur la réincarnation. Ceci ne
plaide pas beaucoup en faveur de leur authenticité.
Le Christianisme se serait introduit dans le
Marmat bien avant l'Islam, du vivant de Jésus, après sa
fuite de Jérusalem. Le Bouddhisme a cependant largement dominé
la vie spirituelle jusqu'au douzième siècle.
Il semblerait que le Bouddhisme et le
Christianisme ne furent jamais réellement en concurrence. Les
deux traditions sont sur des plans trop différents. Elles
n'ont pas le même objet, pas les mêmes pratiques, pas les
mêmes concepts, les mêmes méthodes ni les mêmes
buts. Chrétiens et Bouddhistes pouvaient entendre et assimiler
bien des choses les uns des autres ; les deux traditions n'en
suivaient pas moins leur voie sur des plans différents.
Le Bouddhisme était tout prêt à
assimiler Jésus, et voulut même en faire de son vivant
un Boddhisatva. Lui-même parut de son vivant s'y refuser.
L'Évangile palanzi éminemment apocryphe de Jude, le
frère de Jésus, lui prête ces paroles :
« N'écoutez pas ceux qui me disent parfait. Les
créatures du Père sont imparfaites, car elles sont
libres et vivantes. Combien plus ses enfants. »
Son frère Jacques aurait dit aussi :
« Ne vous souciez pas de l'Éveil. En rêvant,
Îs'â marcha sur l'eau. La lumière du Père
se révèle sous des images. Si tu vois l'image, tu ne
vois pas la lumière qu'elle cache. Si tu voyais la lumière,
elle te cacherait l'image. Le mouvement du rêve brûle
l'image dans la lumière. »
Petit déjeuner à Gourdâl
J'étais déjà éveillé
sur le pont quand la prière de l'aube a retenti. D'ici, j'ai
du mal à évaluer la taille de la ville. Elle ressemble
à un vieux village de pêcheurs surgi du fond des temps.
Les vieux murs, dont un soleil qui n'a pas encore
pointé rosit les pierres, se reflètent dans l'eau.
Si je tourne la tête dans la direction du
jour, je vois les installations portuaires plus modernes, avec leurs
hangars et leurs grues, où s'alignent de petits cargos en
ombres chinoises.
J'ai faim.
On ne mange pas ici des escargots, on mange des
criquets. Ça me convient très bien ; je n'ai
jamais pu ingurgiter ces mollusques, de quelque façon qu'ils
aient été cuisinés, et la simple idée de
le faire m'écœure. Je ne répugnais pas de manger
des insectes crus quand j'étais tout petit, à la grande
horreur de ma mère lorsqu'elle s'en aperçut et tenta de
m'en inculquer la répulsion.
Ici, on ne mange pas les criquets crus. On les
fait cuire, et on les vend dans des cornets de papiers ou des
barquettes comme des frittes. J'en ai pris une double assiette avec
de la salade pour petit-déjeuner.
Voir un port sans voiliers de plaisance, sans
coques blanches et couleurs vives, voilà à quoi je
n'étais plus habitué.
Un chevalier du Marmat
À l'auberge, j'ai fait la connaissance d'un
chevalier. Abou l'Gabor est un petit quinquagénaire
rondouillard qui a encore belle prestance. Il porte une paire de
fines moustaches aux pointes dressées, et le manteau à
capuchon de laine traditionnel du Marmat. Son crâne est serré
dans un turban de soie noire où est épinglée une
sorte de camée surmonté d'un court plumet. C'est un
étrange bijou de pierre noire où est taillé un
lézard aux contorsions soulignées d'une fin sertissage
d'argent qui, le long des doigts et de la queue, rejoint la monture.
Il porte sur la bedaine un long sabre et un
poignard. Il paraît pourtant pacifique, même doux,
poussant la politesse à la préciosité. Quelque
chose du rapace dans les yeux et le nez, que renforce encore la barre
de ses sourcils sur un regard acéré, contraste avec cet
air débonnaire et un perpétuel sourire de bouddha.
Qu'est-ce qu'un chevalier dans la république
contemporaine du Gourpa ? C'est bien ce que je ne suis jamais
arrivé à savoir au cours de mes voyages. Je n'étais
même pas certain qu'il en existât encore, et voilà
que j'en tiens un devant moi.
La chevalerie du Marmat s'apparenterait-elle à
un ordre honorifique, comme chez nous la Légion d'Honneur, à
une fraternité secrète comme la Franc-maçonnerie,
ou aux vestiges d'une vieille aristocratie ? À rien de
tout cela semble-t-il.
« Être chevalier, m'assure mon
voisin de table, c'est être en possession de capacités
qui ne sont pas celles de tout le monde. » Voilà
qui nourrit ma curiosité. Quelle sorte de capacités ?
Physiques, intellectuelles, spirituelles ?
Un chevalier doit être un lettré, un
parfait maître d'arme et un homme de foi. « Si tout
ceci est nécessaire, ce ne saurait être essentiel, »
affirme-t-il. « Ce qui fait un chevalier, c'est qu'en tout
acte, il met sa vie dans la balance, sinon il n'accorde même
pas son intérêt. » Cela reste pour moi
abstrait. « Ça ne l'est pas pour les gens d'ici,
croyez-moi. »
« Non, répond-il à mon
étonnement. Il ne s'agit ni d'effrayer les gens ni de les
dominer d'une façon quelconque. C'est une question de posture
devant la vie. »
« Si vous cessez d'accorder de
l'importance à ce pour quoi vous ne sauriez être prêt
à mourir, mon ami, ajoute-t-il avec un sourire jubilatoire,
vous verrez naturellement votre sagesse et votre bravoure devenir
plus tranchantes et acérées qu'une lame d'acier. Votre
esprit deviendra plus libre et plus vif, et votre corps plus détendu
et plus prompt. » Il achève sa phrase manifestement
très satisfait de lui.
J'avais tenté l'an dernier d'en apprendre
plus sur la chevalerie du Marmat et, de là, d'en comprendre
mieux ce que fut la chevalerie au cours du Moyen Âge dans
toutes les civilisations.
« Aussi loin que vous remontiez dans
l'histoire, me dit-il, la chevalerie repose sur une posture
personnelle, pas sur une appartenance à une quelconque caste
ou communauté. Elle est avant tout une quête et une
initiation. Elle suppose donc aussi un armement personnel. »
Cet homme ne cesse de me surprendre. Qu'entend-il par là ?
« Pensez à l'armée des
Huns, mon ami. Leurs chevaux étaient rapides et leurs arcs
puissants. Pensez-vous que ces armes eussent suffi contre des armées
qui les dominaient par la tactique, la stratégie, la
discipline et la logistique ? La supériorité des
Huns tenait à ce que chacun constituait avec son cheval, son
arc et son sabre, une unité parfaitement autonome, légère,
rapide, et opératoire même en tout petit nombre et
coupée de tout commandement. »
« Les empires devaient occuper et
administrer les territoires conquis. Les Huns n'avaient qu'à
détruire les conditions de cette administration. À cela
de petites unités suffisaient, annihilant l'ennemi si elles
réussissaient, ou se dispersant sans perte si elles
échouaient. »
« Les armées des empires étaient
bien incapables de se battre ainsi. Sans état-major ni
encadrement, on aurait retrouvé chaque légionnaire
endormi sous le robinet d'un tonneau d'alcool ou le ventre d'une
prostituée. » Finit-il en un petit rire.
— Vous faites donc remonter aux Huns la
chevalerie ?
— Pas si vite, mon ami. Demandez-vous
d'abord pourquoi les Huns n'avaient pas à occuper et
administrer les territoires conquis.
Sur ces entrefaites, Ziddhâ est arrivée
pour emprunter mon portable, et nous nous sommes replongés
dans une longue conversation sur l'histoire mondiale du premier
millénaire.
Les grandes invasions
En 114, l'empereur romain Trajan envahit l'empire
parthe des Indes. En 115, les légions romaines écrasèrent
la révolte juive d'Égypte. À peu près à
la même époque, elles envahirent la Mésopotamie.
De 132 à 135, Hadrien écrasa la
révolte conduite par Simeon Ben Koseva en Palestine. Il fit
aussi construire le mur d'Angleterre qui marqua la frontière
septentrionale de l'empire romain à son apogée.
Pendant le siècle et demi qui suivit, Rome
aura été un immense, riche et puissant empire, bien
administré et bien protégé. Le peuple avait du
pain et des jeux ; et les lions du cirque, des hommes libres.
La Pax Romana fut pour les esprits une paix
des cimetières. Jamais sur une aussi longue durée, un
empire ne demeura aussi stérile pour ce qui est des sciences,
des techniques et des arts.
J'ai appris beaucoup avec mon nouvel ami que j'ai
revu l'après-midi. Plus exactement, j'ai moins acquis des
informations neuves, qu'un autre regard qui les renouvelle.
« Vous êtes très savant
sur la fin du monde antique en Occident, me disait Abou l'Gabor, mais
vous cloisonnez trop l'histoire des grandes invasions de celle du
Christianisme primitif. Vous ethnicisez trop les premières, et
ramenez trop les secondes aux seules décisions de conciles. »
« Vous séparez artificiellement
cette première époque de celle de l'explosion de
l'Islam, et vous l'isolez aussi de l'histoire des autres
civilisations. » Continua-t-il avec son curieux mélange
de politesse et de satisfaction excessives. « Avec un peu
de jugeote, mon ami, vous en savez assez pour en comprendre bien
davantage. »
Abou l'Gabor est un puits de science, et j'ai pris
quelques notes sur ce qu'il m'a appris. Il n'a pas cessé
lui-même d'écrire pendant que je parlais.
|