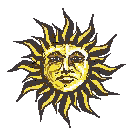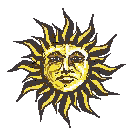Cahier XVI
Toujours chez Kouka
Juin 2004
Dire, c'est taire
Je reprends les notes que j'avais laissées
éparses depuis quelques temps. Ce léger décalage,
ce léger pli du temps me permet de mieux percevoir tout ce
qu'on tait en écrivant.
Dire, c'est taire. Voilà comment devrait
débuter tout traité de grammaire, de rhétorique,
de linguistique, de poétique, de sémantique, de
mathématiques, de musique, de logique... Apprendre à
écrire est donc d'apport apprendre à se taire.
Soit dit entre nous (je peux expliquer en privé
pourquoi il est préférable de ne pas ébruiter la
chose), c'est ce qui fait la différence entre ce qu'on a
appelé « le premier Wittgenstein » et le
second ; entre la dernière phrase du Tractatus,
« ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire »,
et tous les travaux qui suivent. Après son premier livre,
Wittgenstein avait tout simplement appris à écrire. (Ce
qu'on peut dire, on doit le taire.)
les lignes qui suivent sont à peu près
tout ce que je retiendrai d'une conversation avec Kouka que j'avais
commencé à transcrire. Le reste, je le tais.
« Quelle heure est-il ? »
demandé-je. J'ai quitté ma montre à cause de la
chaleur sur le balcon en début d'après-midi. Kouka
jette un nouveau coup d'œil à la sienne qu'elle vient de
regarder. «
C'est bien ce que je pensais, remarqué-je
à haute voix, "deux heures moins le quart", ça
ne veut absolument rien dire, pas plus que la position de deux
aiguilles sur un cadran. »
« Qu'entends-tu par là ? »
Me demande Kouka.
« Tu viens de jeter les yeux sur le
cadran de ta montre et tu paraissais satisfaite de ce que tu avais
appris. Pourtant, quand je t'interroge tu dois regarder à
nouveau. Alors je me demande ce que tu avais réellement vu, et
ce que tu dois vérifier. »
On peut mesurer tout ce qui doit être tu,
voyageant si loin de chez soi, pour retenir une telle anecdote.
Kouka y avait pourtant vu une profonde remarque
qui lui rappelait je ne sais quel Koan où il est question de
pêche au filet et d'un moine qu'on jette à l'eau pour
attraper les poissons qui semblent si proches à peine sous la
surface.
Pythéas le navigateur
Depuis que je suis chez elle, j'utilise souvent
l'ordinateur de Kouka pour naviguer sur le net et pour corriger mes
pages avant de les mettre en ligne. Elle est l'une des rares ici à
utiliser une interface en anglais, plutôt que d'avoir localisé
son système.
Son navigateur, intégré à
leur Unix local, s'appelle Pythéas — une discrète
référence au Marmat hellénistique. Il est une
merveille de sécurité et d'ergonomie. De plus, un
module peut indiquer les fautes de code pour le html, les css
et même le javascript.
Quand on ouvre le menu « About
Pytheas », un lien renvoie à l'entrée de
Wikipédia : « Pytheas est un navigateur et
explorateur grec de Massilia (la Marseille antique) qui aurait
effectué vers 340 avant J.-C. un voyage dans les mers du nord
de l'Europe. [...] Pendant très longtemps, il fut considéré
comme un menteur, un affabulateur puis comme le premier explorateur
scientifique. Il avait aussi établi à quatorze minutes
près la latitude de Marseille à l'aide d'un bâton
de gnomon. Depuis, les astronomes ont donné son nom à
un cratère lunaire. »
Pythéas avait écrit un livre, De
l'Océan, qui brûla dans la bibliothèque
d'Alexandrie. On en connaît des bribes par Pline, Erastosthène
de Cyrène, Polybe, et surtout Strabon qui s'est évertué
à le faire passer pour un affabulateur.
Pythéas y expliquait les marées par
l'attraction de la lune et l'influence des équinoxes, la
rotondité de la terre, dont son système de longitudes
et de latitudes donnait la circonférence, exacte à 90%,
l'inclinaison de la terre sur son axe, supposant l'héliocentrisme,
sans parler de la description des baleines. Il y avait de quoi
asseoir pour des siècles la réputation de blagueurs des
Marseillais !
J'apprends aussi qu'un exemplaire du livre avait
été amené par Hippias, et qu'il se trouve
toujours à la bibliothèque de Bolgobol. Un autre lien
permet d'en télécharger une traduction en palanzi sous
la forme d'un fichier EPS.
On doit aussi à Pythéas la durée
fixe des heures. La journée se divisait avant en douze heures
de jour et douze heures de nuit. La durée des heures variait
donc selon les saisons. Pythéas avait navigué jusqu'à
la hauteur de l'Islande — sans doute la terre qu'il appela
Thulée —, où le jour en hiver dure deux
heures, ce qui rendait ce système aberrant. C'est ce
qu'affirme Wikipédia, et qui me semble au moins aussi
aberrant.
En effet, comment aurait-on mesuré des
heures à durée variable avant ? Pour savoir
l'heure, on se fiait à la latitude du soleil, et on la
mesurait avec des cadrans solaires — je mets au défi
quiconque de m'expliquer ce que serait une mesure sans méthode
pour mesurer.
Où a-t-on vu que des cadrans solaires
marquaient des heures plus longues en été qu'en hiver ?
On en trouve encore partout sur terre, aux façades de vieux
monuments à Marseille comme à Bolgobol, et il est
facile de le vérifier. Ils donnent l'heure locale avec une
parfaite exactitude, et aucun encore ne s'est déréglé.
C'est incroyable comme on ne peut jamais se fier à
ce qu'on entend ou à ce qu'on lit. Heureusement, avec un peu
de vigilance, il n'est jamais très dur de vérifier à
l'aide de moyens très simples qu'on a toujours à sa
portée. En l'occurrence, un bâton suffit, ou même
le montant de sa fenêtre.
J'espère que celui qui me lit entendra bien
cela. Je ne serai pas toujours derrière lui pour réveiller
son sens critique, ni seulement pour identifier les erreurs dont je
pourrais me faire le colporteur.
Kouka et le Bouddhisme
Kouka s'est détournée très
jeune de la religion. Le mot qu'elle emploie pour me dire cela
désigne explicitement l'Islam, mais ce n'est pas « Islam »,
ni « religion ». Il entend aussi que le
Bouddhisme n'est pas pour Kouka une religion, plutôt un chemin
pour en sortir.
Kouka n'aime pas le sens tragique de la religion.
Moi non plus.
Il n'en faut pas plus à Kouka pour vouloir
se convaincre que je suis bouddhiste : « Pourquoi le
cacher ? »
« Tu as étudié et
pratiqué bien plus que des gens qui s'en tiennent
scrupuleusement aux rituels. » Dit-elle encore.
Je cite les Dialogues dans le Rêve de
Bûsô pour lui expliquer que celui qui respecte les
rituels pénètre des arcanes plus subtils, et que j'ai
souvent plus appris du simple fidèle que du sage et du
théologien.
« Et comment le saurais-tu, si tu
n'étais avancé dans la voie ? » Me
répond-elle. Que puis-je faire d'autre que hausser les
épaules ?
« Vous autres, Occidentaux, vous pensez
en terme d'appartenance quand il s'agit d'acquisition »
dit-elle. « Vous voulez vous intégrer, vous
assimiler, vous incorporer, quand c'est à chacun qu'il
appartient d'intégrer, d'assimiler, d'incorporer. Doit-on
devenir britannique pour parler anglais ? »
Quand je lui réponds « alors
pourquoi veux-tu que je sois bouddhiste ? » elle
hausse les épaules à son tour.
Le déséquilibre de la terreur
J'ai relu la description que j'avais faite de
Kouka lors de ma première rencontre l'an dernier. (Voir À
Bolgobol, fin du cahier
32)
Je l'avais décidément mal vue. Assise, elle m'avait
parue moins grande. Sa large salopette cachait son corps svelte. Je
l'avais pourtant crue plus jeune ; on interprète toujours
plus qu'on ne voit.
Dans la hiérarchie militaire, Kouka a un
grade correspondant à commandant. Elle est discrète sur
ses fonctions. « Les avions, les chars et même les
missiles, c'est du folklore, » m'a-t-elle quand même
dit. « La guerre, c'est le contrôle de la
stratosphère par la commande numérique, et les
opérations de commando sur le terrain. »
D'après Kouka le véritable danger
mondial aujourd'hui est la surestimation par l'OTAN de la supériorité
militaire que lui donneraient ses armes de destruction massive.
« L'OTAN a été construite sur l'équilibre
de la terreur, m'explique-t-elle, et il n'y a plus d'équilibre.
Elle ne sert qu'à terroriser le monde, c'est à dire à
rien, car l'humanité n'a pas besoin d'elle pour avoir peur. Il
lui suffit d'ignorer les Quatre Nobles vérités. »
Les raccourcis de Kouka me sidèrent
parfois. « Ne faites vous pas alors le jeu de l'OTAN avec
vos alliés, en ayant signé le Traité de
Shangaï ? » Lui demandé-je. « Non,
répond-elle péremptoire, mais nous avons du mal à
convaincre nos partenaires de l'efficacité de nos méthodes
pour combattre la terreur » ajoute-t-elle plus soucieuses.
— Les Quatre Nobles Vérités ?
Risqué-je.
Kouka rit.
Les constructions du Marmat
Les Marmaty, c'est ainsi qu'on appelle les
habitants du Marmat, ont un point commun avec les Romains : la
construction robuste. Même le neuf est solide et paraît
destiné à durer toujours. Le terrain instable des
montagnes et les fortes variations climatiques l'imposent. Et puis on
ne manque pas de pierre à bâtir.
Aussi, même si la démographie
s'accroît comme partout ailleurs et entraîne la
construction, les bâtiments neufs sont plus rares que dans les
autres pays. Ils ne se distinguent pas non plus beaucoup des vieux.
Les Marmaty ont une prédilection pour tout
ce qui paraît vieux. Si une chose a traversé le temps,
c'est qu'elle est solide. Ils aiment ce qui est solide, et ils
prisent les traces d'usure qui en témoignent.
Les villes en ont un petit air misérable et
vieillissant, quand on n'y est pas habitué. Comme je l'ai déjà
dit, l'on voit moins qu'on n'interprète.
Nul doute que le Marmaty ne voie pas comme nous.
Il voit de la richesse où nous ne la voyons pas. Et devant les
grands immeubles de béton des villes modernes, les tubulures,
le plexiglas et l'aluminium, il serait saisi de compassion pour ceux
qui y vivent.
L'industrie
Les bâtiments ne sont non plus jamais très
grands dans le Marmat. Pour l'industrie, c'est plus sensible encore.
Ils ne la concentrent pas. C'est pourquoi aussi leurs voies de
circulations sont si peu développées. Ils préfèrent
produire sur place.
Les gains de productivité qu'apporterait la
concentration sont compensés par les économies de
logistique. De toute façon, le gigantisme industriel amène
toujours moins de productivité depuis le déclin du
fordisme.
En somme, le Marmat a toutes les apparences du
sous-développement. Elles sont finalement trompeuses. On
achète ici en moyenne à peu près une paire de
chaussures par an, mais si l'on sait qu'elles durent des années
sans réparation, et qu'il y a des cordonniers partout, on en
vient à se demander ce qu'ils en font.
Si l'on ne se laisse pas prendre au miroir aux
alouettes de l'économie de marché, le Marmat est plutôt
riche. Les gens sont bien vêtus, confortablement logés,
correctement nourris et en bonne santé. Ils sont aussi plutôt
cultivés, lettrés et ingénieux. Je ne crois pas
qu'ils seraient chagrinés s'ils savaient qu'avec leurs vestes
élimées et leurs cheveux en bataille, ils se feraient
refouler à l'entrée d'une boîte de nuit en
Europe.
Si l'on ne voit pas leur richesse, ce n'est pas
eux qui la cachent. Ils la connaissent très bien, et ne
demandent qu'à la faire connaître. Le nouveau régime
rêvait même de la négocier bon pris dans le marché
international. Leur véritable richesse, c'est leur force de
travail, c'est à dire leurs connaissances, leurs techniques et
leur ingéniosité.
Le nouveau régime ne comprenait en fait pas
mieux l'économie que l'ancien. Il voulait coter les bourses du
travail sur le marché mondial. Il semblerait que l'OMC ne soit
toujours pas parvenue à saisir ce qu'il entendait par là
— moi non plus d'ailleurs.
Ça ne dérangeait pas vraiment les
opérateurs internationaux que les ouvriers soient les
principaux actionnaires de leurs industries. Qu'ils soient organisés
dans des syndicats puissants aurait même pu les rassurer. Ce
qui littéralement les terrifia, c'est que les conseils
ouvriers se moquaient bien de leurs dividendes. Ils voulaient
posséder les actions pour imposer leur politique industrielle.
Le nouveau régime eut beau plaider qu'on ne
pouvait pas faire plus libéral, il ne tarda pas à
paraître pire que l'ancien aux yeux des investisseurs étrangers
qui avaient pourtant favorisé et salué son avènement.
Les bourses du travail
Dans la République du Gourpa, les bourses
jouent envers le travail un rôle similaire à celui des
marchés boursiers mondiaux envers ses produits. On y cote la
valeur du travail. Naturellement, on cherche aussi à
l'accroître, et l'on gère son marché à
cette fin.
Accroître la valeur du travail, cela ne peut
avoir qu'une signification : le même nombre de
travailleurs, dans le même temps, produit plus de richesses.
Une telle progression a nécessairement une série de
conséquences : soit on consomme plus de richesses, soit
on travaille moins longtemps, soit le nombre des travailleurs
diminue, et celui des chômeurs augmente.
Ces trois conséquences posent des
problèmes. Consommer plus de richesses peut revenir à
détruire celles de la nature. Travailler moins laisse ouvertes
des questions plus complexes encore.
Que fait un homme qui ne travaille pas ? Il
se distrait ? C'est à dire qu'il s'ennuie. Il est donc
fort probable qu'il choisisse plutôt de travailler encore. Il
cesse seulement de travailler pour gagner sa vie. Pour autant, son
ouvrage désintéressé ne sera pas sans incidence
sur le marché du travail.
C'est la fonction des bourses que de protéger
les richesses naturelles tout en empêchant qu'elles deviennent
la propriété de quiconque, et surtout de faire en sorte
que le travail gratuit participe à l'accroissement de la
valeur du travail, et non l'inverse.
Cette seconde question n'est pas des plus simples.
Prenons un exemple précis : vous écrivez un jeu de
scripts pour contrôler les espaces insécables quand vous
exportez en html à partir de votre traitement de texte. Il est
inutile qu'un autre ait à refaire le même travail, et
vous allez le laisser en téléchargement libre sur votre
site. N'allez-vous pas ainsi mettre sur la paille les programmeurs de
votre application ?
C'est un casse-tête, allez-vous dire. Ce
n'en est pas un pour les bourses du travail. Leur calcul est très
simple : Est-ce que ça permet d'atteindre le même
résultat avec moins de travail ? Dans ce cas, chacun
pourra y trouver son compte. Sinon, tout le monde y perd.
Il n'a pas fallu longtemps au nouveau régime
pour comprendre qu'il allait dans une direction opposée à
celle du marché mondial et des législations
internationales. Cette opposition est particulièrement nette
avec la politique énergétique.
Chacun sait que l'énergie est partout, et
qu'il suffit d'une simple dynamo sur la roue de son vélo pour
éclairer sa route. Il est donc plus avantageux pour les
bourses du travail de populariser les connaissances nécessaires
à l'extraction de l'énergie avec les moyens les plus
simples, que d'en faire un monopole étatique ou financier.
C'est en même temps un moyen de protéger les ressources
naturelles tout en accroissant la force de travail de chacun, c'est à
dire ses connaissances, ses aptitudes et son ingéniosité.
|