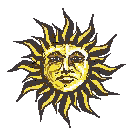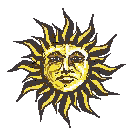Cahier XVII
Cinq jours dans la vallée de l’Oumrouat
Le 18 juin
Surpris par la pluie
La pluie nous a surpris en vue de la vallée
de l'Oumrouat. J'y monte avec Ziddhâ pour finir la semaine.
Les nuages ont surgi avec une étonnante
rapidité. Le ciel semblait pourtant se dégager à
la sortie de Bolgobol, et l'air était encore transparent quand
de grosses gouttes ont commencé à tomber. Maintenant
que nous grimpons la route en lacets qui conduit à la vallée,
ce sont des trombes qui noient l'asphalte et font déborder les
fossés. Je n'y vois presque plus rien derrière le
pare-brise.
« Rassure-toi, moi non plus »
me dit Ziddhâ. Cet aveu ne me rassure en rien et j'insiste pour
qu'on se gare sur le premier chemin de traverse. C'est sur le
terre-plein qui prolonge un virage que finalement elle s'arrête,
sous les branches d'un platane centenaire.
Le platanes ici n'est pas un arbre urbain comme en
Europe, où il a été tardivement introduit
d'Anatolie pour ombrager les boulevards et les places. Ici, il est un
arbre sauvage. Depuis l'antiquité, on l'a utilisé comme
bois d'œuvre, de bien meilleure qualité que le mélèze
ou le sapin.
Aujourd'hui, tous les conseils sont unanimes pour
limiter son usage par des réglementations draconiennes. Des
forêts entières ont disparu au cours des siècles,
et les meubles en platane sont devenus des objets de luxe, si ce
n'est des pièces de musée.
Des filets d'eau ruissellent sur le vieux tableau
de bord que la rouille a depuis longtemps commencé à
attaquer, et je ne sais où mettre mes jambes.
Ziddhâ est revenue à Bolgobol en
début de semaine. Elle est très liée à
Kouka. J'occupe la chambre où elle loge souvent pour rester
proche de l'université. Je leur ai proposé de retourner
à l'hôtel pour la lui laisser. Elle préfère
aller loger chez son ami Salmon qu'elle m'a présenté
l'an dernier, et dont elle paraît très proche aussi,
bien que la nature exacte de leur relation me demeure opaque.
Ziddhâ semble ravie que je m'entende avec
Kouka. L'idée m'avait traversé l'esprit que c'était
un habile moyen pour mettre une distance avec moi, d'entamer un
éloignement. À l'évidence, non.
La pluie crée une étrange torpeur
que ne dérange même pas l'eau qui coule sur mes jambes.
J'ai ôté mes chaussures pour les garder au sec.
La terre gorgée dégage des odeurs
envoûtantes. Elles se mêlent dans l'habitacle à
celle de ma pipe et d'une légère senteur d'essence.
Cette torpeur n'est pas celle des sens qui irriguent toute pensée.
Le 19 juin
Chez Ziddhâ
La maison est encore froide, bien que Ziddhâ
ait déjà chauffé la semaine dernière. Ses
murs de pierre épais, enfoncés dans la pente, gardent
longtemps la fraîcheur de l'hiver où elle demeure
inhabitée.
Les petits radiateurs électriques sont
pratiques mais peu efficaces. Nous avons fait un feu de bois.
Les mœurs du Marmat et la personne
Je comprends beaucoup mieux les mœurs du
Marmat que lors de mon premier voyage. Elles sont fondées sur
la personne.
La personne ici se définit moins par
l'appartenance à un groupe — l'individu, la partie
indivise du groupe —, que par sa relation à une autre.
Cette relation, on la possède. Voilà ce qui fait cette
différence, difficile à percevoir au début.
La relation entre Ziddhâ et Manzi, par
exemple, est moins cette amitié qui peut lier un professeur et
son élève, que celle entre maître et disciple.
Ziddhâ possède un maître en Manzi, et lui une
disciple.
On n'appartient pas à une famille, on
possède un enfant, un père, une mère, la sienne
ou celle de son enfant ; on n'appartient pas à une
entreprise, on possède un métier ; on n'appartient
pas à un parti, on possède une vision politique ;
et l'on se possède les uns les autres, ou plutôt ses
relations électives.
On possède, on n'appartient pas :
c'est plus absolu. De telles relations n'entrent pas en concurrence.
Aussi, ni on ne les montre, ni on ne les cache. C'est pourquoi on ne
les perçoit pas tout de suite.
Le 20 juin
L'homme et la terre
« Tu crois vraiment que l'évolution
de l'humanité va avec une diminution de la quantité des
objets dont elle s'encombre ? Interrogé-je Ziddhâ.
Un simple regard sur l'histoire tendrait à accréditer
le contraire. »
Cette idée qu'elle vient de me développer,
ce n'est pas la première fois que je l'entends dans le Marmat.
Bien des populations qui se sont fixées dans la région
sont d'origine nomade. Les Huns, les Mongols d'un côté,
les Arabes de l'autre, ont souvent été pris pour
modèle, laissant imaginer une évolution possible, voire
souhaitable, vers le dépouillement et la mobilité.
Une telle conception du progrès suppose
qu'il ne soit pas uniforme ni constant, et qu'il soit contrebalancé
par le concept inverse de « régrès ».
C'est en effet un néologisme que j'ai souvent entendu ici
employer en anglais : regress. L'humanité régresse
en s'encombrant d'objets inutiles, en s'y attachant et s'y
immobilisant.
Il est évident qu'un simple regard sur
l'histoire convainc aussi bien que l'humanité régresse
presque aussi souvent qu'elle progresse ; que les civilisations
s'élèvent, avancent fièrement comme des vagues
sur une grève en laissant croire qu'elles vont tout submerger,
puis se couchent et refluent lamentablement. Pourtant l'ingéniosité
humaine finit toujours par avancer, emportant l'obstacle où la
dernière vague s'était brisée. Ziddhâ
n'affirme pas le contraire.
— En tout cas, si l'on veut se
débarrasser des vains objets pour courir les chemins, ce n'est
pas difficile, dis-je.
— Détrompe-toi, Jean-Pierre.
Créer un monde où la circulation des hommes soit plus
libre, comme l'ont fait Attila, Taramana ou Gengis Khan, impose de
grands progrès technologiques, sinon ce serait perdre la
civilisation, les lettres, les arts, tout.
Voilà un point de vue très
intéressant que personne ne m'avait encore énoncé
clairement. Ziddhâ m'a l'air d'avoir des idées bien
précises à ce propos, et je me demande d'où elle
les tient. Ma question la laisse songeuse. Quand je m'attendais à
entendre le nom et les ouvrages d'auteurs dont j'ignorais
l'existence, elle me cite son père, Razzi.
Razzi
Razzi semble avoir pour sa fille un grand
prestige. Je m'en étais déjà aperçu l'an
dernier, et je m'en inquiétais un peu lorsque j'ai dû le
rencontrer. Il est vrai que l'homme ne manque pas de prestance, de
culture et d'énergie. Il est l'un des responsables du syndicat
des mineurs de l'Oumrouat.
Il m'avait impressionné en tenant tête
à l'imam Fardouzi dans une querelle sur l'avéroïsme
et la tradition aristotélicienne. C'est à cette joute à
laquelle Tai-mo faisait allusion dans son courriel en la comparant au
combat de la grue et du serpent.
Razzi, lui, a un type caucasien, c'est de sa mère
que Ziddhâ tient ses yeux légèrement bridés.
Feux au crépuscule
La pluie récente est une bonne occasion de
nettoyer les herbes folles et les ronces sans danger. Coupées,
on les met en tas pour les brûler.
Quand tombe la fraîcheur du soir, on se
rapproche des foyers qui crépitent. En longues langues, la
fumée trace des arabesques entre les derniers rameaux encore
verts. Laiteuse, elle est par endroits parcourue de tons roux
lumineux.
Des corneilles tournoient encore très haut
au-dessus d'elle. On se hâte pour finir avant la nuit.
Le 21 juin
À l'aube
Un chat du voisinage, comme la veille, attend le
soleil devant la maison. Il tourne la tête vers moi, méditatif,
quand je m'assois près de lui. Il repose sur son fessier, les
pattes antérieures tendues.
Des brumes courent dans l'étroite plaine
qui s'étend vers l'est, et font comme des coups de gomme sur
la pente boisée au-delà de la rivière.
Il fait froid, et c'est à peine si le
soleil réchauffe quand il tombe sur nous. Le chat regarde
d'une curieuse façon, déplaçant légèrement
la tête d'un point lointain à l'autre.
Lorsque ces animaux nous regardent, on se dit
quelquefois qu'il ne leur manque que la parole. Quand on regarde
ensemble la même chose, on se dit que non.
Lecture d'Ibn Khaldoun
Quand Ibn Khaldoun rencontra Timour Lang, ils
avaient tous deux passé les soixante-dix ans. Les deux Hommes
se séduisirent par leur savoir, leur sagesse et leur regard
sur le monde.
Ibn Khaldoun venait d'une vieille famille
bourgeoise de la lointaine Espagne, élevé dans l'or et
la soie. Il aimait pourtant la compagnie des nomades dont il finit
par partager la vie, et le galop des chevaux. Il était trop
vieux quand les Mongols entrèrent en Syrie pour fuir aussi
vite que ses compagnons arabes. Il fut pris et fit ainsi la rencontre
qui paraît, à le lire, la plus importante de sa vie.
Ibn Khaldoun et Timour Lang avaient sans se
connaître une conception très voisine de la
civilisation, qu'ils voyaient comme un foyer allumé par les
étincelles des sabres.
Timour Lang était musulman, bien que sa
mère fût chrétienne et son grand-père
bouddhiste. Les deux hommes étaient instruits. Ils étaient
pourtant si différents, originaires de mondes si éloignés
et dans des camps ennemis, qu'il est quand même étonnant
qu'ils aient partagé des visions si proches.
Quand le ciel a créé le temps, il
en a fait suffisamment
Dans le village à l'entrée de la
vallée, à trois ou quatre kilomètres du hameau
de Ziddhâ, je me suis réfugié au petit bar
ombragé. Il me plaît de savoir qu'où je suis,
personne ne saurait me trouver.
Un homme nettoie la rue avec une majestueuse
lenteur. Il s'interrompt perpétuellement pour échanger
quelques mots avec chaque passant. Je pense à la phrase du
maçon, l'autre jour, chez Kouka.
Le 22 juin
L'histoire considérée d'un point de
vue végétal et social
La petite maison est bien ensoleillée sur
l'adret de la vallée de l'Oumrouat, un peu à l'écart
du hameau Al Tawil. La source qui jaillit au pied de la bâtisse
alimente un rideau de verdure qui la cache largement au regard. On la
voit surtout de l'autre côté de la plaine, où son
toit d'ardoise domine les autres.
Noyers, tilleuls, cognassiers ombragent des
framboisiers et des ronces couvertes de mûres. On trouve des
mûriers blancs aussi. Ils ont été introduits dans
le Marmat pour nourrir les vers à soie dont l'élevage
s'est pratiqué dans tout le sud du pays. Beaucoup de petites
magnaneries sont aujourd'hui en ruine.
Le secret de fabrication de la soie fut volé
aux Chinois, et les vers aussi. Ce ne fut pas une mince affaire que
d'acclimater ces fragiles animaux dans la région.
Je ne pense pas qu'il y ait un autre cas où
cette précieuse technique ait été dérobée.
Partout ailleurs, je crois, elle fut introduite par les Chinois
eux-mêmes — je me demande encore pourquoi.
C'est sous François Premier que des
ingénieurs vinrent dans le sud de la France installer des
magnaneries et former leur personnel. Ils offrirent même les
dispositifs d'impression des tissus. La faïence aussi fut
introduite, et la décoration provençale traditionnelle
reste profondément imprégnée de celle de la
Chine des Ming. Pourquoi les Chinois choisirent-ils de transférer
leur technologie en France ? Qu'y gagnaient-ils ?
Qu'obtenaient-ils en échange ?
Le commerce de la soie et de la faïence, il
est vrai, enrichissait moins les producteurs que les négociants
des empires du grand Mogol et des Ottomans, plus soucieux jusque là
d'écraser l'Europe que d'y ouvrir des marchés. Il
valait peut-être mieux produire en France sous licence
chinoise.
Ce coup de pouce extrême-oriental fut
fondateur pour la France qui, soyons sérieux, n'existait pas
avant. Son territoire actuel était une mosaïque de
féodalités suzeraines des Plantagenets d'Angleterre, du
duché d'Auvergne et des Flandres, de la couronne de France, de
princes italiens ou de Rome. La guerre de religion qui s'en suivit
fut la véritable fondation de la France, et sa rupture avec le
Saint Empire autant qu'avec les Hauts Alliés
d'Angleterre et de Hollande, bien que les deux camps restassent
longtemps présents dans le royaume unifié.
Le résultat ne se fit pas attendre :
dès la fin du seizième siècle, des grèves
pour les huit heures éclatèrent dans les magnaneries de
la région d'Alès. La lutte ouvrière moderne
naissait, que les Chinois bien plus tard acclimatèrent à
leur tour chez eux aussi facilement que le ver à soie dans le
Midi.
Il y a aussi quelques poiriers plus bas sous le
jardin. Les poires ne sont pas mûres. Elles ne deviennent pas
bien grosses de toute façon, et restent dures et vertes. Je
les aime ainsi. Elles avaient une saveur délicieuse l'an
dernier quand je les ai goûtées.
On appelle mûre la baie qui est le
fruit de la ronce, ou mûre sauvage. Le framboisier est
une espèce de ronce cultivée. Le mûrier, lui, est
un arbre ou arbuste des régions tempérées de
l'Asie et de l'Amérique, à suc laiteux et à
feuilles caduques. Il existe des mûriers blancs et des noirs.
Ce sont les feuilles des mûriers blancs qui nourrissent les
vers à soie. On appelle aussi mûre le fruit du
mûrier, il ressemble à celui de la ronce.
Tous ces végétaux font partie de
l'ordre des rosacées, famille de plantes dialypétales
à nombreuses étamines, généralement
pourvues d'un double calice, comme le rosier et la plupart des arbres
fruitiers des régions tempérées (cerisier,
pêcher, poirier, cognassier, prunier...).
|