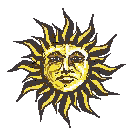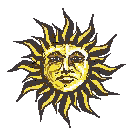Cahier XII
Du Darmir à Bolgobol
Le 29 mai
Le tombeau du Christ
Le tombeau du Christ n'est qu'un rocher. Il n'y a
rien, seulement un petit lac glaciaire. Ce n'est même pas un
rocher particulier. Il y en a partout, de plus gros, de plus beaux.
Il n'émeut d'ailleurs pas particulièrement mes
compagnons de voyage. Certains grimpent dessus pour regarder
alentour, d'autres envoient vite quelques prières comme on
écrirait des cartes postales.
Hammad a sorti son tapis et fait ses
prosternations vers la Mecque. Gouradyyâ et Sora s'embrassent
seulement. Et sans autre cérémonie, on s'occupe du
repas. Nous mangerons ensemble au bord du ruisseau.
« Partout où des hommes
s'assembleront en mon nom, je serai avec eux » dit
quelqu'un en Palanzi. Hammad et Ziddhâ me traduisent
immédiatement la phrase à l'oreille : en français
pour la droite, en anglais pour la gauche. Évidemment, en
voyant les choses ainsi, il n'est pas réellement utile de
faire une affaire d'un rocher, d'y élever un mausolée,
ni même de vérifier si l'on trouverait des ossements
enfouis sous lui.
Je me rends compte, maintenant que nous partageons
notre repas, que j'ai été moins seul dans cette marche
que je ne l'ai d'abord senti. J'ai été avec les autres,
dans la mesure où ils m'ont permis d'être seul avec eux.
Aristote disait dans ses Politiques qu'il
existe des animaux sociaux et des solitaires ; l'homme est les
deux. J'en viens à penser à l'étymologie du mot
Umma (communauté des fidèles, si l'on veut).
« Dis-moi, Hammad, toi qui es savant, »
lui ai-je demandé en lui prenant des mains le plat qu'on fait
tourner, « Umma pourrait se traduire littéralement
en français par Matrie. Pourquoi pas Patrie ? »
« Même les longues marches ne te
fatiguent pas de poser des questions ? » m'a-t-il
répondu en nous servant de l'eau fraîche.
Le premier juin
Un rêve
Hammad me semble changé depuis son
pèlerinage sur le tombeau du Christ. Je le trouve plus songeur
et moins loquace. « J'ai fait un rêve curieux dans
la vallée du Bénarophon, » me confie-t-il.
Depuis une heure il est assis près de moi à
la barre à regarder silencieusement l'horizon vers lequel la
perspective étire démesurément les grands
nuages. C'est aussi exactement ce que je fais moi-même.
« Au fond de la vallée, »
continue-t-il, « des soldats barraient un chemin qui
venait des cimes. Ils portaient des turbans verts et des barbes
fournies. Ils paraissaient nerveux. Et il y avait ces paroles :
La peur descend de la montagne. »
« Comment cela : il y avait ces
paroles ? Les as-tu entendues, ou les as-tu lues ? lui
demandé-je surpris par la formule. « Ni l'un, ni
l'autre », me répond-il. « Je ne saurais
même pas dire en quelle langue elles étaient énoncées,
ni même si elles l'étaient en une particulière. »
Me voyant demeurer songeur, il ajoute :
« C'est bien ce qui me trouble dans mon rêve. »
Depuis que nous faisons route ensemble, je me suis
demandé si j'étais bien le compagnon qu'Hammad devait
rencontrer pour faire avec lui ce pèlerinage. Comme si ses
dernières paroles lui avait fait pressentir mon doute, il me
rassure : « Ce n'est pas sans raison que Dieu, gloire
à Lui ! t'a placé sur ma route avant de m'avoir
inspiré ce rêve. »
« Et que te dit ce rêve ? »
l'interrogé-je. « La kataba (Il n'écrit
pas). » Me répond-il sans détour. Je reste
silencieux en me demandant ce que peut signifier une telle
affirmation pour un fidèle de la Religion du Livre.
Le 3 juin
À Amkhûra
Hier soir nous sommes allés danser. Des
quantités de petits restaurants font bal le soir à
l'estuaire de l'Ardor. Tout y paraît extrêmement
improvisé. Des musiciens quittent l'orchestre pour se lancer
sur la piste, d'autres viennent jouer, ou encore chanter, apparemment
de leur propre initiative.
On ne danse pas en couple, du moins pas tout à
fait. Les hommes se placent d'un côté, les femmes de
l'autre, et tous se mêlent et se retrouvent sur un rythme
plutôt sauvage. Comme dans toutes les danses traditionnelles,
les couples se mélangent et se retrouvent. On a l'occasion de
prendre le bras de nombreuses cavalières.
Je suis surpris que Hammad nous ait amené
là. Peut-être ne savait-il pas, quand nous sommes
arrivés, que le restaurant faisait bal dans la nuit.
Ce sont des jeunes gens, malgré quelques
danseurs d'âges murs, qui tournent autour de nous. Je trouve
que nous avons l'air, Hammad et moi, de sévères barbus,
avec nos habits traditionnels, alors que la plupart des danseurs ont
des vêtements européens, parfois de travail. L'estuaire
de l'Ardor est un quartier pauvre.
Il me dit que l'un des airs vient d'une danse de
guerre des Grecs. Elle ne se pratiquait alors qu'entre hommes. Je lui
apprend que la bourrée occitane vient aussi d'une danse
guerrière des Grecs.
La voix de la chanteuse, sans paraître
forte, emplit complètement la nuit qui nous enveloppe. Bien
sûr, elle chante sans micro. Il n'y a pas non plus d'éclairage
électrique, seulement les flammes des torches, dansantes elles
aussi.
Six heures dix-sept
Aube glacée dans la gare d'Amkhûra.
En route
Nous rentrons en train. Mes compagnons se sont
endormis sur les banquettes après la nuit que nous avons
passée à danser. Je tiens mon journal à la
plume. J'aime écrire dans les trains. Celui-ci remue beaucoup
et rend l'exercice difficile. Je m'applique à épouser
de mon corps tout entier les soubresauts de la voiture. Ce train
n'est ni le Corail, ni le TGV de chez moi. Il me rappelle
plutôt les vieilles michelines de mon enfance.
Dans l'étroite plaine de la vallée
de l'Ardor, des fumées s'élèvent. C'est la
saison de brûler les herbes folles qui foisonnent. On en sent
la fumée. Je suppose que nous allons bientôt rattraper
les nuées d'étourneaux qui emplissaient le ciel de
Tangaar.
Je pense au rêve de Hammad. Si pour lui Dieu
n'a pas élu de nation, ne s'est pas donné de fils et
n'écrit pas, il doit y avoir beaucoup d'idolâtres à
ses yeux sur la terre.
« La peur descend de la montagne. »
Cette phrase me trouble. Moi, je pense immédiatement au
vertige, qu'en bon montagnard il ignore.
J'ai offert mon dépôt aux
mers et aux montagnes.
Elles ont tremblé sous ce
poids.
Je me demande pourquoi la langue française
met « mer » et « montagne »
au féminin. Je ne trouve rien de féminin aux monts
enneigés que j'aperçois derrière la vitre. Dans
la plupart des langues que je connais, le mot qui désigne la
mer est masculin. « Eau », « vague »...
ces féminins en français posent souvent des problèmes
de traduction.
Conversation avec Hammad
Hammad : Ce que disait Ziddhâ l'an
dernier en revenant de Bor Argod est très intéressant.
(Voir À Bolgobol cahier
30.)
Moi : Je me souviens que nous avons parlé
de montagne et de vertige, et de bien d'autres choses.
Hammad : Elle disait que les religions
étaient des langages de haut niveau, par opposition à
ceux des mathématiques et des logiques. En est-elle arrivée
seule à cette conclusion ? L'a-t-elle appris quelque
part ? Ou peut-être le lui as-tu soufflé ?
Moi : Je n'avais jamais entendu une
telle proposition nulle part avant. Elle est un peu une conclusion
implicite de sa thèse : Matérialisme et
langage. Il est vrai que Luther disait déjà que
« la théologie est la grammaire du mot Dieu ».
Hammad : Il est pertinent de distinguer
ainsi le langage de l'expérience à laquelle il sert.
« Pour le moins, ça régénère
le sens du mot conversion », plaisanté-je.
« Le problème demeure de savoir en quoi expérience
et langage s'induisent mutuellement », ajoute-t-il
songeur.
« Voilà encore une remarque
pertinente, Hammad. Ce qui divise le plus âprement les hommes,
c'est moins la diversité des langages ou encore de leurs
expériences, c'est le rapport qu'ils établissent entre
les deux. »
« Je ne donne pas beaucoup d'importance
à l'accord ou au désaccord, me répond-il. Je
suis plutôt convaincu que, quelle que soit la pertinence d'un
point de vue — et qui de toute façon devient
trompeur si on cherche à en boire les conséquences
jusqu'à la lie —, une infinité d'autres sont
possibles qui peuvent révéler d'une même chose
des aspects nouveaux et intéressants. »
« Ne regrette pas ces divisions,
continue-t-il. Il serait vain sinon que nous soyons si nombreux. Le
vrai problème est moins celui du rapport que nous établissons
entre les langages et les expériences, qu'entre ce rapport
lui-même et le réel. »
Je réfléchis un moment avant
d'ajouter, autant pour lui que pour moi-même : « Un
double rapport donc... »
Retour en territoire connu
Nous allons cette fois passer par le grand pont de
Borg Ar Panzi. Le train n'est guère plus rapide que le car
pour se rendre à Bolgobol, avec ses innombrables détours.
La vue sur les gorges du Panzir s'étend sur
des kilomètres, jusqu'aux chutes. De l'autre côté
de la voie, j'ai le temps de reconnaître la maison de Manzi. De
la fumée s'élève du jardin. Je serais pourtant
surpris qu'il ne soit pas à Bolgobol aujourd'hui : les
gens d'ici ne cessent de se prêter des clés.
À Borg Ar Panzi, le seul endroit d'où
l'on ne voit pas le pont, c'est sur lui. L'agglomération
paraît moins grande d'ici. Les habitations s'étirent
très loin sur la côte qui s'évase à partir
des gorges, au pied de la centrale électrique. Elles sont bien
plus clairsemées qu'elles ne le paraissent d'en bas.
La voie ferrée décrit un large arc
de cercle avant de rejoindre le pont, bien au-dessus de la route où
je suis passé l'an dernier. On y distingue alors très
bien les canalisations en à-pic du barrage à l'entrée
des gorges. Une sorte de chemin couvert en béton et en pierres
parcourt horizontalement la falaise d'où descendent droit deux
gros tuyaux à partir de ce qui paraît être une
salle de contrôle en saillie sur le vide.
Ces constructions épousent si bien la
roche, que la grandeur sauvage du site se mêlant à
l'architecture humaine produit quelque chose d'hybride. Il en résulte
une impression comparable à celle qu'on éprouve d'en
bas, dans le contraste du village tranquille et du pont gigantesque.
C'est comme si ce caractère était définitivement
inscrit dans le lieu, ou du moins, dans son union intime avec les
hommes qui l'ont façonné.
Nous passons encore sur un pont, plus classique
celui-ci, mais très haut, en face des fortifications du col du
Balgar, avant de pénétrer dans le tunnel. Nous ne
sommes plus loin maintenant de Bolgobol, et le jour baisse déjà.
La gare est de l'autre côté de la
ville, au-dessus d'une zone industrielle. Le train passe par une
série de ponts et de tunnels avec une lenteur exaspérante
qui n'atténue en rien les chocs. Les étourneaux sont
bien là. Bruyants, ils volent en tous sens entre les toits sur
le ciel qui rougeoie.
Ces arrivées en train provoquent toujours
un curieux état d'âme.
Le 4 juin
Retour à l'hôtel
Nous étions trop fatigués hier pour
manger ensemble. Je suis rentré directement à l'hôtel,
où j'ai fait monter un repas dans ma chambre pendant que je
branchais mon ordinateur et relevais mon courrier, puis je me suis
couché sans le lire.
Ce matin, en ouvrant mes volets, le chat de
l'hôtel courrait sur la terrasse avec un étourneau dans
la gueule.
Le soleil était déjà haut et
j'avais faim. Le chat a dû le sentir, car il s'est enfui
vivement avec sa proie comme si j'allais la lui prendre.
Après-midi
Cet après-midi, je me suis amusé à
reproduire avec mon modeleur de paysage l'île de Copharnagh, où
nous avions accosté en nous rendant dans le Darmir. Je
repensais en même temps au rêve de Hammad, à nos
conversations sur les langages et à mon vertige en montagne.
« Je me demande comment tu fais pour
évaluer si bien les distances sur la mer » m'a
demandé Hammad quand nous voguions sur le chemin du retour,
« et comment tu parviens à t'orienter sans
repère. » Que fait-il du soleil, de l'ombre, de la
lune et des étoiles ?
J'ai reconstitué l'île de mémoire
en me servant de mes notes. Non sans mal, j'ai retrouvé la
texture du basalte, fendu la falaise à la souris, étiré
le cône de déjection, modelé les alluvions
sableuses. Il s'en dégage pourtant une impression tropicale
d'île de pirates, étrangère au lieu réel.
La mer d'Argod dégage des impressions très
différentes de celles de la Méditerranée, qui
m'ont profondément envahi mais que je n'arrive pas à
rendre.
Il paraît évident que dans les
régions montagneuses, chaque lieu soit facilement
identifiable. Les reliefs sont si différents, les roches si
diverses, leurs plissements, leurs failles, leurs glissements, si
variés. D'où qu'on se trouve, on reconnaît
toujours quelque cime bien caractéristique, et surtout toutes
ces convulsions demeurent figées dans la matière
minérale. Pourtant, l'angle de vue modifie à ce point
les paysages, qu'ils deviennent méconnaissables et qu'on se
perd facilement, alors que sur l'eau, au contraire si mouvante, les
lieux sont étonnamment plus reconnaissables.
D'infimes écarts dans les températures
entre l'air et la mer, ou dans les directions des vents, produisent
d'autres luminosités. Le moindre endroit sur la mer change
perpétuellement d'apparence, et pourtant on le reconnaîtrait
entre tous, malgré la forme toujours renouvelée des
nuages, l'incessant changement d'intensité de l'azur, les
bruits toujours nouveaux. Peut-être Hammad ne perçoit-il
pas tout cela, les sens saturés par trop d'impressions neuves.
La mer n'a pas d'histoire : tout ne fait qu'y
glisser ou bien est englouti. Et la nuit, c'est le cosmos entier qui
se reflète dans l'eau noire. Pourtant le point particulier où
l'on se trouve ne ressemble a nul autre tout en n'étant jamais
le même. Ô Seigneur des eaux mêlées !
l'immobile se disperse et le mouvement demeure.
Je me demande encore, dans le rêve de
Hammad, ce que signifiaient ces soldats enturbannés et barbus.
Qu'était cette route ? Où conduisait-elle ?
Comment la barraient-ils ? Qu'est-ce qui les rendait nerveux ?
Et que signifiaient ces paroles « la
peur vient de la montagne » ? Comment pouvaient-elles
être ni dites, ni écrites, ni faites de lettres, ni de
phonèmes, et peut-être dans aucune langue particulière ?
Le plus curieux est que tout cela se réduisait
pour Hammad dans une simple formule : la kataba (Il
n'écrit pas), comme on résout de longs calculs dans une
simple équation.
Kouka m'a invité chez elle
Après une nuit et une matinée de
sommeil, Ziddhâ est partie dans la vallée de l'Oumrouat
chez son père. Elle a beaucoup de travail en retard, n'ayant
pratiquement rien fait pendant tout le voyage avec moi, bien qu'elle
en ait eu le temps, au moins dans la felouque.
Kouka est passée me voir en fin
d'après-midi à l'hôtel. Elle m'a invité à
dîner.
|