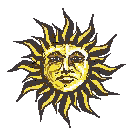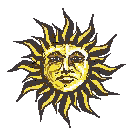Cahier X
À propos de temps et de musique
Le 26 mai
Un barbare en Asie
Mon pêcheur n'est toujours pas rentré.
L'un de ses fils m'assure que je peux continuer à me servir du
voilier. J'ai alors pensé convoyer Hammad et sa femme pour la
dernière partie de leur trajet.
Je tiens à payer la location, mais le fils
s'y refuse. Comprenant qu'ici les négociations financières
se mènent d'une façon tout opposée à ce
qui se pratique presque partout ailleurs sur la planète,
j'insiste jusqu'à ce qu'il cède, après avoir
toutefois sensiblement diminué la somme que je proposais.
Dans son ouvrage Un Barbare en Asie, Henri
Michaux écrivait : « Au dix-huitième
siècle, un grand auteur chinois se creusa la tête. Il
voulait un récit absolument fantastique, brisant les lois du
monde. Que trouva-t-il ? Ceci : son héros, sorte de
Gulliver, arrive dans un pays où les marchands essayaient
de vendre à des prix ridiculement bas, et où les
clients insistaient pour payer des prix exorbitants. »
Finalement, son auteur était peut-être
bien venu voyager dans la région, au-delà du Turkestan.
Le temps, la durée et le tempo
Nous allons donc embarquer tous les quatre vers le
Darmir. Ziddhâ et moi laisserons ensuite nos pèlerins
finir seuls leur voyage et nous les attendrons pour le retour. Enfin,
peut-être, car Hammad est bien incapable de me donner une date.
« Ne nous attendez pas si vous voulez
rentrer. » Est-ce parce qu'il ne souhaite pas vraiment
notre présence ? Je le comprendrais sans m'en vexer,
compte tenu du caractère spirituel de leur voyage. Pourtant je
ne le crois pas. Il me le dirait sans autre manière. Il ne
veut pas se fixer de temps.
Pour une raison ou pour une autre, dans le Marmat,
on sait quand on est parti, on ne sait jamais quand on va arriver. Il
est très dur d'avoir un emploi du temps serré.
L'ordinateur personnel rend alors de très grands services, et
je suppose que ce n'est pas la moindre raison de son succès
ici. Avec l'ordinateur personnel et l'internet, il n'est plus
nécessaire d'avoir ses proches, ses collaborateurs ou ses
compagnons sous les yeux.
L'internet a largement pris la place du téléphone
filaire, qui était déjà bien développé.
Le téléphone portable, lui, est presque totalement
ignoré. On n'a pas ici un caractère à aimer être
dérangé. On sait que chacun trouvera l'occasion de
relever quotidiennement son courrier, et c'est bien mieux que de
l'interrompre quoi qu'il fasse, le réveiller ou le sortir de
la douche.
On n'a même pas tenté ici de
découvrir combien le temps perdu au téléphone
peut devenir vertigineux. C'est en réalité moins du
temps comme durée, que le temps comme tempo, comme rythme,
comme mesure qui est le plus cruellement détruit. (Que serait
la durée sans la mesure ?)
Restez longtemps à portée de
sonnerie, et vous verrez que le téléphone ne tarde pas
à défaire le schème spatiotemporel sur lequel se
trame votre rapport au réel. Votre appréhension de ce
qui compte ou non à vos yeux, des causes ou des effets
lointains ou proches, et même votre capacité de
réflexion ou votre attention perpétuellement
interrompue, se brisent.
Le contenu d'une conversation téléphonique
est généralement faible pour une durée
excessive. On parle souvent plusieurs minutes pour ce qui s'écrirait
en trois lignes, et je crois que personne ne saurait dire au combiné
ce qu'il pourrait rédiger en un feuillet.
Le pire est que l'intoxiqué finit par ne
plus savoir lire. « passez-moi un coup de fil que l'on se
voit » m'a-t-on parfois répondu à un
courriel dont le texte et les pièces jointes étaient
parfaitement circonstanciés.
Je ne crache pas volontiers sur une occasion de
trinquer, mais il ne s'agit jamais de cela. Je sais aussi qu'il est
toujours possible de meubler une conversation, ou d'impressionner son
interlocuteur par de belles paroles. Il l'est beaucoup moins
d'aligner des phrases par écrit quand on n'a rien à
dire, ni quelqu'un en face de soi dont on guette les réactions,
et dont on sait qu'il pourra relire et réfléchir.
Je reçois chaque jour des dizaines de
courriels. Quelques-uns sont de la publicité que je peux jeter
sans lire. Le reste est très largement constitué
d'informations ou de débat qui n'attendent pas de réponses
particulières. Dans le cas inverse, quelques mots suffisent
qui ne demandent pas de longues réflexions. Sauf pièces
jointes volumineuses, lentes à transiter, cela s'expédie
en un quart d'heure.
Seuls quelques rares messages m'entraînent à
des lectures, des réflexions et une rédaction longues
et attentives, que je dois parfois étaler sur plusieurs jours.
Voilà ce dont l'usager du téléphone finit par se
rendre incapable.
La transmission de données à la
vitesse de la lumière ne peut faire oublier que le temps de
recherche, de réflexion et d'écriture est à peu
près incompressible. Justement, il n'est pas qu'une durée,
il est aussi un mouvement, un rythme, une mesure, qu'il n'est pas
avisé d'interrompre.
Il n'est pas recommandé de relever son
courrier quand on songe à quelque autre chose, ou encore
lorsqu'on s'apprête à se coucher. Une impression
désagréable et déstabilisante peut advenir que
l'esprit se brise et s'éparpille dans la multitude de propos
et de préoccupations parcellaires.
Il est à l'inverse des moments où
cette diversité nous renforce, relativisant au contraire les
trop nombreuses sollicitations, nous ramenant à nous-mêmes
qui en sommes le pivot, et nous unifiant davantage.
Oui, je suppose que ce n'est pas notre présence
qui troublerait Hammad dans son recueillement ; seulement la
perte de son temps, de son tempo.
Cofarnagh
« Il n'y a jamais eu de chevalerie dans
le Marmat, Jean-Pierre. » M'assure Hammad. « Ton
hôte a dû s'amuser de toi. »
Pourquoi rien n'est-il jamais simple et clair, et
ne peut-on jamais être sûr de rien ? A-t-il
seulement existé une chevalerie en Europe ? Et qu'est-ce
que cela pouvait-il bien vouloir dire ? « La
chevalerie est d'origine romaine, continue-t-il. Tu devrais le savoir
mieux que moi. »
Nous avons accosté en fin d'après-midi
sur l'île de Cofarnagh, à mi-chemin entre les deux
rives, et nous allons y passer la nuit.
« Les chevaliers romains étaient
des patriciens, » reprend-il en ramassant du bois sec près
de moi pendant que je vide les poissons. « Ils possédaient
leurs chevaux et s'équipaient à leur frais pour la
guerre. C'est toi-même qui me l'a appris l'an dernier, en me
parlant de ce chevalier marseillais qui était aussi un
philosophe stoïcien venu en Orient. » (Voir À
Bolgobol Cahier
31)
Lui ai-je vraiment dit cela, dont je ne me
souviens plus, et ne suis plus du tout sûr ? « Alors
pourquoi Attila a-t-il passé des années à Rome
pour y enseigner la tactique de cavalerie ? Demandé-je.
« Ça ne prouve rien » me répond-il.
Je l'admets
« L'histoire est insondable, »
ajoute-t-il en marchant avec moi vers les femmes qui ont ramené
du bateau des condiments et des couverts. « Comme une
image fractale, son dessin change selon la distance à laquelle
on la regarde. Il n'y a aucune limite en un sens comme dans l'autre.
Il n'y a donc aucun point d'où nous pourrions voir l'Histoire
vraie. »
L'île de Cofarnagh n'est pas bien grande :
à peine plus d'une centaine d'hectares. On arrive de l'est en
face d'une falaise de basalte sombre fendue par le milieu, d'où
un petit torrent tombe en chute.
Devant elle, un large cône de déjections
datant du pléistocène s'avance sur la mer, traversé
par une incision torrentielle. Nous avons accosté là
pour profiter de l'eau douce, ignorant le village, invisible d'ici,
sur l'étroite plaine côtière plus loin au
nord-ouest.
Où le cours d'eau rejoint la mer, les
courants ont dessiné une petite crique sablonneuse. Nous y
avons échoué le voilier.
Croire aux faits
« C'est surtout, dis-je en l'aidant à
allumer le feu, que l'histoire est moins celle des événements
que des rêves qui les ont suscités, et des nouveaux qui
les programment. Les historiens croient souvent qu'ils vont découvrir
l'histoire véritable derrière les textes qui en
témoignent. Mais il n'y a rien derrière, sinon des
faits bruts et dépourvus de sens. Dans le meilleur des cas, on
découvrira des techniques, mais il nous manquera la trace des
cheminements de l'esprit qui les auront fait émerger. Pour
comprendre l'histoire, on doit cesser de croire aux faits. »
« Aux fées ? »
s'étonne Hammad.
Dans la République Tasgarde, les richesses
appartiennent aux femmes
Dans la République Tasgarde, la plus grande
partie des richesses est possédée par les femmes. C'est
surprenant : les hommes ne possèdent presque rien. Ils
habitent chez elles et, s'ils doivent se séparer, ils quittent
le domicile les mains vides, peut-être avec leur voiture, leur
vélo ou leur cheval.
Ils ne se retrouvent pas pour autant à la
rue. Tous les hommes ont un toit quelque part : garage, atelier,
magasin, bureau, laboratoire... où ils ont installé un
coin habitable dans une dépendance ou une mezzanine. Ils ont
aussi parfois des foyers collectifs près de leur entreprise,
souvent aussi des lieux loués à plusieurs. Ils y ont
leur établi, leur fusil, leur canne à pêche, leur
ordinateur...
Ils en sont rarement propriétaires. On ne
sait la plupart du temps à qui ces lieux appartiennent. Ils
les louent à plusieurs, se les prêtent, s'hébergent
dans leurs déplacements, en changent...
Mon hôte n'était pas une exception.
Ce sont généralement les femmes qui héritent les
biens immobiliers à leur mariage, créant ainsi une
transmission matrilinéaire des biens. Hammad lui-même
habite chez Jamila et a gardé un pied-à-terre attenant
à la mosquée de sa vallée. Nous avons été
logés chez elle l'an dernier.
Cette manière de vivre s'est fortement
accentuée chez les deux dernières générations.
Elle est un retour aux modes de vie traditionnels. Les hommes d'ici,
et peut-être d'ailleurs, ont toujours été attirés
par des activités et des mœurs collectives. Les femmes,
elles, sont plus préoccupées de leur confort ménager
et de leur propre progéniture. Il en résulte à
la fois un renforcement des différences entre les sexes et une
relative égalité.
Cette dernière avait commencé à
être menacée par un mode de vie qui s'occidentalisait
depuis le dix-neuvième siècle. Il donnait une
importance démesurée au couple tout en faisant de
l'homme le chef absolu du ménage, détenteur de tous les
droits et de tous les biens, tout en le dépouillant de ses
penchants virils.
La seule propriété qui intéresse
réellement un homme est celle de ses moyens de production,
c'est à dire celle qui garantit un pouvoir et détermine
la nature de celui-ci. Si un tel pouvoir s'exerce sur d'autres
hommes, il génère au moins autant de dépendance
pour qui en profite que pour qui le subit. Ici, comme ailleurs sans
doute, les hommes ont plutôt le goût d'accroître
leur pouvoir commun sur le monde, de s'entraider et d'élaborer
des projets trop ambitieux pour l'individu seul.
Les rapports amoureux viennent opportunément
leur rappeler qu'ils sont des personnes à part entière
et les prévenir de s'oublier dans une entité
collective. En même temps, ces amants qui leur échappent,
guérissent les femmes de la morbide fascination que ne manque
d'exercer sur elles un enfant.
La Perse et la Grèce
Les Perses conquirent la Grèce d'Orient. La
conquête de la Perse par Alexandre était tout aussi
bien, n'en soyons pas dupes, la conquête complète de la
Grèce par les Perses. Alexandre se fit pour l'essentiel le
successeur de Darius, et l'Empire Hellénistique était
toujours pour l'essentiel l'empire Iranien.
En fin politique, Alexandre cultiva l'ambiguïté
sur qui était conquis et qui était le conquérant.
Il encouragea les mariages et les diverses alliances pour que la
question devienne proprement indécidable. Il excentra même
la capitale à Alexandrie. Le véritable centre demeura
pourtant Persépolis. Les Athéniens finalement ne s'y
trompèrent pas, et ce fut eux qui s'insurgèrent.
Loin de faire disparaître l'Empire Perse,
l'Empire Hellénistique fut peut-être son apogée,
à moins que ce ne soit les premiers siècles de
l'Hégire.
Les cultures Perse et Grecque étaient bien
plus proches que le laisserait d'abord croire la trop visible
différence entre l'immense empire et les petites citées
autonomes. On exagérera sans doute le despotisme théocratique
de l'un par opposition à la seule démocratie
athénienne, qui n'en était d'ailleurs plus une sous
Alexandre.
C'est vite oublier que les citoyens libres
d'Athènes tenaient une bonne part de la population en
esclavage, et que Socrate y fut condamné à mort pour
avoir voulu introduire d'autres cultes dans la cité. À
côté, malgré le vague statut de religion
impériale qu'avait son monothéisme mazdéen, la
Perse pouvait être dite laïque, puisque les croyances les
plus diverses y avaient droit de cité et d'ouvrir leurs
écoles.
La civilisation gréco-iranienne et la
musique
En fait, la différence entre la Perse et la
Grèce était peut-être comparable à celle
entre l'Europe et les États-Unis d'aujourd'hui, c'est à
dire faible et superficielle.
Les points communs étaient plus importants.
Le principal à mes yeux était encore de faire une seule
discipline de la musique, des mathématiques et de la
gymnastique, et de lui donner une telle importance. Les hommes la
pratiquaient dans des lieux semblables : les gymnases pour les
Grecs, les zourkhanéh (maisons de force) pour les
Persans. Je crois que c'est là une constante pour tous les
peuples indo-européens au-delà de la vallée de
l'Indus.
Au fond, nul ne sait grand chose de cette triple
discipline. Je conçois bien moi-même les rapports
étroits entre la musique et les mathématiques. Je
comprends aussi ce que serait l'union de la musique et de la
gymnastique : la danse. Je conçois plus difficilement ce
que serait pratiquement une discipline qui ferait les trois à
la fois. D'autant que les Perses semblaient la pratiquer avec des
armes.
Les Perses n'étaient qu'un peuple, établi
dans la région de la Chiraz actuelle, qui unifia un empire
bien plus vaste, les Grecs et leur langue prirent l'intérim
pendant quelques générations, entre la dynastie des
Achéménides et celle des Sassanides qui, presque mille
ans plus tard, se convertit à l'Islam. Là encore, la
civilisation iranienne donna sans doute plus qu'elle ne reçut.
Non, en devenant musulman, le monde iranien ne
devint pas arabe. Plutôt le monde arabe, et avec lui le monde
méditerranéen, devint-il plus iranien, et peut-être
plus grec aussi. Les plus grands philosophes hellénisants de
l'Islam étaient iraniens.
La musique iranienne
Il est clair que c'est en Iran qu'est née
ce qu'on peut appeler la musique arabe. À moins que ce ne soit
l'Islam qui réinventa la musique iranienne en lui faisant
atteindre, par la sobriété, sa plus haute pureté.
Les Arabes trouvèrent en Perse une culture, notamment
musicale, bien plus avancée que la leur, et des instruments de
musique plus perfectionnés. Les musiciens persans se
répandirent alors partout à la suite de l'Islam, avec
leur notation, leur théorie et leurs instruments.
La religion d'Abraham n'a jamais été
favorable à la musique ni aux arts d'agrément, qui
furent toujours exclus du culte. « Pour ces raisons, dit
L'Histoire de la musique de La Pléiade, la musique
persane, à partir de l'Islam, fut réduite en fait et en
théorie à la monodie. Mais combien elle s'enrichit et
elle s'affina ! »
Dans un esprit pythagoricien, l'Iran a très
tôt associé la musique aux sciences, lui consacrant des
chapitres importants dans les traités de philosophie, avec la
physique et les mathématiques. Les Musulmans épurèrent
leur musique de ses vains ornements. Ils construisirent une théorie
originale et renouvelèrent les bases mal établies ou
oubliées.
J'ai trouvé sur le net un site de la région
sur les sources iraniennes de la musique du Marmat. Il cite en les
traduisant en anglais de nombreux travaux du musicologue iranien
Mahdi Barkachli. (L'Art sassanide, base de la musique arabe,
Presses Universitaires, Téhéran 1947 ; L'Évolution
de la gamme dans la musique orientale, Compte rendu du colloque
international de l'académie musicale, Marseille 1958 ; et
sa collaboration à L'Histoire de la musique, La
Pléiade, Paris 1960.)
« Comme les doigts appliqués à
raccourcir les cordes, les ligatures ordinaires étaient au
nombre de quatre, nommées la sabbàba (index), la
vastà (médius), la bincir (annulaire) et
la khincir (auriculaire). Avec la motlaq, la corde
libre, cela faisait sur chaque corde cinq sons, mesurés de la
manière suivante : motlaq (ut, 1/1), sabbàba
(ré, 88/9), vastà, bincir (mi, 64/81),
khincir (fa, 3/4). »
« L'intervalle matlaq-bincir
(ut-mi) était une tierce majeure (81/64), restant toujours
fixe, tandis que l'intervalle matlaq-vastà variait
autour d'une tierce mineure. »
« Pour obtenir cette vastà,
selon le principe diatonique, on prit en premier lieu un son plus
grave d'un ton que celui de la khincir (fa), soit 32/27. C'est
un son équivalent au mi-bémol de Pythagore ; entre
lui et la sabbàba (ré) il y a 256/243,
intervalle égal à celui de bincir-khincir
(mi-fa), c'est à dire un demi-ton diatonique de Pythagore. »
(Histoire de la Musique, La Pléiade)
|