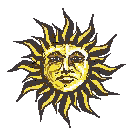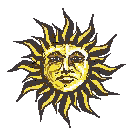Cahier IV
Le Marmat et la Gnose
Le 8 mai
L'ombre du serpent
Ici les aubes sont aussi glacées que sont
torrides les après-midi. Je promenais près d'un
ruisseau qui serpentait à l'ombre clairsemée de
noisetiers dans la chaleur de midi, quand je vis une chose étonnante.
Il est ici un serpent de la sous-espèce des
prothéroglyphes qui, comme tous les autres, change de peau de
temps en temps. Il possède une autre particularité,
unique dans tout le règne animal, de perdre aussi son ombre.
Par quelques contorsions, il s'en débarrasse, et une nouvelle
la remplace, parfaitement adaptée à sa taille.
J'ai vu l'ombre d'un serpent près du
ruisseau. J'ai d'abord cru à celle d'une branche. Non, les
branches ne volent pas dans le vide et sont généralement
accrochées à un tronc. Elle conservait parfaitement la
silhouette du serpent, à peine déformée par les
anfractuosités des cailloux et du sol. Elle était toute
fraîche. Les ombres commencent à se dissoudre au bout
d'un jour ou deux.
J'ai dû rêver de serpent à
cause de ce que j'ai appris des Ophites dans le Marmat. L'Ophisme
était une école gnostique égyptienne qui rendait
un culte au serpent (ophis en grec) pour avoir donné à
Ève le secret de la connaissance. Gnose signifie
justement « connaissance » en grec.
La Gnose au Marmat
Comme je l'ai déjà expliqué
au cours de mon premier voyage, le Marmat n'est ni une nation, ni une
culture, ni une ethnie, ni une religion, ni un territoire... Nul ne
sait dire où il commence ni où il finit, ni ne sait
expliquer exactement en quoi il consiste. Quelqu'un avait défini
une nation comme « une communauté de destin »
— idée que le général De Gaulle a
plus tard largement reprise à son compte. Supposons donc que
le Marmat soit une communauté de destin dépourvue des
attributs qui lui donnent généralement sa consistance :
institutions, mœurs, lois, frontières, langues, etc. Que
reste-t-il ? Voilà bien la question à laquelle je
n'ai toujours pas trouvé la réponse.
Quoi qu'il en soit, la Gnose a pénétré
dans le Marmat dès le premier siècle de l'ère
Chrétienne.
Le calendrier chrétien a d'ailleurs eu
cours dès cette époque-là dans la région,
et a perduré même après l'introduction de
l'Islam. On ne parle cependant pas ici d'ère chrétienne,
mais d'ère du Poisson. La datation part précisément
du moment où le soleil est entré dans la constellation
du Poisson, en sortant de celle du Bélier.
Au dix-neuvième siècle seulement, le
calendrier a sauté onze ans pour se synchroniser avec la
datation occidentale. L'autorité apostolique romaine avait
manifesté son refus catégorique de tout changement, et
comme la datation exacte du passage du soleil d'une constellation à
l'autre est contestable, on trouva plus simple de changer le
calendrier local. Il sauta précisément dix ans et neuf
mois, pour faire passer le début de l'année du 21 mars
au premier janvier. L'an 1837 écourté a donc été
suivi de l'an 1848.
L'imam Fardouzi, avec qui j'ai déjeuné
hier m'a appris cela inopinément.
Hammad Fardouzi assure la double fonction de guide
spirituel et de guide de montagne dans une vallée proche d'où
est originaire sa nièce Douha, la femme de Manzi. Nous avions
rapidement sympathisé l'an dernier. Il s'apprête à
faire un pèlerinage sur le tombeau de Jésus.
« En Israël ? »
lui ai-je demandé surpris. « Non, m'a-t-il répondu
amusé, dans la vallée de Bénarophon, à
quatre cents cinquante kilomètres. »
Jésus et le Marmat
Je savais déjà qu'il existe des
tombeaux et des mausolées de Jésus de-ci de-là,
mais je ne me doutais pas qu'il en était un si près.
L'histoire romaine de la crucifixion est peu
crédible, elle est même incroyable, et peu de gens l'ont
cru hors des empires d'Occident et d'Orient. Jésus aurait été
arrêté par les Romains, jugé et condamné
par les Juifs pour blasphème à un supplice que les
premiers réservaient aux esclaves évadés. Les
Romains auraient exécuté la sentence en le clouant sur
la croix au lieu de l'attacher, ce qui est plutôt inhabituel et
certainement impossible. Naturellement, tout ce qui est crédible
n'est pas vrai, ni faux tout ce qui est incroyable.
Pour certains, Jésus (Î'sâ)
serait allé à Damas, dont il correspondait déjà
avec le roi ; pour d'autres, il serait allé au Yémen
avec son disciple Barnabé ; pour d'autres encore, en
Abyssinie avec son disciple Thomas. Beaucoup disent qu'il est d'abord
allé à Damas, d'où il joignit Bassora pour
s'embarquer vers la Mer Rouge. Plus tard, il serait remonté
vers l'Océan Indien, aurait débarqué dans le
delta de l'Indus qu'il remonta au moins jusqu'au Karakorum.
Tous les habitants du Tasgard sont convaincus
qu'il est venu chez eux, qu'ils soient musulmans ou bouddhistes, et
même les incroyants ne voient aucune raison d'en douter.
Les plus anciens symboles du Christianisme sont
des poissons. Il paraît que la croix symbolisait le mat de son
navire. — De son navire ? — Oui, embarqué
à Bassora après avoir quitté Damas, il aurait
navigué longtemps entre le Golfe Persique, la Mer Rouge et
l'Océan Indien.
Le 9 mai
Déjeuner avec Manzi
Le vent agite les ramures des cèdres
au-dessus de nos têtes d'une respiration lente et puissante. De
notre place, nous ne sentons qu'un souffle léger qui remue à
peine le bord des parasols à l'armature de bois.
Nous sommes dans un de ces quartiers retirés
de Bolgobol qui, proches pourtant du centre, semblent au bout du
monde. Bâtie sur la pente accidentée du Mont Kûrûssoun,
la ville est comme un plan plié et déchiré :
nous sommes au bord d'une déchirure.
Ici, la roche monte à nu vers les remparts
qu'on ne distingue pas. Au-delà du Parc Ibn Roshd, le
Boulevard Timour Lang se prolonge d'une voie sinueuse, qui n'est
bientôt plus goudronnée. Elle aboutit au bord d'un
gouffre, d'où monte le bruit ténu d'une chute. L'abîme
est protégé d'un massif de framboisiers dont je n'ai
pas osé approcher de crainte du vertige.
Le petit restaurant est passablement délabré.
Les tables sont réparties sur une petite pelouse caillouteuse
où s'arrête la voie, en face d'une grotte fermée
par une grossière porte de bois qui laisse assez de jour avec
le sol pour se glisser sous elle.
Manzi travaille sur un curieux problème ces
temps-ci. Il a observé qu'à force de multiplier des
autorisations, on produisait un maillage inextricable d'interdiction.
« C'est un truisme de dire que les dictatures ont été
instaurées au nom de la liberté », me
dit-il. « Compte tenu des impasses où conduisent
des telles constatations, ce n'est certainement pas par là que
nous devons aborder la question. »
« Je cherche une sorte de loi,
précise-t-il, comparable à celle dont nous avons parlé
l'an dernier, selon laquelle la multiplication des déterminations
produit la profusion des possibles, et non pas, comme on l'a
longtemps cru, une chaîne causale unique. »
— Tu veux dire que, a contrario,
l'indétermination supprime des possibles ?
— Ce n'est pas si simple. Je pense
spécifiquement à l'interdiction et à la
permission, à l'obligation et à l'autorisation. Le
problème que je pose concerne le « comment on doit
faire » ; non pas le « comment les choses
se passent selon des lois naturelles ». Je pense à
des systèmes normatifs, tels qu'ils s'exercent dans l'usage et
l'élaboration de langages. On est dans un tout autre registre.
Entre nous et les remparts, on distingue un bout
du dôme rond d'une chapelle partiellement taillée dans
la roche. Manzi m'a promis que nous irions la visiter après le
repas.
— Oui, dis-je, je comprends bien la
différence entre obligation et nécessité. En
quoi le principe y serait fondamentalement changé ? Il
est évident que ce que tu diras dans un formulaire avec des
cases à cocher sera sûrement plus pauvre qu'en employant
les règles d'une langue naturelle.
Le repas est composé de boulettes de viande
et de riz avec des raisins secs. Je me sers des baguettes que j'ai
pris l'habitude d'amener avec moi, car j'ai horreur de manger avec
les doigts.
— Justement, reprend Manzi, le jeu de
règles « oui - non » est plus simple que
celui de la grammaire, et l'effort cognitif pour répondre est
plus faible, comme la possible diversité des réponses.
Alors, comment formuleras-tu cela : la contrainte est-elle
moindre ou supérieure ?
— Elle est supérieure dans le
sens où les possibilités sont supprimées, elle
est moindre dans le sens où les contraintes sont peu
nombreuses ?
— Et comment traduirais-tu cela en
terme de liberté ? As-tu plus de liberté si tu
réponds par oui ou par non, ou si tu recours à la
complexe grammaire des langues naturelles, et même à la
diversité des figures de rhétoriques ?
— Je crains que nous brassions ici des
platitudes, Manzi, le coupé-je.
— Nous devons donc introduire d'autres
paradigmes, me répond-il. Déplaçons d'abord
notre concept de liberté vers celui de pouvoir, et distinguons
l'agent et le dispositif par rapport à la règle.
Demandons-nous alors ce qui optimise le pouvoir de l'agent.
— Intuitivement, je dirais que plus le
dispositif est simple, prévisible, et plus celui qui s'en sert
le maîtrise vite. À l'inverse, si ce dernier l'utilise
comme un outil, comme un prolongement de son corps et de son esprit,
plus le dispositif aura de déterminations, plus il lui donnera
de pouvoir dès qu'il en aura acquis la maîtrise
automatique.
— Automatique, tu as dit le mot, me
renvoie Manzi. En somme, par l'automatisme, l'agent met à son
service les multiples possibilités d'un système
fortement déterminé. Si, au contraire, il veut agir sur
le dispositif lui-même, il doit d'abord en limiter les
déterminations pour le contrôler sciemment.
« Quand tu le dis ainsi, ajoute-t-il,
ça paraît si bête qu'on se demande pourquoi des
générations de philosophes et de savants se sont cassé
la tête à expliquer le contraire. »
— À cause des langues
naturelles, supposé-je, et de leur complexité. Tous les
penseurs qui se sont engagés dans cette voie, et je t'assure
qu'il n'en manque pas dans l'Occident Moderne, ont négligé
ou sous-estimé le langage ordinaire. Je te renvoie à ta
thèse sur le Non-Aristotélisme.
« Tu comprends alors que c'est un réel
problème pour les mathématiques. » Précise
Manzi. « Les langages des mathématiques visent en
effet le double et contradictoire objectif de faire le raisonnement à
notre place, et de nous le rendre en même temps intuitif. »
En me resservant, j'ajoute interrogateur :
« C'est également un problème politique,
puisqu'il est aussi celui de la contrainte, non ? »
« Tous les problèmes politiques
viennent de ceux des mathématiques, même en Occident »
répond-il en me regardant attentivement remplir mon assiette.
« Prends simplement Hobbes ou Leibniz. »
Manzi est amusé de me voir manger avec des
baguettes. « Ton voyage par la Chine t'a beaucoup
marqué », plaisante-t-il. « Non »
rectifié-je. « Dans ma jeunesse je me suis cassé
le poignet, et j'ai pris goût depuis à la cuisine
asiatique. On a besoin d'une seule main et on ne se salit pas les
doigts. C'est très pratique en plus pour lire en mangeant. »
Comme il rit, je rajoute : « Tu
sais, les habitudes alimentaires changent beaucoup en Europe. Le
couscous, par exemple, est devenu le plat favori des Français.
Les restaurants le proposent tous les vendredis en plat du jour. »
« Le jour de la prière ? »
S'étonne-t-il. « Je croyais que le jour du
Seigneur était le dimanche pour les Chrétiens. »
« Oui, mais le vendredi est jour de
jeûne » dis-je la bouche encore pleine. « Et
ils jeûnent avec du couscous ? » demande-t-il
en éclatant de rire.
Le 10 mai
L'Évangile Palanzi de Baruch
On considère généralement la
Gnose comme un phénomène presque exclusivement égyptien
couvrant les premiers siècles du Christianisme. Pourquoi ?
— Parce que la majeure partie des manuscrits gnostiques
ont été découverts en Égypte.
Et pourquoi y ont-ils été
découverts. — Pour trois principales raisons. La
première est que l'Égypte a mieux échappé
que le reste de l'Empire aux persécutions que les Romains ont
fait subir aux premiers chrétiens, puis aux hérétiques,
après que Rome se soit convertie à la religion qu'elle
combattait. La deuxième est que le climat chaud et sec y est
particulièrement favorable à la conservation du
papyrus. La troisième enfin est qu'on n'a jamais voulu
chercher hors de l'Empire, d'Orient ou d'Occident, dans les
profondeurs du désert d'Arabie, dans les régions du
Haut-Nil et de la corne de l'Afrique, en Perse et au-delà dans
le continent asiatique.
D'autre part, comme le souligne l'Encyclopædia
Universalis : Le mot « gnostique »
est une étiquette commode qu'ont utilisée les anciens
compilateurs de catalogues d'hérésies pour désigner
toutes formes d'interprétation de la Bible fondées sur
le rejet partiel ou total de l'interprétation reçue
dans l'Église, et à laquelle ont recouru les modernes
pour décrire une constante ou une convergence d'idées
qui sous-tend la plus grande partie de la littérature
philosophique et religieuse des premiers siècles de l'ère
chrétienne.
Ce qui s'entend généralement ici par
Gnose est plus large et plus simple. C'est tout à la fois la
propédeutique et l'implicite de l'Écriture Sainte.
Cette gnose est constituée d'un corpus de traditions
apocryphes et de l'interprétation des écritures
canoniques (ta'wîl) qui en est plus ou moins inspirée.
Je me suis plongé dans une édition
bilingue palanzi-anglais, de l'Évangile de Baruch :
une volumineuse liasse de feuillets photocopiés en A4, trouvée
dans une boutique de la vieille ville. Le livre pourrait s'appeler
« L'Odyssée de Jésus », tant sont
saisissants les points communs avec Ulysse et ses aventures
maritimes. Même la langue, très belle s'il faut en
croire la traduction, n'est pas sans rappeler Homère.
On n'y trouve cependant pas trace d'irrationnel
ni, bien évidemment, des dieux. Les misères qu'ils
provoquaient sont maintenant causées par les prêtres et
les princes. Comme l'antique héros, face à des forces
qui dépassent les siennes et celles de ses compagnons, Jésus
(Î'sâ) fait preuve de la même endurance et
de la même ingéniosité. Attentif aux siens,
attentif à ceux qui l'aident et à ceux qu'il combat,
comme attentif aux choses, sa pénétration égale
sa détermination.
Son Père ne l'aide-t-il donc pas ?
C'est ce que lui demande le roi des Abyssins : Pourquoi
n'envoie-t-Il pas des armées d'anges sous tes ordres ?
— Avec la permission de Qui crois-tu que je sois venu
jusqu'à toi ? répond-il.
Tout ceci n'est pas sans me faire penser à
l'Exégèse sur l'Âme, un texte parmi ceux
trouvés dans la région de Nag' Hammadi en Haute Égypte,
en 1945. Ils constituent la collection gnostique du Caire qui compte
treize livres. L'Exégèse sur l'Âme fait
partie du second, qui contient six autres manuscrits importants, dont
Le Livre Secret de Jean, l'Évangile de Thomas,
celui de Philippe et le Livre de Thomas l'Athlète.
L'ouvrage prétend démontrer l'identité de vue
concernant la destination de l'âme entre les prophètes
juifs et Homère.
Le 11 mai
Évangile Palanzi de Baruch
Alors que la ville aux murs blancs, au-delà
de la solide poupe de bois, disparaissait déjà sous la
frange des vagues, Nérias, le vaillant timonier, s'adressa au
clairvoyant Î'sâ que le vent du large, agitant ses
cheveux, faisait ressembler à un lion.
Nérias. — Ô Seigneur,
réponds-moi. Le Père parla pour créer l'homme
afin que chacun sût qu'il n'avait pas été créé
pour le monde, mais le monde pour lui. En réalité je
vois le monde fait pour nous demeurer, tandis que nous disparaissons.
Î'sâ aux bras puissants et au cœur
généreux répondit par ces mots.
Îs'â. — Vois les vagues
qui vont mourir sur les digues du port d'Al Dawha (Doha,
sur le Golfe Persique). Un jour pourtant, la digue, le
port, la ville tout entière ne seront plus, quand les vagues
déferleront encore. Vois par les yeux de la certitude :
Les immortels sont morts quand les mortels vivent toujours. Regarde
la vie comme si elle devait ne jamais finir, regarde la mort comme si
elle t'attendait maintenant, et n'hésite pas, tel la vague que
l'écume couronne.
Baruch, XLI, 30-37.
Un passage antérieur qui décrit la
sortie du port est, sous un autre aspect, plus intéressant
encore. Pour profiter d'un vent du désert, Î'sâ
fait virer la vergue à l'aide des drisses, pour l'abaisser sur
le bord, alors que le timonier met la barre dans la même
direction, de manière à emprisonner toute sa force. La
description d'une telle manœuvre fait soupçonner que
l'ouvrage serait assez tardif, au moins contemporain des premières
felouques.
|