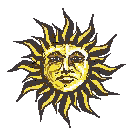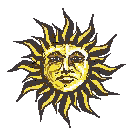Cahier III
Observations sur la
représentation et l’intuition
Le Bo mai BIDABO
Manzi et la langue de Boby Lapointe
Depuis plus d'un an, Manzi a fait d'importants
progrès en français, et dès que nous nous
retrouvons seuls, il saisit l'occasion de le parler. Personnellement,
je préfère utiliser l'anglais avec lui, que nous
maîtrisons à peu près à égalité.
Son français me limite à des phrases simples, et me
force à reprendre souvent mes explications.
Ses incursions dans la langue française lui
ont ouvert des portes inattendues à travers lesquelles Douha
n'a pas tardé à le suivre : celles du langage
bibinaire inventé par Boby Lapointe en 1968, qui permet de
nommer à l'aide d'un jeu assez simple de phonèmes, les
nombres des systèmes binaire et hexadécimal. Part
exemple, le 3 mai 2004 se dit en bibinaire : le HI mai
BIDABO. Ce qui est tout à la fois plus court et plus
intuitif qu'en tout autre langage — du moins dès
qu'on s'est familiarisé avec le système.
Manzi et Douha me fascinent ; tout en restant
dans la discipline qu'ils enseignent et dans laquelle ils cherchent
— respectivement la grammaire et les mathématiques —,
ils trouvent toujours, et apparemment sans peine, les moyens de
collaborer.
Le Bibinaire
Fibonacci a introduit le système décimal
en Occident en 1202 avec son ouvrage Liber Abbaci. Tout le
monde connaît cette ingénieuse méthode de
numération qui repose sur dix chiffres, de 0 à 9, et
permet de poursuivre à l'infini en plaçant les mêmes
à gauche des premiers pour marquer les dizaines, les
centaines, milliers, milliards, et milliards de milliards.
Rien ne nous oblige pourtant de nous limiter à
ces dix chiffres. Nous pouvons prendre pour base la suite que nous
voulons, des deux chiffres seulement du système binaire, aux
seize de l'hexadécimal. Les géomètres
babyloniens avaient même utilisé une base de soixante —
toujours en cours pour la mesure des minutes et des secondes.
Pour des raisons évidentes d'intuitivité,
il vaut mieux se contenter d'un nombre raisonnable de chiffres :
six, huit, dix, douze, seize, vingt au plus. Les langues naturelles
portent d'ailleurs les traces de tels choix. Le français, par
exemple, a un nom spécifique pour les seize premiers nombres ;
au-delà seulement ils commencent à recevoir des noms
composés : dix-sept, dix-huit... Il en va de même
jusqu'à douze pour l'anglais ou l'allemand. L'arabe s'arrête
à dix. Le gallois a manifestement été influencé
par une base quinze, et le danois par vingt.
Notons que les langues modernes restent malgré
tout sur une base décimale, puisqu'après seize, nous
disons « dix-sept » et non pas « seize
et un » ; ou après twelve, thirteen,
et non pas twelfty-one. Ceci nous laisse une vision un peu
raide des nombres. Les langues naturelles n'ont évidemment pas
la souplesse des langages mathématiques, conçus
précisément pour les manipuler.
Or, les langages des mathématiques et des
logiques sont essentiellement écrits — je voudrais
dire exclusivement. En effet, si nous pouvons écrire une
équation de la même façon partout sur la planète
— mais il n'en va pas ainsi depuis bien longtemps —,
chaque langue prononce ces signes à sa façon. Par là,
les langues conservent un pouvoir caché sur ces langages, qui
croient pourtant s'en émanciper au point même de savoir
« numériser » tous leurs caractères
comme tous leurs phonèmes.
Ce n'est pas moi qui contesterais l'importance
décisive du signe écrit, mais enfin, il doit toujours
finir par être couplé avec un système
phonologique, ou, si l'on préfère, être
prononçable. Le mot « entendement » nous
laisse soupçonner que l'intelligence humaine « entend »
mieux qu'elle ne « voit ». Qu'importe
d'ailleurs, il nous faut les deux.
Les langues naturelles ne sont pas à la
hauteur du calcul contemporain, surtout depuis que Boole a inventé
la base binaire, et qu'elle a pris une telle importance pratique avec
la programmation, à égalité avec la numération
hexadécimale. J'ai répété moi-même
que les machines comptaient en langage binaire ; que c'était
en somme « leur langage ». C'est naturellement
une image, qui est donc littéralement fausse. Ce sont les
hommes qui pensent les machines, et qui pensent donc le langage
qu'ils leur donnent. L'esprit humain comprend très bien le
binaire, mais il l'entend mal en voulant l'écrire et le
prononcer avec des signes décimaux.
Ce qui s'entend bien se conçoit clairement
Le système binaire commence d'abord comme
le décimal : 0, 1. Puis, là où vient le 2
dans ce dernier, celui-ci recommence : 0, 1, 10, 11, 100... Le
système hexadécimal repose, lui, sur une base 16. 16,
c'est (22)2. Aussi, les deux systèmes
sont intimement couplés. Le problème est que nous nous
y aventurons avec nos chiffres décimaux. C'est là que
Boby Lapointe intervient.
Il suffit d'attribuer une paire de voyelles
fermées (O et E) pour 0 et les nombres pairs, et ouvertes (A
et I) pour les impairs ; puis une paire de consonnes utilisant
l'arrière-gorge (H et K) ou l'avant de la bouche (B et D) pour
créer un système à seize (HAHO)
chiffres.
Observons que ces seize
phonèmes existent dans toutes les langues du monde. Pas de
'V', imprononçable en arabe, pas de 'R' inconnu du japonais,
pas de son 'ui' inimitable pour quiconque n'est pas un bon
francophone : seize phonèmes universels et aisément
mémorisables.
Le nom des nombres forme un
seul mot invariable sans tiret. Les plus grands demeurent
relativement courts et s'écrivent et se prononcent sans
difficulté particulière. « 584 623 705 671 »
se dira et s'écrira « KOKOHADEBOKADODEBOBI »,
ce qui est manifestement plus simple que « cinq cents
quatre-vingt-quatre milliards six cents vingt-trois millions sept
cents cinq mille six cents soixante et onze ».
Pour peu qu'on se soit
familiarisé avec le Bibi, la dénomination du nombre
nous renseigne mieux sur sa nature. Nous sommes trop portés à
oublier que les nombres ont une existence totalement autonome de la
façon dont on les nomme ou les écrit. Nous nous
habituons, par exemple, à notre « huit ».
Nous l'associons à son image '8', ce signe de l'infini
redressé. Nous oublions que le son ou l'image ne nous
apprennent par grand chose sur lui, qui a son existence propre ;
qu'ils lui demeurent essentiellement étrangers et ne nous
montrent en rien '23'
ou '1000' — au contraire de 'KO'.
Quelques références
Voilà ce que Manzi et Douha m'ont appris,
et je me demande s'il est bien raisonnable d'aller découvrir
si loin un système inventé par un natif de Pèzenas.
En effet, ce génial mathématicien,
ce Fibonacci d'une ère nouvelle est bien ce même auteur
compositeur interprète qui, à l'instar d'Omar Khayyâm,
demeuré plus connu lui aussi par ses quatrains que ses travaux
mathématiques, se rendit célèbre par les vers
inoubliables de Ta Kathy t'a quitté.
Quiconque voudrait en savoir plus peut aller sur
le site du lycée Jean Moulin de Pèzenas
(http://perso.wanadoo.fr/lyceejmoulin.pezenas/Pedagogie/maths.htm)
ou encore sur celui de Nicolas Graner
(http://www.graner.net/nicolas/nombres/bibibinaire-exp.php)
Il trouvera sur ce dernier un programme pour convertir les nombres
décimaux en bibinaire.
Pour être complet, se dira-t-on, ce système
devrait posséder des signes graphiques, comme les chiffres
arabes ou indiens du système décimal. Ceux-ci existent.
On les trouvera en suivant les liens.
Le 5 mai
Mon nouvel hôtel
Les hôtels ne sont pas chers à
Bolgobol. J'ai abandonné le premier, près de la gare
des cars, pour me rapprocher du centre.
Ziddhâ m'a proposé de sortir le soir.
Il est vrai que je ne connaissais pas encore Bolgobol la nuit. Les
soirées, je les passe plus volontiers devant mon ordinateur, à
travailler, étudier ou partager avec de plus ou moins
lointains correspondants, et plus précisément, à
faire les trois en même temps. Je préfère me
lever à l'aube. C'est une vieille habitude que j'ai prise à
Marseille, où il est presque impossible de se faire servir un
café après un dîner tardif. Les sociétés
de consommation offrent certainement de quoi consommer, à la
condition toutefois qu'on consomme ce qu'elles offrent sans discuter.
Les nuits froides du climat de montagne
n'empêchent pas les Bolgobolis de sortir le soir. Ces gens-là
sont d'une nature solide, et même les terrasses ne sont pas
désertées.
Les femmes se débarrassent du foulard qui
leur voile souvent le visage en plein jour. Elles le portent attaché
sur la nuque, tenant leurs cheveux en arrière, dégageant
entièrement leur face. Elles ne craignent alors plus rien du
soleil de plomb qui, à cette altitude, ravage la peau et la
vieillit prématurément.
L'hôtel que j'ai choisi fait l'angle de
l'avenue Timour Lang et du Chemin de l'Éden. Ce nom de chemin
ne doit pas tromper, c'est un boulevard aussi, qui monte tout droit
vers les remparts et la vieille ville. Bordés de marronniers,
les trottoirs de l'avenue Timour Lang sont larges. Face à
l'hôtel, de l'autre côté du croisement, un
bar-tabac-quincaillerie-librairie y étale, tôt le matin
et tard le soir, ses tables et ses chaises.
La façade nord de l'hôtel domine le
carrefour de ses quatre étages, tandis qu'il offre au sud
trois grandes terrasses en espaliers, garnies d'arbustes et de fleurs
dans d'immenses jarres ou de petits carrés de terre bordés
de ce qui me parait être de fines briques d'ardoise taillée.
On les distingue de trois-quarts, assis à la terrasse du tabac
où je vais lire le matin sur mon portable le courrier que j'ai
relevé avant de sortir.
Le toit de l'hôtel qui couvre le quatrième
étage occupe donc une bien plus petite surface que celle du
bâtiment. Ses bords sont soutenus par des étais de bois
grossièrement taillés, débordant très
largement sur la rue.
Les trois terrasses au sud sont des parties
communes, librement accessibles à tous les clients de l'hôtel,
quel que soit l'étage de leur chambre. Des escaliers
extérieurs les relient. Une fontaine artificielle alimente une
rigole d'où l'eau tombe en cascade entre chaque palier, et
produit un reposant murmure.
Des instruments de musique sont disposés
dans un kiosque de bois sur la deuxième terrasse au troisième
étage. Les clients de l'hôtel en jouent parfois, seuls
ou en petits groupes. J'ai moi-même essayé du luth. Deux
personnes n'ont pas tardé à échanger des accords
avec moi, très intriguées d'abord d'entendre sous mes
doigts une antique mélodie chinoise de l'époque de
Tcheou, avec ses modulés passant de doubles rondes à
des croches, dont je n'aurais pas eu la moindre idée avant mon
voyage.
L'un était un jeune représentant de
commerce venu du sud. Il composait en amateur. Il me parla en Anglais
de la synthèse granulaire. L'autre semblait être un
vieux montagnard taciturne qui parlait une langue qu'aucun de nous
n'a su identifier. Il jouait parfaitement des airs de l'Hindû
Kûch sur lesquels il chantait des poèmes de Farîdoddîn
'Attar. Nous sommes malgré tout parvenus à improviser
ensemble
On trouve sur les terrasses des tables et des
fauteuils de bois confortables, et quelques parasols. Ils sont faits
aussi de bois, et de papier, d'un papier extrêmement résistant,
même à l'eau, gris sombre, d'un aspect buvard sur une
face et un peu glacé sur l'autre. Il me rappelle celui
qu'utilisaient les poissonniers dans mon enfance.
Les voies sont larges dans ce quartier, entre les
remparts de la vieille ville et l'université, bien trop pour
la circulation rare. Par instants, le bruit d'un moteur poussif se
mêle à celui des branches.
Le théâtre de marionnettes de rue
Les montreurs de marionnettes ne se cachent pas,
par deux ils soutiennent et animent leur pantin. Très vite, on
ne leur prête plus attention.
Les marionnettes ne sont pas très
réalistes, même pas très figuratives. Les faces
de bois sont aplaties longitudinalement, le nez et le menton
proéminents, mais à peine ébauchés. Seuls
deux gros yeux fixes sont dessinés, qui rappellent les
sculptures grecques les plus antiques.
Les montreurs tirent parti des attitudes, qu'ils
magnifient par le tissu : de la soie qu'ils savent faire voler
avec virtuosité.
La couleur des tissus change à chaque
scène. Chacune a la sienne. Soudain la représentation
s'interrompt, les montreurs se retournent vers leurs caisses, y
rangent la soie blanche, par exemple, puisent de la rouge, dont ils
revêtent la carcasse de leur pantin, et ils reprennent sans
autre procédé.
Un peu de vent améliorera la
représentation, beaucoup compliquera son exécution.
Tout est dans le mouvement des tissus, lui seul permet de distinguer
le sexe du personnage, puis sa personnalité, et enfin,
l'histoire elle-même, car le théâtre est muet.
Même les faces inexpressives finissent, à
l'aide d'infimes mouvements, par rendre lisibles des sentiments
complexes. Parfois, l'un des montreurs dit quelques paroles,
apparemment rimées. Je n'y comprends rien car elles sont en
palanzi, ou parfois en un farsi dialectal que de nombreux Bolgobolis
connaissent.
Toutes les histoires, m'a expliqué Ziddhâ,
reposent sur le conflit entre l'amour et le devoir. Deux amants se
trouvent dans des camps opposés. Non seulement les personnages
sont déchirés, comme dans notre propre théâtre
classique français, mais le devoir repose aussi sur des choix
qui ne sont pas faciles. Aucun des camps n'est entièrement bon
ou mauvais, comme dans le théâtre classique indien.
Plus étrange encore que le spectacle des
marionnettes est celui qu'offrent les spectateurs. Alors qu'on peut
voir de telles représentations dans les rues presque à
toutes les heures, ils les regardent toujours comme pour la première
fois. Si vous étiez incapable de lire tous les déchirements
et le désarroi humain dans les marionnettes, vous pourriez
toujours vous retourner vers le public. J'ai vu des hommes pleurer
doucement, les lèvres tremblantes entrouvertes. Les gens d'ici
ne sont pourtant pas émotifs ni frustes. Ils sont d'ordinaire
plutôt retors et habiles à l'ironie.
Le jeu des marionnettes est étrangement
prégnant. Il a hanté mon sommeil.
Le 6 mai
Civilisation et conscience
Ce qui fait l'essence d'une civilisation est tout
à la fois étrangement simple et complexe, accessible et
inaccessible : Simple, parce que ce sont les hommes qui font une
civilisation, et ce qui les assemble doit être accessible aux
plus rustres ; et complexe aussi, car ce qui fait une
civilisation doit rester largement enfoui sous la conscience pour en
constituer les soutènements.
Que se passerait-il si cette surface de conscience
s'érodait ? Si elle dévoilait son sol ?
Certainement, se déroberait-il. C'est ce qui m'a donné
très tôt, en étudiant l'histoire, cette
impression qu'une civilisation n'est jamais plus saine et plus vivace
que lorsqu'elle est supportée par des esprits bornés.
Je me rends parfaitement compte que de telles
réflexions mènent à des conclusions proprement
intenables.
Le 7 mai
La musique granulaire
La synthèse granulaire construit des
événements acoustiques à partir de centaines ou
de milliers de grains sonores. Un tel grain dure un court instant, de
une à cent millisecondes, approchant la limite perceptible de
la durée, de la fréquence et de l'amplitude. Le grain
est une représentation adéquate du son, car il concilie
les informations temporelles (temps, durée, forme, onde) avec
celle de fréquence (la période de l'onde dans le grain
et son spectre).
La synthèse granulaire répand les
grains sonores comme en suspension sous forme de nuages à
travers le spectre sonore. Les modulations de la durée des
nuages provoquent des effets d'évaporation, de condensation et
de métamorphoses provoquées par la fusion des nuages
les uns dans les autres.
On peut retracer l'histoire d'une conception
atomiste du son depuis l'origine de la révolution scientifique
occidentale. Isaac Becman proposait en 1616 une Théorie
corpusculaire du son semblable à celle que Descartes
exposait pour la lumière dans sa Dioptrique.
Quelques siècles plus tard, entre 1946 et
1947, Dennis Gabor écrivait deux articles combinant la vision
quantique de la physique avec la pratique expérimentale. Selon
sa théorie, tout phénomène sonore peut être
décrit comme un nuage de grains. Cette hypothèse reçut
une confirmation mathématique de la part de Baastian entre
1980 et 1985. Dans les années quarante, Gabor construisit une
machine granulaire électro-optique. Il l'utilisa pour des
expériences sur la compression et l'extension des temps, c'est
à dire le changement de la durée d'un son sans en
modifier le ton.
Les procédés de la synthèse
granulaire ne sont pas sans analogie avec ceux des images de synthèse
dans le domaine visuel, tels qu'ils sont utilisés pour créer
la transparences et la réverbération de l'eau, la brume
et la nébulosité, ou des textures rocheuses et
végétales. On en retrouve l'équivalent dans les
effets sonores, tels que le craquement du feu, le clapotis de l'eau,
le sifflement du vent.
Le cybernéticien Norbert Wiener et le
théoricien de l'information Abraham Moles proposèrent
aussi une représentation granulaire du son.
Iannis Xénakis a été le
premier compositeur a étudier les travaux de Gabor et à
élaborer une théorie de composition granulaire. Il
commença par adopter le lemme suivant dans son ouvrage
Musiques formelles : « Tout son, même
une variation musicale continue, est conçu comme l'assemblage
d'un grand nombre de sons élémentaires disposés
dans le temps de façon adéquate. »
J'ai retranscrit cette phrase déjà
traduite en anglais. Je peux en citer une autre tirée de son
avant-propos de 1963, qui donne une idée des enjeux réels
de son approche. « Ce n'est pas tellement l'emploi fatal
des mathématiques qui caractérise l'attitude de ces
recherches, c'est surtout le besoin de considérer les sons, la
musique, comme un vaste réservoir [...] de moyens nouveaux,
dans lesquels la connaissance des lois de la pensée et les
créations structurées de la pensée peuvent
trouver un médium de matérialisation (= communication)
absolument nouveau. »
On remarquera la référence explicite
à l'ouvrage de George Boole de 1854, Les lois de la pensée,
auquel on doit le système binaire. Je remarque aussi que la
nouvelle théorie musicale de l'occident commence, à une
génération près, quand s'achève la
recherche mathématico-musicale chinoise.
|