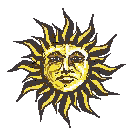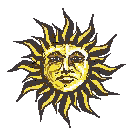Cahier
XXV
Dernières impressions avant de m'envoler
du 9 au 10 juillet
De l'étranger
Me voilà prêt à rentrer en
France. C'est une perspective qui ne m'enchante qu'à moitié.
Un vent de mer pousse sur Tangaar une brume épaisse. L'air est
humide et tiède. Des oiseaux de mer volent en poussant de
hauts cris dans la lumière du phare qui les éclaire en
face de ma chambre d'hôtel, comme s'il les amusait. Se glisse
alors en moi l'impression que je partirai demain à l'aube en
bateau, et non l'après-midi en avion.
En réalité, je n'aime pas beaucoup
la France. Pourtant je suis français. Cela signifie
concrètement pour moi que la langue française, ses
lettres et sa culture constituent une part déterminante de ce
que je possède, peut-être mon bien le plus précieux.
On peut alors évidemment compter sur moi pour les défendre,
bien plus que sur ceux qui « aiment la France ».
Je ne dois pas être un cas bien singulier,
car parmi tous ceux qui ont le plus contribué à ce bien
commun, beaucoup la voyaient sans complaisance, ou encore n'étaient
pas français. Ai-je à les nommer ?
On doit bien reconnaître que l'histoire de
cette France, de cette identité française, n'est pas
particulièrement sympathique. Et elle est essentiellement
schizophrène.
L'histoire de la France est celle de la
destruction systématique de peuples, de langues et de
cultures : Bretons, Wolofs, Kanaques, Occitans ou Romains :
de leur soumission cruelle au fanatisme et à l'obscurantisme
des rois et des évêques. Il en va à peu près
ainsi de toutes des nations occidentales.
C'est cela et c'est aussi son contraire :
l'émergence d'une culture commune, ou chacun se sait à
la fois héritier d'esclaves et de marchands d'esclaves, de
Romains et de Gaulois, de Croisés et de Cathares, de Chouans
et de sans-culottes.
Mais ce dépassement ne s'est jamais
réellement accompli. Ou plutôt, alors même qu'il
était en œuvre, la France a recommencé plus loin
ce qu'elle avait achevé dans son territoire. Il en résulte
une incapacité schizophrène à digérer
l'histoire ; une confusion d'esprit qui alimente des
comportements d'autant plus inquisitoriaux qu'ils sont bien en peine
de concevoir quelle version officielle imposer. Peut-être
s'agit-il donc plutôt de paranoïa.
Il en va à peu près ainsi de tous
les états occidentaux, et même les migrants des
Amériques ont emporté le problème dans leurs
bagages, ou l'ont retrouvé sur place avec les colonies
esclavagistes et les territoires indiens. À l'orée de
ce siècle, les empires occidentaux me paraissent avoir fini là
où la Chine avait commencé, il y en a vingt-deux, dans
les rêves fous de Ying Zheng de Qin.
Je n'aime pas beaucoup plus l'Occident que la
France, même s'ils constituent une part de moi-même dont
je pourrais difficilement me passer. J'en dirais autant de Kouka et
des amis que je laisse ici, quoi qu'elle en pense.
Une part de moi-même n'est pas le mot juste.
Je ne me sens pas ainsi partitionné ; une prothèse
plutôt, dont même Kouka est susceptible de se servir, et
dont l'absence me diminuerait bien plus qu'elle.
C'est surtout une prothèse commune, car si
elle n'était pas partagée elle ne me serait quasiment
d'aucun usage. Aussi l'utilisation pertinente que d'autre en font,
les innovations qu'ils lui apportent, m'inspirent des sentiments très
fraternels. Ce ne sont pourtant pas toujours des Français, ni
des Occidentaux, ce n'est pas toujours le français leur
première langue, ni une à alphabet latin.
C'est que les langues, les lettres et les cultures
se nourrissent, et n'entretiennent pas entre elles les mêmes
rapports que les conquêtes foncières. Ce n'est pas parce
qu'une langue s'introduit dans une région qu'elle est vouée
à en chasser d'autres, pas plus que n'importe quelle
connaissance. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent, tant du
moins que les locuteurs de la langue qui s'introduit ne confisquent
pas en même temps la terre, les ressources, les moyens de
production et les connaissances.
Les langues sont bien plus menacées par
leurs propres locuteurs qu'elles ne le seraient par d'autres.
Pourquoi donc l'usage de l'anglais dérangerait-il celui du
français, mon propre usage des deux langues ? Le passage
de l'une à l'autre renforce au contraire mes capacités
en chacune. Et ce n'est certainement pas la faute à Voltaire,
ni à Rousseau, et moins encore à Thoreau, si l'on ne
parle pas provençal en Provence.
Sans doute je suis plus à l'aise en
français qu'en anglais, mais cela encore mérite d'être
relativisé. Nous avons tous fait cette expérience
étonnante de la facilité à comprendre et à
se faire comprendre parfois dans une langue que nous connaissons mal,
et de la difficulté inverse qui peut apparaître aussi
bien dans celle qui nous est maternelle.
Maternelle ? je ne crois pas qu'une langue le
soit ; langue de notre mère, de notre nourrice,
peut-être. Un rapport filial n'est pas celui que l'on doit
entretenir avec elle. On ne doit pas craindre de la secouer, de la
violenter. Comme une mayonnaise, mieux on la bat, mieux elle monte.
Ce n'est pas en la rudoyant qu'on cesse d'être un lettré,
c'est plutôt en se noyant dans une langue visqueuse, jargon
administratif, juridique, journalistique, faussement technique, un
globish, une novlangue.
Il n'est qu'à
considérer par exemple l'usage que fait la novlangue du
mot « entreprise », qui n'a plus rien à
voir avec le verbe « entreprendre », et même
le contamine. Qu'on songe aux usages semblables qui sont faits du mot
« travail », du mot « auteur »,
de tous les mots. Cet emploi d'une langue visqueuse coupe à
chaque mot le chemin vers un référent dans le monde
sensible.
Qu'est-ce qu'une
« entreprise » en effet ? des bâtiments ?
ceux qui y travaillent ? un capital ? ses actionnaires ?
ses gestionnaires ? une personne morale, ou l'ensemble de ses
possessions ?… On doit faire appel à des
définitions juridiques, alors que les juristes et les
législateurs attendent, eux, que l'usage commun les leur
donne.
Le mot « entreprise »
on le remplace alors par celui de « projet »
dont on use et abuse, avant de le stériliser aussi. Or ce
n'est pas du tout la même chose, car « projeter »
suppose que l'on commence par tout penser avant que — justement —
d'entreprendre.
Plus que se liquéfier,
la langue se vaporise : plus de solides référents
sur lesquels la pensée puisse s'appuyer sur les choses
sensibles, plus de tropes semblables aux gestes ; pas plus de
sensualité dans le style que d'acuité dans la pensée.
Les mots se réfèrent à de petits démons,
si l'on voit ce que je veux dire.
Il ne faut rien
dramatiser, je sais. C'est même précisément le
fond de ma pensée. Il suffit de bien battre la langue, comme
un tapis, pour que soient chassées ou ravivées les
locutions trompeuses.
C'est du moins assez facile dans une langue dont
on a forcé tous les verrous. Il en va autrement dans celles
que l'on maîtrise mal, ou dans des domaines peu familiers.
C'est pourquoi même une langue que nous connaissons au point
d'en pratiquer les lettres, peut dans certains discours nous paraître
curieusement étrangère.
La lampe de l'éclairage urbain, juste
au-dessus du balcon de ma chambre d'hôtel, m'éclaire
assez pour que je puisse écrire. Dans la moiteur de la nuit,
je n'ai toujours pas sommeil.
Un vent de terre légèrement plus
frais s'est levé presque tout à coup. Il commence à
déchirer lentement le brouillard. J'aperçois déjà
les collines au-delà des lumières du port.
Le 10 juillet
De la terre et des lettres
Le vent est tombé aussi vite quand le
soleil s'est levé. J'ai peu dormi, c'est assez naturel quand
on se trouve quelque part où l'on sait n'avoir pas le temps de
prendre ses marques. J'ai déjeuné sur le balcon puis
j'y ai saisi les notes de la nuit.
Pourquoi écrire à la plume pour
ensuite saisir au clavier ? D'abord, j'aime écrire dans
n'importe quel lieu où il n'est pas toujours possible
d'installer un ordinateur, même portable. Quelques progrès
restent à faire dans la maniabilité, la résistance
aux mouvements et aux chocs, à la température et à
l'humidité. Je suis bien plus solide qu'une machine high-tec
et je ne tiens pas à ce qu'elle m'impose un mode de vie.
Ensuite, il m'arrive aussi quelquefois d'écrire au clavier.
Ceci dit, je préfère
définitivement la plume — moins pour ne pas perdre
la sensualité de l'objet et du geste, bien réelle
pourtant, que pour l'indélébilité.
On rature, on écrit
entre les lignes, dans les marges, on fait des renvois, mais on
n'annule rien. Le résultat sur la page est souvent assez beau.
Quel dommage qu'il ne soit que pour l'auteur.
On ne peut qu'aller de
l'avant, et l'on y va assez vite, soucieux seulement de ne pas perdre
le mouvement de sa pensée. (On comprend ce que j'appelle ici
pensée.)
On renvoie à la
saisie le moment où l'on peigne son texte. Quand on écrit
au clavier, on fait les deux en même temps. Ça ralentit
l'énonciation, et surtout ça en efface les traces.
C'est un peu comme si pour travailler on se plaçait devant un
miroir pour contempler ses gestes.
Je ne nierais pourtant
pas qu'il existe des façons d'écrire à l'écran
plus efficaces, et dont certains semblent avoir le secret. Dans ce
cas, je préconise de travailler en texte brut, sur un éditeur
plutôt que sur un traitement de texte.
Mais alors, où
est l'avantage si l'on doit finalement exporter le texte pour le
mettre en forme ? Ceci dit, je ne sais comment l'usage d'un
éditeur de texte brut est souvent d'une sensualité
égale à la plume.
En saisissant la phrase
que j'ai écrite dans la nuit « c'est cela et aussi
son contraire » (à savoir l'histoire de la
destruction barbare des peuples et l'émergence d'une
fraternité égalitaire), je me dis que c'est surtout ni
l'un ni l'autre. Car ce dont je parle après tout, c'est de ce
problématique placage d'un monde de prothèses
cognitives sur la géométrie plane des frontières
et des propriétés foncières.
|