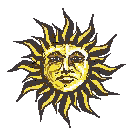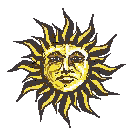Cahier II
Le marxisme et l’Orient
Le 29 avril
Arrivé hier à Bolgobol
Il fait encore froid en cette saison, tout
particulièrement au lever et à la tombée du
jour.
La place Zawafî (prononcer Zavafi
comme en farsi) où m'a déposé le car hier,
m'était encore inconnue. J'ai refait la route parcourue l'an
dernier, non sans émotion.
J'éprouve toujours un plaisir particulier à
écrire lorsque je me déplace. Les inévitables
temps morts, les attentes, m'incitent à tout moment à
sortir mon cahier, ou encore mon Powerbook lorsque je peux
suffisamment bien m'installer.
J'ai du mal pourtant à tenir mon journal
depuis que j'ai passé la frontière chinoise. Pendant
les trois jours passés chez Tchandji, j'ai surtout été
occupé par nos conversations avec ND, et par la lecture de
traductions en anglais des Grundrisse de Marx et des écrits
d'Engels sur l'Algérie, récupérés sur
l'internet.
Construite à flanc de côte, la place
Zawafî est découpée en deux niveaux reliés
par un monumental escalier de pierres. À sa droite en montant,
est la gare des cars. À gauche, un petit jardin occupe un
palier intermédiaire. Un restaurant de planches y nourrit les
voyageurs, la plupart du temps des ouvriers qui vont travailler dans
les usines du nord de Bolgobol, sur les rives de l'Ardor. C'est là
que j'ai dîné hier en arrivant, et que je suis revenu ce
matin prendre un petit-déjeuner.
Je n'avais pas remarqué d'abord ces
balcons, cachés derrière des croisillons de fines
lattes de bois sur ma droite. Ce sont des bâtiments massifs,
coiffés de toits en pente, évasés à la
base. Ils devaient m'être invisibles hier, derrière les
tilleuls.
Le 30 avril
Une silhouette enveloppée de noir
Elle est vêtue d'une tunique et d'un
pantalon de toile. Un châle cache son visage, ne laissant voir
qu'une paire de lunettes fumées, et retombe sur ses épaules.
Du corps, on ne distingue que les mains, et les pieds chaussés
de sandales indiennes. Je reconnaîtrais pourtant cette
silhouette entre toutes : c'est Ziddhâ.
Comme à mon habitude, je n'ai prévenu
personne de mon arrivée. J'ai peine à me sentir chez
moi, là où l'on m'attend. Mes amis savaient seulement
que j'étais en route. J'ai surpris Ziddhâ à la
sortie de l'université qui attendait son car.
Elle est d'abord restée étonnée,
bien qu'elle pouvait s'attendre à me voir d'un jour à
l'autre. Ce sont mes cheveux, que je n'ai plus coupés depuis
l'an dernier, qui lui ont demandé une fraction de seconde pour
accommoder son souvenir à mon image, puis elle en a saisi une
mèche en disant : « Ça te va bien, on
dirait un trappeur. »
Le premier mai
Engels et l'Orient
« ... L'absence de propriété
foncière est en effet la clé de voûte de tout
l'Orient. C'est là-dessus que repose l'histoire politique et
religieuse. Mais d'où vient que les Orientaux n'arrivent pas à
la propriété foncière, même pas sous sa
forme féodale ? Je crois que cela tient principalement au
climat, allié aux conditions du sol, surtout aux grandes
étendues désertiques qui vont du Sahara, à
travers l'Arabie, la Perse, l'Inde et la Tatarie, jusqu'aux hauts
plateaux asiatiques. L'irrigation artificielle est ici la condition
première de l'agriculture, or celle-ci est l'affaire, ou bien
des communes, des provinces, ou bien du gouvernement central. »
Voilà ce qu'écrivait Engels à
Marx le 6 juin 1853. On pourra juger la généralisation
bien réductrice, quoique plus excusable dans une
correspondance privée que dans un texte publié,
l'hypothèse n'en mérite pas moins d'être
examinée.
« ... Cette fertilisation artificielle
du sol, qui cessa dès que les conduites d'eau se
détériorèrent, explique le fait, autrement bien
étrange, que de vastes zones soient aujourd'hui désertes
et incultes... Ceci explique également qu'une seule guerre
dévastatrice ait pu dépeupler un pays pour des siècles
et le dépouiller de toute civilisation. C'est dans cet ordre
d'idée que se situe également, je crois,
l'anéantissement du commerce de l'Arabie méridionale
avant Mahomet. »
On peut lire, intimement mêlées dans
ces lignes, toute la pertinence et la caducité de la vision
marxiste qui, un siècle et demi plus tard, demeure, il faut
bien le dire, incontestée en Europe, aux États-Unis et
en Russie — la curiosité et la perspicacité
en moins, évidemment.
La source libre
Tchandji m'a donné avant mon départ
les URL d'une quantité d'écrits de Marx et d'Engels peu
connus. Ils me replongent dans des lectures que j'ai délaissées
depuis de longues années.
On pourra toujours me dire que rien ne vaut le
papier, le cahier ou le livre, pour écrire et pour lire ;
rien n'égale pourtant cette possibilité de copier et
coller qu'offre le document numérique. Et puis, un document
numérique est toujours imprimable. Autrement moins commode est
la numérisation d'un imprimé. Qu'attend-on pour que la
littérature universelle soit accessible en source libre sur
l'internet ?
Le gaspillage de la lumière
Maintenant que je les ai remarqués, je
découvre partout ces croisillons de bois qui cachent les
balcons ou les fenêtres. On aperçoit parfois des
silhouettes derrière. Ils permettent de voir sans être
vu. Ils doivent cependant prendre beaucoup de jour.
Les gens ici aiment les maisons sombres, les coins
obscurs. La situation de la ville à flanc de montagne, sur
l'adret, favorise tant l'ensoleillement qu'on peut gaspiller la
lumière, et que l'ombre est un luxe.
Mon journal est tout décousu.
Le 2 mai
Évolutionnisme social
Marx et Engels ont reproduit, comme il était
logique, l'idéologie de leur temps, et l'ont même
popularisée en rédigeant de nombreux articles sur
l'Orient dans l'Encyclopédie Américaine, avant
même de devenir par la suite les inspirateurs du dogmatisme de
l'URSS.
Cette vision de l'Histoire est comparable à
celle de Lamarck pour ce qui concerne l'évolution des espèces.
Pour Lamarck, l'homme étant l'animal le plus évolué,
il ne fait aucun doute que toutes les autres formes de vie ne sont
que des étapes transitoires vers la perfection humaine. Pour
Marx et Engels, comme pour tous les Européens, l'Occident
étant la forme la plus achevée de la civilisation,
toute autre ne pourrait être qu'à un stade antérieur
de développement.
Pour erronée que soit une telle conception,
deux choses au moins sont à mettre à son crédit.
La première est qu'elle n'est en rien raciste, et peut
revendiquer la fraternité révolutionnaire sans
hypocrisie. Pour Marx, pour Engels, comme pour tous les Européens
progressistes d'hier et d'aujourd'hui, le développement inégal
n'a rien à voir avec un patrimoine génétique.
Une bonne éducation suffit à un migrant des contrées
les plus exotiques pour en faire un parfait occidental. Si une
société tout entière aura plus de mal à
rattraper son retard, l'échelle d'une vie humaine en reste la
mesure.
La seconde est que cette supériorité
de l'Occident est bien réelle. — Alors en quoi
cette conception est-elle erronée ? — En ceci
simplement que cette réelle supériorité ne
remonte pas si loin dans le temps. À l'époque où
Engels écrivait ces lignes, elle ne datait que d'un ou deux
siècles, mettons même trois pour compter large. Trois
siècles sur cinquante, ça laisse 94% des temps
historiques sans domination occidentale.
C'est pourquoi l'Occident Moderne tente de se
convaincre que l'Europe Occidentale est l'héritière
directe de la Rome antique, en oubliant quelque peu que celle-ci fut
au moins autant africaine qu'européenne. Elle veut se croire
aussi celle de la Grèce antique, en oubliant cette fois que le
monde hellénique était au moins autant oriental
qu'occidental, et que l'empire d'Alexandre s'étendit en Asie.
Je ne nierai pas que l'Europe doive beaucoup à
Rome et à la Grèce, mais de là il y a loin pour
s'en faire le dépositaire exclusif. On devrait également
pouvoir expliquer pourquoi la Grèce antique aurait été
le « berceau de la civilisation » et comment
elle aurait été la dépositaire de l'évolution
antérieure. On doit justifier surtout que la régression
du moyen-âge n'ait pas été seulement un phénomène
local, mais mondial.
Il est dur pourtant de qualifier d'obscure une
période où apparurent des inventions aussi décisives
que l'algèbre, le papier, l'imprimerie, l'optique et l'art de
tailler les lentilles, la boussole, la voile triangulaire qui permet
d'avancer contre le vent, l'horloge, la première chimie des
métaux, la pression hydraulique, la propulsion des bateaux par
des roues à aubes, la poudre et la balistique, et tant
d'autres.
L'émergence de l'Occident Moderne
Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, les
auteurs européens — toutes les bibliographies
l'attestent — citaient bien plus les auteurs arabes,
qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, que les latins et
les grecs. Ces auteurs grecs, ils les lisaient d'ailleurs en latin,
traduits par les Arabes. Comment cette dette a-t-elle pu être
effacée de la Renaissance au dix-septième siècle ?
J'ai longtemps cru à une sorte d'orgueil
national, mais je me trompais. L'explication se trouve plutôt
dans le nouvel esprit scientifique né avec Galilée,
Bacon et Descartes. Ces derniers se souciaient bien peu de ce que
l'Occident Moderne devait ou non à d'autres temps ou d'autres
mondes. Ils voulaient fonder la certitude sur l'expérience et
la déduction, et sur rien d'autre. Qu'importe la table quand
on fait table rase. La Science Moderne prétendait
révoquer en doute toute connaissance établie,
encouragée en cela par les succès de Galilée qui
avait réfuté les cosmologies de Ptolémée
et d'Aristote.
La méthode fut si efficace qu'en quelques
décennies les savants d'Occident firent plus de progrès
que ceux du monde entier en plusieurs siècles. Cent ans plus
tard, ces découvertes commençaient à porter
leurs fruits dans l'émergence de l'Europe de l'ouest comme
nouveau pôle de civilisation. Un siècle encore, et elles
modifiaient radicalement la vie quotidienne, la conscience et les
institutions des Occidentaux.
L'Orient des Occidentaux
Influencés par leurs contemporains, Marx et
Engels ignoraient l'extrême jeunesse de leur civilisation.
Peut-être qu'à trop attendre la révolution qu'ils
voyaient devant eux, ils ne soupçonnaient plus celle qui était
derrière. Pour comprendre donc l'effondrement de leur monde du
nord-ouest de la Méditerranée au Moyen-Âge, à
moins que ce soit justement pour ne pas l'expliquer, ils devaient
d'abord regarder celui du sud et de l'est du monde gréco-latin.
Il aurait été certainement plus
simple d'admettre que seul le nord-ouest de la civilisation
méditerranéenne s'était effondré en se
laissant absorber par la profondeur du continent. Le refoulement des
peuples continentaux sous la pression des empires d'Orient, la longue
période de guerres, de pillages et de famines que provoquèrent
ces grandes migrations violentes, y suffisait très bien.
... Il est une chose en tout cas qui ne fut
certainement pas sans grande conséquence : c'est la
sécurité relative des caravanes dans l'empire persan
bien gouverné des Sassanides, alors que le Yémen fut,
de 200 à 600, constamment asservi, envahi et pillé par
les Abyssins. Les villes d'Arabie méridionale, encore
florissantes sous les Romains, n'étaient plus au septième
siècle que de véritables déserts de ruines...
On voit bien ici qu'Engels ne peut pas ignorer
complètement le déplacement de la civilisation
occidentale vers l'Asie. Il se refuse pourtant à en tirer
toutes les conséquences.
Dans les articles qu'Engels écrit quarante
ans plus tard, publiés entre 1894 et 95 dans la revue Die
Neue Zeit, intitulés « Contribution à
l'histoire du Christianisme primitif », il revient sur le
rôle de l'Islam dans les conflits entre Bédouin et
citadins.
Les soulèvements du monde « mahométan »,
notamment en Afrique, forment un singulier contraste. Avec cela,
l'Islam est une religion faite à la mesure des Orientaux, plus
spécialement des Arabes, c'est à dire, d'une part, de
citadins pratiquant le commerce et l'industrie ; d'autre part,
de Bédouin nomades.
On observe bien là cette propension à
expliquer l'Orient par l'Occident africain, c'est à dire par
la survivance décadente de l'Empire Romain.
Mais il y a là le germe d'une collision
périodique. Les citadins devenus opulents et fastueux, se
relâchent dans l'observance de la « Loi ».
Les Bédouins pauvres et, à cause de leur pauvreté,
de mœurs sévères, regardent avec envie et
convoitise ces richesses et ces jouissances. Ils s'unissent sous la
direction d'un prophète, un Mahdi, pour châtier les
infidèles, pour rétablir la loi cérémonielle
et la vraie croyance, et pour s'approprier comme récompense
les trésors des infidèles. Au bout de cent ans,
naturellement, ils se retrouvent exactement au même point que
ceux-ci ; une nouvelle purification est nécessaire ;
un nouveau Mahdi surgit ; le jeu recommence. Cela s'est passé
de la sorte depuis les guerres de conquête des Almoravides et
des Almoades africains en Espagne jusqu'au dernier Mahdi de Kartoum
qui a bravé si victorieusement les Anglais. Il en fut ainsi,
ou à peu près, des bouleversements en Perse et en
d'autres contrées mahométanes.
Le flou de la dernière formule mérite
d'être soulignée. On voit là encore comment
l'Occident africain (le Maghreb) est systématiquement présenté
comme la clé de l'explication de l'Orient.
Ce sont des mouvements nés de causes
économiques bien que portant le déguisement religieux.
Mais alors même qu'ils réussissent, ils laissent
intactes les conditions économiques. Rien n'est donc changé,
la collision devient périodique. Par contre, dans les
insurrections populaires de l'Occident chrétien, le
déguisement religieux ne sert que de drapeau et de masque à
des attaques contre un ordre économique devenu caduc :
finalement cet ordre est renversé ; un ordre nouveau
s'élève, il y a progrès, le monde marche.
On peut faire sur ces dernières lignes une
double remarque. D'une part, on ne voit pas pourquoi, ni surtout en
quoi, ces insurrections seraient toujours évolutives d'un
côté, et de l'autre, toujours répétitives.
Elles ne devinrent révolutionnaires en Europe qu'avec les
guerres de la Réforme, c'est à dire au seizième
siècle, et ce n'est qu'à ce moment-là, en
Allemagne, en Hollande et en Angleterre, qu'elles entraînèrent
un réel progrès des connaissances, des mœurs et
des institutions. Dans le monde islamique, elles ne devinrent
répétitives, là encore, qu'assez tard.
La deuxième remarque concerne le prétendu
« masque religieux ». Que masque-t-il en
réalité ? Parlerait-on encore d'un « masque
religieux » pour l'œuvre de Descartes, de Spinoza ou
de Newton ? Voudrait-on dire alors que les mêmes choses
seraient dicibles sans référence chrétienne ?
Soit, mais en quoi la religion y aurait-elle alors fonction de
masque, puisqu'elle ne masque rien ? Pourquoi ne dirait-on pas
aussi bien le « masque du latin », ou encore
« le masque de la langue naturelle » sous
prétexte que ces écrits sont traduisibles ?
Le discours chrétien, de même que le
discours musulman, étaient tout à fait capables
d'énoncer leurs buts économiques, politiques, et leurs
critiques des institutions. Que je lise Münzer ou Liburne, Al
Farabî ou Al Ghazâlî, je distingue très bien
ce que le discours religieux me montre, ce qu'il dessine, ce qu'il
construit. Je me demande ce qu'il peut encore cacher.
Engels avait finalement une vision très
folklorique du monde musulman, dans lequel il exagère
caricaturalement la place de la société bédouine.
Le monde musulman n'a jamais été que minoritairement
arabe, et même le monde arabe ne fut arabe que très
symboliquement. Jamais les tribus bédouines d'Arabie n'eurent
la force ni les moyens de coloniser le pourtour méditerranéen.
Ce furent au contraire les peuples du sud et de l'est de la
Méditerranée qui se tournèrent vers la péninsule
arabique parce qu'ils y avaient vu la Terre Sainte, celle où
Dieu s'était révélé à Abraham. Ils
se sont tournés vers la langue arabe car ils y ont vu celle de
la Révélation, et ils ont pris les tribus bédouines
comme modèle linguistique et culturel.
Jamais la Mecque ne fut un centre, mais bien
plutôt, littéralement, une excentricité, avec la
fonction quasi explicite de contrebalancer tous les autres centres
possibles et successifs : Jérusalem, Damas, Alexandrie,
Bagdad, Istanbul, Samarcande...
« L'absence de propriété
foncière est la clé de voûte de tout l'Orient. »
Tout l'Orient, c'est bien grand. Pour ce qui est du monde islamique,
le droit de Oumar paraît d'abord être une arme contre
l'accumulation foncière, et l'Islam lui-même, une lutte
contre celle-ci.
Mais se bat-on contre ce qui n'existe pas ?
Fait-on des lois contre ce qu'on ignore ? Les juristes firent
d'ailleurs toujours preuve de beaucoup d'ingéniosité
pour les contourner.
Le monde islamique, et peut-être bien une
part importante de l'Orient, me semblent avoir dépassé
le stade de l'accumulation foncière depuis bien longtemps.
— Serait-ce donc ce qui le figea dans l'immobilisme ?
— Certainement pas. C'est seulement l'Occident qui veut se
persuader que le monde était immobile avant son propre éveil.
C'est l'Europe qui dut brûler les étapes en deux ou
trois siècles, créer une accumulation foncière
pour l'investir dans le commerce, puis l'industrie ; c'est ce
qu'elle veut à tout prix se cacher.
Le 3 mai
Dîner chez Manzi et Douha
Avant hier, Ziddhâ et moi avons rencontré
Manzi et Douha sa femme. Ils revenaient de la manifestation du
premier mai. Nous avons déjeuné ensemble au Parc Ibn
Rochd. Ils nous ont invités à dîner hier soir
chez eux, où nous avons passé une bonne part de la nuit
ensemble.
Ils savaient que j'étais déjà
arrivé à Bolgobol. Ils avaient même lu les
dernières pages de mon journal, mises en ligne hier. En fait,
nous nous sommes tous très peu quittés depuis mon
départ.
« Tes remarques sur Engels sont
instructives », m'a dit Douha. « Elles vont au
cœur d'un malentendu entre l'Orient et l'Occident, surtout
aujourd'hui que le centre de gravité de la lutte des classes
s'est déplacé en Asie. »
|