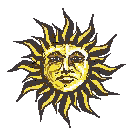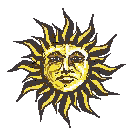Cahier I
Arrivée par la Chine
Le 19 avril
Lu dans le Quotidien du peuple en
français
Des verres romains datant de plus de 1 700 ans,
importés probablement de la Rome antique, ont été
découverts dans une tombe ancienne localisée dans la
province orientale de l'Anhui, a informé samedi le département
local des vestiges culturels.
La tombe ancienne a été mise au
jour lors de la construction d'une route dans le village de Zhulong
du district de Dangtu à l'Anhui. Les archéologues ont
estimé que la tombe a été construite durant la
dynastie des Jin de l'est (317-420).
Recouvertes des roches, ces verres semblent de
fabrication traditionnelle romaine.
D'après le département local des
vestiges culturels, le propriétaire de la tombe pourrait être
une famille éminente de la dynastie des Jin de l'est.
A l'heure actuelle, les verres ont été
envoyés à l'université des sciences et
technologies de Chine dans l'Anhui pour y être étudiées
et analysées.
Source: xinhua
Le Quotidien du Peuple en ligne,
<http://french.peopledaily.com.cn/>.
(L'Anhui est une province à quelques cinq
cents kilomètres de Shanghaï dans la vallée du
Yangzi Jiang, presque aussi peuplée que la France bien que
trois fois plus petite.)
Je reviens dans le Marmat par le même chemin
que j'avais pris l'an dernier pour repartir. Je ne suis pas passé
par Quantoun cette fois. Je suis arrivé à Shangaï.
Le 20 avril
L'éternelle Chine nouvelle
La Chine nouvelle est surprenante. Elle montre
d'abord un double visage dont on soupçonne qu'aucun n'est le
vrai : celui d'un monde préindustriel, et d'un autre
post-fordiste.
Dans le centre moderne de Shangaï, je me suis
senti pauvre. Ailleurs, dans les campagnes, je me suis senti
insolemment riche. On est dans le tiers-monde.
Heureusement, en Chine il y a des Chinois, et
quand on les rencontre, le double masque tombe. On ressent alors
l'incomparable et millénaire qualité de vie, qui a fait
que, tout au long d'une histoire qui ne fut pas souvent idyllique, si
peu de Chinois ont eu le goût d'émigrer.
Arrivée à Canton
Comme les Provençaux, les Chinois du sud
prisent les pins qui étendent leurs branches au-dessus d'un
chemin ou d'une cour : les pins aux troncs convulsifs, couchés
sur le côté par un vent régulier. Les peintres
des deux pays ont une affection particulière pour ces formes
végétales, à la fois tourmentées et
apaisantes, qui portent l'empreinte de la violence des éléments
tout en s'en faisant une protection pour le passant ou l'homme qui se
repose.
Ces formes, fréquentes sur les céramiques
et les faïences provençales, en noir sur des fonds jaune
de Mars, ont certainement été empruntées à
la décoration chinoise qui les prisait depuis bien plus
longtemps, à la même époque peut-être que
les techniques d'impression des tissus provençaux.
Le 21 avril
Les deux Chines et les deux Occidents
Curieusement, quand on quitte la Chine côtière
pour s'enfoncer dans le continent, on commence à sentir
l'Occident bien avant le Qinghaï ou même Chengdu à
l'entrée du Sichuan. C'est une expérience étonnante,
car cette Chine profonde est pourtant la moins « occidentalisée ».
Depuis une trentaine d'années, la Chine
connaît une incessante migration intérieure, une
Conquête de l'Ouest. Le Xinjiang est son Far West. On le
sent dans le regard de ces millions de nouveaux migrants : les
autochtones sont déjà pour eux des Occidentaux, pétris
de culture tibétaine, mongole et islamique, des étrangers
de l'intérieur, en un mot des barbares, des sauvages comme
vous et moi. Il en résulte une certaine proximité quand
on est un étranger de l'extérieur.
Les modes de vie hérités de
l'Occident viennent pourtant de la côte entre Hong-kong et
Shanghaï. Il y aurait en somme deux Chines traditionnelles et
deux Occidents. L'un est celui qui demeure à l'Ouest,
tardivement sinisé, au-delà de la Grande Muraille, qui
se prolonge le long de la vieille route de la soie jusqu'à
l'Oural et la Méditerranée. L'autre vient de l'Est, du
Pacifique.
Il y a donc aussi deux Chines : La Chine
profonde et continentale, et la Chine nouvelle qui est en train de
« cuire » le capitalisme. Elle possède
aujourd'hui plus de dollars que n'en ont encore les USA.
La cuisine chinoise
« Cuire », cuisiner, est un
verbe à forte valeur métaphorique en Chine. On a depuis
longtemps utilisé à propos des étrangers les
termes de barbares crus et de barbares cuits — quoique
je préfère la traduction par « sauvages ».
Il y a en Chine une métaphore permanente entre cuisine et
civilisation.
Les Chinois ne perçoivent pas le
capitalisme moderne comme un implant étranger — rien
n'est réellement étranger en Chine, seulement
« cru » —, et ils sont en train de
le cuisiner.
Le droit de la Chine Populaire ignore largement le
commerce, qui le lui rend bien. Personne ne semble s'en soucier. Ni
les profiteurs, ni les victimes n'attendent beaucoup d'un état
de droit. Ils ont mieux que cela : une civilisation.
L'Occident a un vieux fond de féodalisme.
Celui-ci est en passe de reprendre du poil de la bête dans la
carcasse d'un capitalisme pourrissant, même en Amérique
du Nord qui n'a pourtant jamais été féodale,
mais ou le billet vert finit par tenir lieu de sang bleu. Rien de
semblable en Chine.
Le 22 avril
Encore sur la cuisine chinoise
Pas de grands monuments pour des généraux,
ni pour des saints, même pas pour des poètes. La plupart
des antiques pagodes honorent la mémoire d'ingénieurs :
inventeur de l'horloge hydraulique, du bateau à roue...
Les lois en Chine et le fonctionnement des
appareils d'état furent toujours déplorables. Un
empereur le justifia : Le peuple au moins sait qu'il n'a rien à
en attendre.
La Chine est devenue le véritable centre du
capitalisme. le Parti Communiste contrôle pourtant l'état
sans partage. Le communisme aussi a été cuisiné.
Le 23 avril
Mon compagnon de voyage
À Shangaï, j'étais attendu
avant de repartir pour le Marmat. N G est professeur de
philosophie à l'Université. Il parle bien le français.
Je l'ai connu à Aix-en-Provence il y a une dizaine d'années.
N G a été Garde Rouge dans sa jeunesse. « Nous
savons maintenant qu'un grand bond en avant n'est pas la bonne
stratégie quand on est au bord du gouffre »,
m'a-t-il confié facétieux.
Je lui ai présenté Tchandji l'an
dernier, qui l'a invité chez lui cette année. Tchandji
est un professeur de chinois éleveur de chevaux dans le nord
du Marmat que j'ai rencontré lors de mon premier voyage. Je
suis très content d'avoir un compagnon de trajet. Je ne sais
pas comment j'aurais pu supporter autrement ces longues journées
de train.
Le 24 avril
Dans le train
Les Chinois ont un art consommé d'être
seuls ensemble. Polis, prévenants, ils vous ignorent pourtant.
Hier, à cent dans une voiture prévue pour quarante
passagers, on se sentait à peine gêné par la
promiscuité.
Ils s'installent sur un coin de banquette, si ce
n'est à même le sol. Ce bout d'espace devient le leur,
un chez-soi où ils s'isolent. Ils se perdent comme vous
dans la contemplation du paysage, ou la conversation d'un proche. Ils
s'isolent mais ne s'enferment pas : ils ne manquent pas
d'attention quand il convient d'en accorder.
Notre voisin de gauche quittait l'usine pour
tenter sa chance dans l'ouest. Un cousin l'attend qui a déjà
créé une entreprise de sous-traitance. Celle qui nous
fait face va rejoindre son amant, parti il y a trois ans. Elle a
abandonné son emploi de vendeuse.
Tous semblent n'avoir que des rêves simples.
J'hésiterais à les dire petits, tant ils leur donnent,
je ne sais comment, une ampleur et un parfum d'aventure dont je
ressens le vertige. Il y a de la peur en eux, pas de l'angoisse, pas
de la frayeur : la peur qui trempe le courage. Ils avancent sur
elle sans hésitation.
N G a fait le traducteur dans une longue
conversation avec mon voisin de droite sur la commande numérique
dans le refroidissement des dispositifs à pression
hydraulique.
À Kachgar
Le ville de Kachgar est à l'extrême
ouest de la Chine, entre le désert du Taklamakan et le
Kirghizstan, dans la république autonome du Xinjiang. Son nom
signifie « caverne (ghar en arabo-persan) de jade (qash en
ouïgour) ».
À la différence d'Ürümqi,
la capitale officielle du Xinjiang, complètement chinoise,
Kachgar est restée une ville fortement ouïgoure. La ville
est actuellement modernisée. La vieille ville est
systématiquement détruite et remplacée par des
rues modernes. Bien que la population demeure à forte majorité
ouïgoure, la proportion de Hans est en constante progression.
Kachgar est le lieu d'origine du linguiste Mahmoud
de Kachgar. Il composa vers 1075 en arabe un remarquable Recueil des
langues turques (dîwân lughât 'at-turk) qui est une
source précieuse de connaissance des divers dialectes turcs
médiévaux. Un conte des Mille et une nuits (Le Conte du
tailleur, du bossu, du Juif, de l'Intendant et du Chrétien) se
déroule à Kachgar. On y parle l'ouïghour et le
dialecte chinois local.
Le 25 avril
Entrée dans le nord du Marmat
La dernière partie du trajet se fait dans
un train moins bondé mais plus rustique. Le désert cède
progressivement la pas à des plaines vertes où paissent
des troupeaux de yacks, de chèvres et surtout de chevaux de
plus en plus nombreux. On y aperçoit de loin en loin les
yourtes blanches des éleveurs.
Je ne sais pourquoi les idéologues qui ont
voulu voir dans l'URSS le « communisme réel »
affirment tout aussi péremptoirement que la Chine « a
abandonné le communisme ». Logiques avec eux-mêmes,
ils prédisent depuis vingt ans le reversement imminent du
Parti Communiste qui leur semble un anachronisme.
Du côté de ce parti, nul ne prétend
d'ailleurs que la Chine soit communiste du simple fait qu'il la
dirige. Le PPC revendique bien plus modestement « la
construction du socialisme ». On pensera ce qu'on voudra
de la façon dont ils s'y prend, mais c'est déjà
plus conforme aux principes marxistes qui l'inspirent.
La baisse tendancielle du taux de profit
« Non, dis-je à N G, le
stade de la domination réelle du capital correspond à
la baisse tendancielle du taux de profit. »
« L'industrialisation immobilise une
part croissante du capital dans les usines et leurs machines, alors
que la proportion des salaires diminue, ajouté-je. Comme la
plus-value ne se retire que des salaires, sa part décroît
sur celle du capital fixe, figé dans les installations
industrielles. À ce moment-là, le capital cesse d'être
un aiguillon pour le progrès et la modernisation. Il en
devient plutôt le frein. C'est sur cette analyse que s'achève
le Livre IV du Capital. Je veux bien t'accorder que tu
puisse lire mieux que moi l'allemand, mais pas que tu aies pu y lire
autre chose. »
« Je ne te dis pas le contraire, me
répond N G. Le Livre IV s'achève ainsi parce que
Karl Marx est mort en l'écrivant, non parce que ce serait la
fin qu'il aurait dû avoir. »
« Et comment fais-tu pour savoir ce que
Marx n'a pas écrit ? »
« Je n'en sais rien, je sais seulement
ce qu'il a écrit dans ses autres ouvrages : la Première
Critique de l'Économie Politique et les Fondements de
la Critique de l'Économie Politique. Ne trouves-tu pas que
Le Capital se donne pour un projet bien trop ambitieux pour se
conclure sur la seule description d'une crise économique qui,
on le sait bien aujourd'hui, n'était pas fatale ? »
« L'ouvrage est inachevé. »
« Que disons-nous d'autre ? »
Valeur, salaires et capital
« La baisse tendancielle du taux de
profit, ce n'est pas seulement l'étouffement du capital par
son propre développement. C'est la limite de la quantification
de la valeur par le temps de travail. » Continue-t-il.
Voilà qui me laisse sans voix. La mesure de la valeur par le
temps de travail m'a toujours paru la clé de voûte de la
théorie marxiste, sa limite indépassable.
« Clé de voûte, peut-être,
me répond-il, mais pas indépassable :
nécessairement dépassée, au contraire. »
« Plus la technique progresse et moins
le temps de travail intervient dans le procès de production.
Si nous prenons une pioche, toi et moi, il se peut que nous ne
travaillions pas à la même vitesse. Si nous formons des
équipes au hasard, il est probable que les différences
s'estomperont, et que toutes, si elles ont le même nombre de
bras, auront une productivité identique. »
« Si au lieu de pelles et de pioches,
nous prenons des excavatrices, il n'y aura alors aucun point commun
entre la productivité et le temps de travail. »
« Pas nécessairement, le
coupé-je. Un dispositif complexe peut n'exiger qu'un travail
non qualifié, et même d'autant moins qualifié que
le système est expert. Dans ce cas, n'importe quel groupe
d'ouvriers sur une chaîne aura une production comparable à
une autre sur une chaîne semblable, et parfaitement apte à
quantifier la valeur par le temps de travail. »
« Exactement, me répond-il. Tu
es bien d'accord cependant que ces ouvriers auront une productivité
très supérieure à ceux qui travaillent avec des
dispositifs traditionnels ? »
« Sans aucun doute. »
« Ils produisent donc beaucoup plus en
y passant le même temps et en y employant la même force
de travail. »
« Je suis d'accord. »
« Ce n'est donc ni leur temps ni leur
force de travail qui produit ce surcroît de richesse, mais le
dispositif qui a été conçu et mis en œuvre
par d'autres travailleurs. »
« Que veux-tu dire ? »
« Je veux dire que la plus grande part
de la richesse n'aura pas en réalité été
produite par des travailleurs sans qualification, mais par des
travailleurs très qualifiés au contraire : des
ingénieurs, des chercheurs. »
Je me demande avec un peu de méfiance où
il veut en venir.
« Ce sont eux, me répond-il, qui
produisent l'essentiel de la richesse, et elle n'a aucun rapport avec
un quelconque temps de travail. »
« Et alors ? »
« Alors, fait-il, la monnaie n'a plus
aucun référent réel dans un temps de travail
socialement nécessaire. Elle ne représente
littéralement plus rien. Elle n'a proprement plus de valeur. »
« Plutôt les propriétaires
se retournent-ils vers la seule force productrices réelle :
le savoir technique. Ils se l'approprient sous forme de brevets, et
tentent d'en interdire l'accès au plus grand nombre. »
« Après le capitalisme foncier,
commercial puis industriel, la domination réelle du capital
produit le capitalisme intellectuel. Tu observeras que les
travailleurs intellectuels ne sont pas, et sont même de moins
en moins, les propriétaires du capital intellectuel, pas plus
que les ouvriers industriels ne l'ont jamais été de
leurs usines... même en Chine. »
Le 26 avril
À Bisdurbal chez Tchandji
Tchandji a abandonné l'enseignement du
Chinois à l'université de Bisdurbal pour se consacrer
entièrement à l'élevage des chevaux.
L'ordinateur n'est certainement pas pour rien dans ce choix qui lui
permet de mener tout à la fois une vie de nomade et
d'intellectuel, à l'aide seulement de deux petits panneaux
solaires judicieusement placés sur le toit de sa yourte.
La cinquantaine, il est plutôt maigre et
nerveux, contrairement à ses compatriotes des territoires du
nord qui sont plutôt trapus et calmes. Dans le sud, le type
caucasien est plus courant. Les populations sont de toute façon
très mélangées, et l'on ne prête pas
beaucoup d'attention aux particularités physiques, car elles
n'ont que des rapports lointains avec les langues et les coutumes.
La conversation à trois n'est pas facile.
Je parle français avec N. G. et anglais avec Tchandji.
Eux se parlent en chinois.
J'ai commencé à mettre au propre mes
notes sur la musique chinoise, prises en interrogeant N. G.
La musique chinoise
Au temps de l'empereur Houang-ti, il y a plus de
vingt-cinq siècles, son ministre Ling Loueng, dans la ville de
Hie-k'i, prit des bambous d'une égale grosseur et les coupa
dans l'intervalle de deux nœuds. Il souffla dans celui qui
était plus long de trois pouces et neuf dixième, il
produisit le son fondamental « houang-tchong »
(la cloche jaune). Elle servit de base à la musique.
Deux phénix vinrent alors, un mâle et
une femelle, et chantèrent six notes chacun. Ling Loueng coupa
onze autres bambous pour produire les sons différents en
rapports avec le houang-tchong initial. Il inventa ainsi les
douze liu, constituant la gamme chromatique.
Les gammes sont produites par des progressions
ascendantes de quintes à partir du houang-tchong (notre
fa). Après quatre progressions de quintes, on obtient
cinq notes : fa, do, sol, ré, la, qui forment, à
leur place dans une octave, la première gamme pentatonique :
fa, sol, la, do, ré.
Chacune des notes prend dans la gamme un nom qui
indique sa fonction : la première, fa, se dit hong
(le palais), la deuxième, sol donc, se dit chang
(la délibération), la troisième kiao (la
corne), la quatrième tche (la manifestation), et la
cinquième (ré), yu (les ailes). Les cinq
degrés de la première gamme pentatonique ont donné
naissance à cinq modes : mode de kong : fa sol la
do ré ; mode de chang : sol la do ré
fa ; mode de kiao : la do ré fa sol ;
mode de tche : do ré fa sol la ; mode de yu :
ré fa sol la do.
La combinaison des douze liu avec les cinq
modes a donné soixante tons différents. Vers l'époque
Tcheou, deux notes complémentaires furent ajoutées dans
la gamme pentatonique. L'une s'appelle pien-tche (tche
bémol), l'autre pien-kong (kong bémol).
L'ancienne méthode pour compter les liu
est inscrite dans le Che-ki de Sseu-ma Ts'ien : « Partant
du houang-tchong multiplié par 2/3, on obtient
lin-tchong. Lin-tchong multiplié par 4/3 donne
t'ai-ts'ou (sol)... »
Après les douze progressions de quintes, on
devait retrouver le houang-tchong initial. On trouva plutôt
un autre son d'un neuvième de ton plus haut. Il en résulta
des siècles de recherches théoriques
mathématico-musicales.
Sous la dynastie des Han, au troisième
siècle, King Fang continua la progression jusqu'au quatorzième
son, sö-yu (produit coloré). Il n'avait qu'une
faible différence de 1/56 avec le houang-tchong
initial. Pour avoir un chiffre juste, il fit encore six progressions
et s'arrêta à nan-che (événement du
sud).
Sous le règne de Wen-ti des Song, au
cinquième siècle, Ts'ien Yo-tche poursuivit par les
mathématiques la progression des liu jusqu'à
1/360, qu'il appela ngan-yun (chance de paix), à 1/134
de ton plus haut que le houang-tchong.
Ces calculs purement théoriques furent
rejetés au douzième siècle par Ts'ai Yuan-ting.
Les premiers douze liu étaient justes, mais le
treizième son était un peu trop haut, et n'était
donc pas le retour au houang-tchong. Il considéra aussi
que les six premiers tons (fa do sol ré la mi) étaient
justes, mais pas les six autres. Il adopta six liu auxiliaires
tirés des soixante. Ce fut le système des dix-huit liu.
Tchou Tsai-yu inventa les douze liu tempérés au
seizième siècle, soit un peu moins d'un siècle
avant que Johann Sebastian Bach n'écrive son Wohltemperierte
Clavier.
|