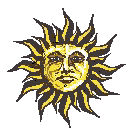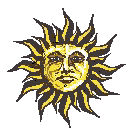Cahier IX
L'Oumrouat
Le 27 mai
Avant l'empire d'Alexandre
Indra est un très ancien Dieu de l'Inde Arienne, dont on ne trouve trace que dans les premiers Védas. Dieu des montagnes et de la chasse, il était très important dans la civilisation védique, puis semble avoir été complètement oublié. Armé d'un arc, il est l'époux de Parvati, mais est parfois présenté comme celui de Kali, la déesse de la mort et de la destruction. Les textes qui en font mention remontent à la civilisation de la vallée de l'Indus, mille ou deux mille ans avant le Christ et même avant le Bouddha. Indra aurait donc cédé la place à Shiva, tandis que la religion védique se décentrait vers l'Est et que le Bouddhisme la remplaçait en s'étendant vers le Nord.
Le Bouddhisme Mahayana pourtant ne l'oublia pas. Il l'associa même aux grands Boddhisatva sous le nom de Vajrapani. Il est possible aussi que le culte d'Indra ait pu ouvrir la voie à celui d'Apollon et de Dionysos, avec lesquels il partage quelques caractères et quelques attributs.
On n'a pas découvert beaucoup de traces de la religion du Marmat avant l'empire d'Alexandre : quelques représentations sur des poteries et des pièces de monnaie. On y retrouve le même type de visage, imberbe mais parfois barbu, parfois portant une fine et longue moustache, accentuant les extrémités des lèvres étrangement recourbées vers le haut.
On reconnaît cette forme très particulière des commissures sur la plupart des statues du dieu Hermès et du bouddha Gautama dans des cultures différentes.
Les dieux des polythéismes sont toujours la figuration sous les traits d'une personne du rapport des hommes et de leur terre. C'est pourquoi ils sont si nombreux : chaque fois que ce rapport change, que cette intimité entre les hommes, le lieu et la vie quotidienne qu'ils y façonnent change aussi peu que ce soit, le dieu change. Il devient un autre, même s'il porte parfois un même nom. Même s'il arrive qu'il demeure en principe le même dieu, sa physionomie change, et avec elle des éléments de sa mythologie.
Le dieu polythéiste n'est sous certains égards qu'une image, une représentation synthétique, non pas d'une société ou d'une culture, mais plutôt d'une vie quotidienne, d'une façon particulière d'être humain.
Les Grecs ont été les premiers à avoir corporalisé une telle image dans les seuls traits d'une personne. Ils ont fini par s'interdire le recours à tout attribut. On reconnaît Poséidon sans son trident, Athénas sans chouette ni casque, Arthémis, sans arc ni chevreuil.
En représentant ainsi la divinité, les grecs disaient beaucoup du corps humain. A-t-on songé à partir de quelle distance on peut identifier quelqu'un à sa seule démarche, alors qu'on l'aperçoit à peine ? Les statues des dieux grecs ni ne marchent ni ne parlent. On les reconnaît à leur physionomie, une expression, une attitude, un port de tête, un regard, ou plutôt une synthèse de tout cela, que le dessinateur virtuose et même le photographe savent combien elle est dure à saisir.
Cette statuaire nous dit beaucoup de l'humain, de la physionomie — il manque manifestement un mot pour cela : ni corps, ni âme, ni caractère, ou personnalité, mais quelque chose de plus vide, de plus proche du rien ; une apparence, une forme, mais infiniment et absolument différente d'une autre, et qui fait que chacun est reconnaissable parmi une foule.
Prenons maintenant la proposition : « il n'est pas d'autre dieu que Dieu ». Entendons la comme une proposition de logique : Il existe x , tel que x appartient à l'ensemble Dieu ; cet ensemble ne contient qu'un seul élément.
Considérons les statues des dieux avec cette définition. Nous pourrions dire alors que le Dieu que représente la sculpture n'est pas tel ou tel dieu, mais cette absolue et infinie différence entre tous les corps : cette unicité.
Dans ce cas, je peux déduire en effet qu'un tel Dieu est amour — amour charnel, bien sûr, éros, qui fait qu'au corps que je désire, aucun autre ne peut se substituer. (Je ne serais pas pour autant indifférent à d'autres corps, de par leur unicité même.)
L'introduction de l'Islam
Les Goths étaient des monophysistes. Jésus était pour eux un prophète et non le fils ou l'incarnation de Dieu.
Les Goths n'étaient pas des ethnies. Les hordes étaient composées d'hommes et de femmes de toute origine, venus des fjords ou des plaines d'Asie centrale. Parfois les chefs restaient fidèles à des cultes locaux ou n'avaient pas de religion, mais la masse des Goths était disparate, et la plupart étaient chrétiens.
Ce que voulait dire être chrétien aux premiers siècles pourrait se résumer ainsi : « J'ai mon propre seigneur, et je ne reconnais personne pour mon maître. » Ils ne se reconnaissaient que des chefs de guerre. Les chrétiens étaient en guerre contre l'esclavage, et en cela, les Goths étaient chrétiens, fût-ce à y être contraints par la poussée des Huns. Rome aussi, pourtant était chrétienne.
L'esclavage se dissipa plus qu'il ne disparut vraiment, et on se disputait sur la divinité de Jésus. Les esclaves devinrent des serviteurs, il demeura des maîtres, et une Église Romaine pour les bénir.
Les Goths s'étaient répandus sur le pourtour occidental de la Méditerrannée : les Ostrogoths en Italie et en Sicile, Les Wisigoths en Occitanie, les Vandales, en Ibérie et au Maghreb. Ils se reconnurent naturellement dans la Oumma Musulmane (la Communauté des croyants).
On comprend cela, comme on comprend aussi pourquoi l'Occitanie et l'Ibérie se tournèrent vers le saint Empire quand le Maghreb se mit à voir en Europe un réservoir d'esclaves. Comment comprendre aussi l'introduction de l'Islam dans le Marmat ?
L'Islam pénétra dans le Marmat au douzième siècle. Il ne s'introduisit certainement pas en apprenant que le monde n'avait que cinq mille ans à des gens qui avaient appris à compter le temps en Kalpas, ou en prétendant que la terre était au centre de sept cieux à qui n'avait pas changé la cosmogonie pythagoricienne héliocentrique pour celle de Ptolémée. Le monde, tel que même un berger le voyait, aurait pu paraître plus grand que le Créateur qui était proposé.
L'Islam pénétra dans le Marmat en sapant ce qui était le fondement du Bouddhisme : la cessation de dukka —la cessation de la douleur. Le Bouddhisme enseigne la cessation de la douleur par le renoncement aux désirs. La douleur obscurcit l'esprit et lui empêche l'accès à l'éveil (boddhi). Le Chiisme enseignait une tout autre voie de l'éveil : celle de l'effort et de la fermeté, celle du non renoncement. L'Islam opposait une posture stoïcienne à l'épicurisme bouddhique, plus proche des mœurs du Marmat au douzième siècle.
La Voie (tarikat) des soufis est la voie du désir, et celle, d'abord, du désir amoureux. « Celui qui n'a pas su se conduire en jeune-homme, ne sait être un sage. » Disait Ibn Hambal, quand le monde almoade d'Espagne cédait sous les coups convergents des Almoravides et des Croisés. Le fondateur du rite hambalite, beau-père de Ibn Arabi, était un contemporain de Abd Al Tariq, qui introduisit l'Islam dans le Marmat, et le radicalisa.
La doctrine du Désir Exclusif selon Abd Al Tarik
L'enfant volette comme un papillon d'une envie à l'autre, et pleure quand il n'obtient pas satisfaction. Dès qu'en grandissant il rencontre l'amour, tous ces papillons se dispersent, et il connaît un désir exclusif.
Rien n'est plus fort qu'un tel désir qui abolit toute distinction entre corps et esprit, et ne se laisse arrêter ni par la peur ni par la souffrance. Sur le chemin qui le conduisait vers Laïla, Madjnoun ne songeait pas à ôter l'épine qui s'était plantée dans son pied, car cette douleur le rapprochait aussi de l'aimée.
Par cette voie, Abd Al Tarik prétendait apprendre comment la volonté domestique les contraintes. C'est ainsi qu'il introduisait à son livre le plus célèbre : La Mécanique du Marmat.
Il écrivit aussi sur la musique, la grammaire et la littérature. Il traduisit en arabe les traités et les cours de rhétorique de Sénèque le père. Toujours il montrait comment les règles et les contraintes produisent liberté et possibilité pour celui qui sait s'en servir.
Il développa une théorie sur la détermination, où il démontrait par l'algèbre que la multiplication des causes et la canalisation des effets produit une démultiplication des possibles. Il disait que le possible est un attribut du réel, et que la réalité était l'infinie profusion du possible.
Une fatwa le condamna à mort en 1178, mais on dit que tous ceux qui furent envoyés pour le saisir furent séduits et convertis. Il construisit beaucoup de moulins dans le Marmat. Il paraît qu'il en est un sur l'Ardor, entre Bolgobol et l'Oumrouat, qui fonctionnait encore au début du siècle dernier.
La maison de Ziddhâ
Les pierres sont si chaudes devant la maison que je dois reculer et enfiler mes sandales dont je croyais pouvoir me passer pour marcher jusqu'au bassin. Malgré la chaleur torride des journées, la maison reste fraîche, et le froid des cimes commence à descendre dès que l'ombre s'étend sur la petite plaine. Les nuits sont glacées.
Le feu de la cheminée, renforcé du chauffage électrique artisanal, n'a pas mis trop longtemps pour rendre le lieu accueillant à notre arrivée, mais la condensation a couvert les murs d'humidité jusqu'au lendemain, nous privant d'ordinateur le premier jour. Les variations thermiques ici exigent beaucoup de prudence avec le matériel électronique.
La maison appartient à la famille de Ziddhâ. Elle n'est plus habitée qu'en été, quand des parents viennent de la ville aider aux travaux des champs. Elle n'est d'ailleurs plus très habitable. Le poids de la neige a cintré dangereusement des poutres du toit, dont chaque année, on vérifie quand même l'étanchéité. On remplace éventuellement une ardoise cassée avec le fer d'une boîte de conserve, beaucoup plus facile à trouver et surtout à découper.
La cheminée ne chauffe que deux pièces, à l'est, séparées seulement par un mur de tapis. Deux chambres sont à l'Ouest, qu'on rejoint en traversant la grange, et dans lesquelles l'effet du chauffage électrique me paraît surtout psychologique. Nous vivons donc presque exclusivement dans les pièces de l'Est.
Pour salle de bain, nous n'avons que des toilettes à la turque qui se transforment en douche en rabattant
une grille. Ce système me conviendrait si, pour avoir de l'eau chaude, on ne devait attendre une heure
avancée de la matinée, après que le soleil ait tapé suffisamment longtemps sur la caisse à eau. Je préfère souvent aller me laver comme les chats à la fontaine. Nous nous baignons d'ailleurs assez fréquemment dans la rivière ou dans l'étang.
L'intérieur est principalement meublé de quelques tapis et de beaucoup de peaux ou de fourrures. Les meubles en bois brut sont teintés aux noix. Sous les murs blancs, on perçoit par endroit le bombé des pierres sous le crépi. Entre les tapis et les peaux, on voit parfois le plancher de bois brut.
La maison est en début de côte près du hameau. Un escalier de pierres descend à une fontaine qu'on entend la nuit et qui berce le sommeil. Elle est à l'entrée du jardin. Le bassin de deux mètres sur trois était vide quand nous sommes arrivés. On ne le remplit que l'été, où son eau glacée rafraîchit agréablement son voisinage.
L'eau est conduite de la fontaine au bassin par un tronc creusé. Il est simplement posé sur des pierres et, en le déplaçant légèrement, il est facile d'en modifier ou d'en arrêter le débit afin d'avoir en quelques heures une petite piscine d'eau tiède. Ziddhâ parut surprise de devoir m'expliquer le procédé, lorsque j'exprimai mon regret que l'eau du bassin soit toujours si froide.
Le jardin est une longue terrasse herbeuse qui descend par paliers, ombragée de noyers, de poiriers, de pruniers. À partir de la source, un ruisseau serpente dans des cailloux et alimente des massifs de groseilliers et de framboisiers.
Au pied du jardin passe un cours d'eau qui longe le flanc sud de la côte, pour aller rejoindre l'Oumrouat à l'autre bout de la plaine, peu avant les gorges. Il coule mollement, s'endort sur ses bords marécageux et nous gratifie d'un étang dont l'eau, l'après-midi, avoisine les vingt degrés et davantage.
Nous vivons dehors tout le jour, et ne rentrons dîner qu'au vent du soir. Mon portable nous permet de travailler dans le jardin, où nous avons installé une longue table et tendu une bâche entre les troncs au-dessus d'elle pour retenir tout ce qui peut tomber des arbres sur un clavier. De là, on voit bien, vers le fond de la vallée, la pointe neigeuse du mont Iblis entre les cimes.
— Dis-moi Ziddhâ, lui ai-je demandé cet après-midi, Iblis est le nom du diable en arabe. Pour des Musulmans comme pour des Bouddhistes, n'est-il pas curieux de l'avoir donné à cette montagne ?
— C'est vrai. Je n'en sais rien, je n'y ai jamais pensé.
Le 28 mai
Manzi m'a écrit que les arbres que j'appelle des peupliers depuis le début de mon journal sont en réalité des bouleaux. Je lui fais confiance. Je ne suis pas un bon botaniste.
Le 29 mai
La voiture chauffe terriblement sur ces routes de montagne, nous obligeant à de fréquents arrêts à l'ombre de mélèzes. Nous transportons dans le coffre plusieurs bouteilles d'eau avec lesquelles nous remplissons plusieurs fois le radiateur au cours d'un trajet.
Cette voiture n'a plus d'âge. D'origine approximativement sino-soviétique, elle a été rachetée à l'armée par le père de Ziddhâ à une époque imprécise. La rouille a bien entamé la carrosserie, et en soulevant le tapis, on peut voir la route défiler sous ses pieds.
Le moteur tourne cependant très bien et démarre au moindre tour de clé. Pour le premier voyage qui nous a conduit dans l'Oumrouat, je fus pris au dépourvu, mais à l'arrivée, je me suis assuré moi-même qu'elle n'était pas dangereuse par une vérification complète.
Il y a partout ici des garages cantonaux où sont mis en commun des
outils coûteux, et qui offrent l'usage d'une petite fosse sur laquelle
on peut avancer la voiture et accéder au chassis sans se traîner
par terre.
Ce moteur est un régal. Tout est accessible à la main sans acrobaties, on ne s'embête pas pour tourner une clé, et j'ai pris un plaisir depuis longtemps oublié à régler la combustion et l'allumage.
Maintenant, Ziddhâ a tendance à caler quelquefois et je
tente de lui expliquer qu'elle manque de souplesse en appuyant sur l'accélérateur
et en lâchant l'embrayage. Mes réglages conviennent parfaitement
aux routes de montagne et aux chemins caillouteux, et elle ne devrait
plus tarder à devoir reconnaître qu'ils font consommer un
tout-petit peu moins d'essence.
Ziddhâ, qui ne se doutait même pas que je savais conduire, est surprise de mes talents de mécanicien. Il est vrai que je n'aime pas particulièrement conduire, mais les moteurs ne servent pas seulement à faire rouler les voitures sur des routes qu'on ne peut pas quitter.
J'ai souvent bricolé des moteurs de machines ou d'engins de chantier. J'aime ce dispositif qui produit de la puissance à partir de rien. « De rien ? » me demande Ziddhâ. « Oui, aujourd'hui Lao Tseu dirait : Les parties du moteur sont nombreuses, mais c'est le vide du cylindre central qui fait avancer le tracteur. »
Cassinda, village bouddhiste
À peine cesse le bruit du moteur que j'entends retentir un son clair métallique, prolongé comme celui d'un gong mais haut comme celui d'une clochette. Il me semblait bien avoir entendu le même avant que nous nous garions.
Ce village se trouve bien à huit cents mètres au-dessus de Tawil, le hameau de Ziddhâ, et nous sommes sur l'autre versant de la montagne qui lui fait face. Le village semble complètement endormi dans la chaleur de midi, et ne résonne que le bruit d'une fontaine.
L'eau ruisselle d'un amas de roches moussues enchâssé dans la verdure, coule sur une ardoise légèrement incurvée, et plonge dans un bassin de pierre grise avec un bruit agréable. L'ensemble paraît naturel, bien qu'il ait sans doute été savamment aménagé et soit scrupuleusement entretenu.
Un homme descend lentement la rue, l'air absent, tenant à deux mains devant sa poitrine une louche de métal. Il est coiffé d'un invraisemblable chapeau, genre de haut-de-forme à bord plat mais dont le tuyau paraît être d'une sorte de tulle transparent. Il nous sourit poliment en passant devant nous et continue sa route jusqu'à la fontaine.
Il s'y tient immobile un instant devant un gobelet d'argent posé sur les pierres, que je n'avais pas encore remarqué.
Un nouveau son retentit, il vide l'eau du gobelet par terre, puis le remplit à l'aide de sa louche. Le son retenti encore, et il s'en va comme il était venu, souriant poliment quand il passe encore une fois devant nous.
— Heureusement que nous sommes arrivés au bon moment, dis-je à Ziddhâ. J'aurais cru autrement que le gobelet servait à boire à la fontaine. — Il sert à boire à la fontaine, me confirme-t-elle.
|