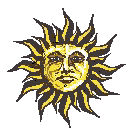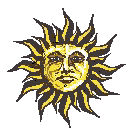Cahier V
De retour à Bolgobol
Le 10 mai
Réveil à Bolgobol
Je me suis réveillé ce matin avec le mot « conquet » qui me tournait en tête. Est-ce un mot palanzi ? Je ne le crois pas et il n'en a pas l'air. Est-ce que ce mot existe ? Il faudra que je vérifie, mais ni mon correcteur orthographique, ni mon correcteur grammatical, ne le connaissent.
Dans mon sommeil, il s'employait avec le verbe placer : placer un conquet. Essayons de le définir.
Conquet, nm. Stratégie militaire : Zone sécurisée servant d'appui à un nouveau déploiement. Logique : conclusion d'une démonstration qui, une fois prouvée, sert de fondement à une autre. Informatique : Dans le logiciel de Douha, désigne une surface non plane modelée par l'outil « Pinces ». Statique : Point de jonction des forces entre un portant et un tirant.
Voilà le faisceau de significations que le mot avait dans mon rêve.
Le tablier de Kaveh
Hammad s'est révélé hier un agréable compagnon de voyage. De quoi avons-nous parlé ? De notre enfance, de nos premiers amours, de la chasse au faisan dans le Vaucluse et de celle de ces sombres chamois, capables de trouver des chemins dans les parois rocheuses où on n'en distingue aucun, des casse-croûte dans le petit jour.
Et cela nous faisait patienter quand nous ne pouvions dépasser les camions de bois aux remorques chargées de longs troncs de sapins, dans ces routes en lacets.
On laisse refroidir une omelette d'épinards, on la coupe et la pose sur une fine galette de pain souple. On place dessus de la chair de truite grillée avec sa peau. On recouvre d'une feuille de salade, et on replie la galette par dessus. Voici la recette d'un casse-croûte local excellent pour le voyage.
Pour l'occasion, nous n'en avons pas eu besoin, car nous sommes arrivés à Bolgobol vers midi. Il m'a conduit chez Manzi et Douha, qui ont tenu à nous garder à déjeuner. Il est un des oncles de Douha.
J'ai encore appris quelque chose au repas.
Les nombreux drapeaux noirs que j'ai vus le premier mai sont ceux du
syndicat unitaire. Ils symbolisent le tablier de Kaveh. Kaveh était
un forgeron iranien qui, au Moyen-Âge, prit la tête d'une
insurrection de travailleurs. Depuis, l'expression est entrée dans
la langue : « brandir le tablier de Kaveh ».
Farid ud Din'Attar le mentionne dans son Ellahi Nameh.
Le 11 mai
Au parc Ibn Rochd
« Tu ne sembles pas avoir entièrement saisi les paroles de mon oncle, me dit Douha : tu as peut-être oublié que Mouhammad était appelé le Prophète illettré (al Nabi am Mummi). » Je ne vois pas très bien où peut mener cette remarque, mais je m'abstiens de l'interroger. Elle ne semble pas disposée à en dire davantage.
Un vent des cimes agite les cèdres et les hauts peupliers du parc Ibn Rochd, sans déranger les canards et les cygnes qui glissent sur le lac, ou semblent somnoler sur la rive. Les épaisses murailles de la vieille ville se dressent au-dessus de nous.
Le parc occupe un étroit vallon derrière une vieille manufacture textile, dont la vaste et solide construction de pierre a été transformée en musée des techniques. En face de nous, de l'autre côté du lac, un petit aqueduc de pierre supporté par des arches, continue à amener l'eau qui activait les métiers. Toutes ces constructions datent, paraît-il, du dix-septième siècle.
Je crois que l'habitude des courriels a déjà commencé à modifier la façon dont ceux qui en font un usage important pratiquent la conversation. Avec un peu d'attention, on les reconnaît vite en parlant avec eux.
Quand on répond à un courriel, on a généralement pris le temps de le lire. On peut le faire immédiatement, il m'est arrivé de recevoir des réponses en moins de trois minutes, mais rien ne nous y oblige. On peut se laisser le temps de la réflexion et continuer à lire les autres messages reçus. L'esprit ne travaille jamais mieux que lorsqu'il se consacre à autre chose après avoir été attentif.
Quand on y revient, le message est toujours là. On acquiert ainsi l'habitude d'un papillonnage qui n'a rien d'une dispersion. Il favorise au contraire l'attention et la suite dans les idées, voire d'étonnants rapprochements. Il protège du vain bavardage et de la dispersion opposée dans l'empilement des explications, des précisions, des mises au point et des nouveaux malentendus qui cherchent à lever les premiers.
En somme, en rapprochant la pratique de l'écrit de la vivacité de la parole, il entraîne celle-ci, en retour, à acquérir la robustesse, la compacité et la longue portée de l'écriture.
L'idée de Douha, ou plutôt notre idée, puisqu'elle synthétise ses réflexions sur les ondes du torrent, et celles de Manzi et moi-même sur la grammaire, mais peut-être bien celle de Douha quand même, puisqu'elle a fait cette synthèse, son idée, donc, a trouvé quelque écho dans le département des structures désordonnées. Elle m'en rend compte après le silence qui a suivi ses remarques sur les paroles de son oncle.
Malgré le vent matinal qui commence un peu à tomber, mai apporte déjà sa chaleur, qui devient torride l'après midi. Sur la terrasse de la crêperie, la serveuse commence à préparer les tables. Du vent, nous ne sentons ici qu'un souffle frais qui n'est pas désagréable et ne dérange pas les parasols.
Étrange construction de bois massif teinté de noir, elle évoque à la fois le chalet suisse par les volets ornés de pots de fleurs, et la pagode par le double toit aux extrémités recourbées, avec une robustesse caractéristique de Bolgobol. Devant nous, sur un îlot qu'un pont de bois relie à la rive, un darlabat de bronze, sous un saule, regarde pensif le sytrenx qu'il tient à sa bouche plus qu'il ne semble y souffler dedans.
L'histoire d'Abu'l Wajid
Je ne sais quel chemin a pu suivre la pensée de Douha quand elle me dit : « Tu sais, Islam n'a jamais voulu dire soumission, mais abandon. » Je suppose que cette remarque est à mettre en relation avec le Prophète Illettré, et la laisse poursuivre.
« Un jour, un chevalier du Marmat demanda au Mâdhî Idris Abu'l Wajid de lui enseigner la voie. Ils étaient près du lac du Balgard, alors le mâdhî le poussa vigoureusement à l'eau. L'homme ne savait pas nager et criait en se débattant. »
« Abu'l Wajid le secourut juste avant qu'il ne se noie et lui demanda s'il n'avait rien appris. L'homme était effrayé et pensait avoir rencontré un fou. Le mâdhî le jeta à l'eau encore une fois avant qu'il n'ait repris ses forces. Et il recommença, jusqu'à ce qu'on eût pu croire que ça n'allait plus finir. »
« À la fin, le pauvre homme en vint à préférer la mort plutôt qu'endurer encore cette torture. Il cessa de se débattre et se mit à prier, s'apprêtant à quitter le monde. Son corps se mit alors naturellement à flotter. »
« Voilà une méthode pédagogique qui me rappelle plutôt le Tchan, dis-je. » Douha me semble plus jeune que Manzi, mais peut-être est-ce seulement la forte carrure de ce dernier qui le fait paraître plus âgé. À moins que ce ne soit son sourire, à elle, avec quelque chose de juvénile, qui la rajeunit.
« Es-tu croyante ? Lui demandé-je. »
« Tant qu'Islam et athéisme ne seront pas identiques nul ne sera un véritable musulman, a dit Abû ul Khaïr, me répond-elle presque en riant. »
« Oui, dis-je, tu avais d'ailleurs déjà répondu à ma question à Bin Al Azar, à propos des signes et des choses ; comme Manzi dans sa thèse sur Ibn Sinâ. Il n'est qu'un seul monde. »
Le 12 mai
Les Fanatiques du Marmat
La traduction par fanatique de motafana est certainement
contestable et confine au contresens, mais elle est littérale,
construite sur la même racine arabe fana (extinction). C'est
la voie de la non croyance, la voie de la certitude construite sur sa
seule expérience.
Abou Barid, le père du motafana, était à la fin du dix-huitième siècle un grand lecteur de Descartes et de Voltaire. Il découvrit ce dernier en correspondant avec une princesse turque qui en avait été l'amie et qui l'avait rencontré souvent en Europe. J'ai oublié son nom, mais on dit que c'est elle qui fit connaître à Voltaire l'ouvrage de Tabari dont on trouve tant d'emprunts dans Zadig.
Pendant la Révolution Française, Abou Barid se rendit en France et vécut quelques années entre Lyon et Paris. Il fréquenta Jean-François Lange, Louis Claude de Saint Martin, Champollion et Sady Carnot. Il y rencontra même Jefferson, alors ambassadeur des États-Unis.
Il rejoignit Martinès de Pasqually dans les Caraïbes à la chute de l'Empire, d'où il suivit les péripéties des Cent Jours, puis il rentra à Bolgobol, où il eut la charge de réorganiser l'enseignement de la philosophie à l'Université.
En ce temps-là, le « désert » et la laborieuse bourgeoisie urbaine — la région n'eut jamais d'autre source de richesse que le labeur — se retrouvaient dans une même sympathie pour les Révolutions Occidentales qui savaient marier le goût des grandes entreprises, la curiosité intellectuelle et l'austérité. La seule chose qu'acceptait mal Abou Barid dans ces lointaines contrées occidentales était leur presque complet manque d'esprit. Selon ses propres termes, c'était comme si « l'esprit se tenait bien au-dessus de leur tête, sous la forme d'un nuage de spiritualité ».
C'est ce qu'il pensait notamment de Saint Martin, avec lequel il resta en correspondance. Il admirait surtout en lui l'écrivain, qui savait s'émanciper des formes convenues, pour écrire des essais qui n'étaient jamais complètement des essais, des romans, des poèmes, des lettres ou des dialogues qui ne l'étaient pas davantage. Il accordait aussi beaucoup d'attention à ses expériences d'écriture automatique sous la dictée de l'agent inconnu.
La grande idée d'Abou Barid, quelque vingt ans avant Karl Marx, était que « la philosophie marchait sur la tête », et que, « si l'homme avait les pieds sur terre, il verrait qu'il est assez grand pour que l'esprit ne flotte pas au-dessus de lui ».
Il ne fut que le père du Motafana. Dans les années 1840, un groupe de ses élèves fonda la revue « Al Fana », qui devient la tribune des intellectuels de la gauche radicale.
L'un de ses principaux fondateurs, An Nawal, germanophone et correspondant de Stirner, traduisit L'Unique et sa propriété en arabe, qu'il présenta comme une « Essence de l'Islam » symétrique à L'Essence du Christianisme de Feuerbach. Le titre qu'il lui donna : Al Wahid wa al Amânouha — l'Unique (nom divin) et son dépôt (le dépôt divin), voir Coran 33/70 — montre assez dans quel sens sa traduction le tirait.
Tabrî, lui, traduisit l'un des essais que Charles S. Pierce écrivit en français : Comment rendre nos idées claires, avant de se retirer à Bin Al Azar où il finit ses jours à élever des moutons.
Le 13 mai
À l'université
J'ai été invité ce matin pour une conférence au Département d'Arabe de l'Université de Bolgobol sur le vin du Vaucluse. C'était naturellement une idée de Manzi que je soupçonne de n'être pas entièrement étrangère à un goût de la provocation. Quelques étudiants refusèrent évidemment de goûter le vin que je leur proposais de déguster, malgré ma suggestion de le recracher après. Ce que je fis d'ailleurs moi-même pour garder l'esprit clair jusqu'à la fin de mon intervention.
S'il m'avait prévenu avant mon départ, je me serais fait un plaisir d'emporter quelques spécimens de Rastau, de Quairanne et de Gigondas, mais je dus me contenter de piquettes locales. Manzi avait eu cette idée en lisant sur mon site mes réflexions sur le langage et les perceptions sensibles, mes remarques sur le vocabulaire de l'œnologie, et ma traduction
de Symbolism (http://jdepetris.free.fr/load/symbolisme/) de Whitehead, qu'il lut naturellement dans le texte.
Je les entraînai donc à goûter le vin, à le voir et, en un mot, le lire, des yeux, du nez, de la langue, du palais et du gosier, puis à tenter de retranscrire tout cela dans le langage.
À la dégustation attentive, les piquettes se révélèrent bien plus délectables que je l'avais craint. La valeur que l'on donne à des crus renommés plutôt qu'à d'autres n'a d'ailleurs jamais été à mes yeux qu'une affaire de préjugés. Tout vin porte en lui son climat et sa terre, il ne dépend alors que de l'art avec lequel le viticulteur l'élève pour qu'il les conserve et les restitue.
Avec Manzi, nous abordâmes longuement la place du vin dans l'empirisme occidental, notamment chez Hume et surtout, dans sa théorie pragmatique du signe, chez Pierce, venu étudier en France l'œnologie ; et nous la comparâmes avec celle qu'elle tient dans l'abondante littérature arabe, plus soucieuse de l'ivresse que du vin lui-même.
À part le couple d'étudiants qui avait refusé de boire, tous semblaient déjà bien initiés à l'ivresse. Aussi furent-ils surpris quand je leur dis que je ne m'en souciais pas, et que les régions viticoles de France étaient celles où l'on comptait le moins d'alcooliques.
« Chez nous, on dit qu'importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse, mais on pense exactement le contraire : qu'importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le vin. On le boit quand on est ensemble, et, de préférence, le cru du lieu. On l'emploie comme une façon de se sentir davantage ensemble là où l'on est. »
Une question inattendue me fit rire. L'un d'eux voulut savoir s'il y avait
un rapport avec l'étendard de la Commune ou le rouge du drapeau
tricolore. Je les ai amusés aussi en répondant à
celui qui me demandait ce que j'avais contre l'ivresse : « Oh
rien, seulement contre la gueule de bois ».
La conversation se termina au restaurant avec quelques étudiants et un professeur de littérature française, dans un étonnant prolongement sur le dérèglement des sens tel que le concevait le Surréalisme.
L'éminent collègue de Manzi faisait remarquer qu'André Breton se référait davantage au feeling empiriste qu'au Fühlung romantique, citant plus souvent Berkeley et William James que Novalis ou Hölderlin.
Le 14 mai
Ici, je suis retourné à l'hôtel, mais je vois souvent Manzi. Fréquemment, nous dînons ensemble avec Douha. Et quand nous ne nous voyons pas, de toute façon, nous nous écrivons.
Un autre caractère de ceux qui pratiquent intensivement le courrier informatique dont je n'ai pas parlé avant hier, est qu'ils ne sont pas pressés de dire, et surtout de tout dire. À chaque instant, où qu'ils se trouvent, ils peuvent renouer le dialogue.
Le vrai web (« le tissage », plus que « la toile ») est celui des conversations. Il suffit de lancer son modem pour que se retissent instantanément les liens d'une quantité de dialogues à peine suspendus.
Parfois, bien après que des propos aient été oubliés, ou, du moins, considérés comme clos, ils traversent à nouveau notre route, réveillant des pensées peut-être trop vite abandonnées, changées par le chemin parcouru. À chaque instant, on peut revenir à des quantités de dialogues ou de forums, qui ne cessent à vrai dire jamais et, tout aussi facilement, s'en retirer sans n'en rien perdre. La parole s'y prolonge, se déplace ou se condense aussi bien que dans l'écrit, et n'a pas, comme dans l'oral, à se répéter.
Manzi travaille en ce moment sur les écrits de Jâbîr
Ibn Hayyân. Jâbir est un cas plutôt rare de personnage
devenu légendaire et dont on ne sache presque rien de certain sur
la vie, mais dont les écrits sont demeurés nombreux et n'ont
jamais cessé d'être accessibles, alors que le contraire est
bien plus courant.
Manzi m'a envoyé par courriel cette notice biographique de la main de Ibn An Nadîm (dixième siècle, quatrième de l'Hégire).
« Il s'agit de Abû 'Abdallah Jâbir Ibn Hayyân Ibn 'Abdallâh Al Kûfî, connu sous le nom de Al Sûfî. Les gens sont en désaccord à son sujet. Les Chiites disent qu'il fut un de leurs dignitaires, un des abwâb. Ils prétendent qu'il fut un des compagnons de Ja'far Al Sâdiq (sixième imam, véritable fondateur de l'ismaélisme) — qu'il soit agréé de Dieu — et qu'il était habitant de Coufa. Un groupe de falâsifa (philosophes aristotéliciens) prétend qu'il fut l'un des leurs, et qu'il a composé des ouvrages sur la logique et la philosophie. De leur côté, les adeptes de l'alchimie prétendent qu'à son époque, le magistère lui revenait et que ses activités étaient secrètes. Ils prétendent aussi qu'il se déplaçait d'un pays à l'autre, ne se fixant nulle part longtemps par crainte du pouvoir (al sultân). On dit encore qu'il faisait partie du groupe des Barmécides auxquels il était dévoué, et qu'il s'attacha à Ja'far Ibn Yahyâ. Ceux qui sont de cet avis déclarent qu'en parlant de son maître Ja'far, il désignait le Barmécide. Les Chiites déclarent qu'il entendait par là Ja'far Al Sâdiq. »
« Un groupe de savants et de conservateurs de bibliothèques a affirmé que cet homme n'a jamais existé. D'autres disent que, s'il a existé, il n'a composé que le Livre des miséricordes ; les ouvrages qui portent son nom auraient été composés par d'autres qui les lui auraient attribués. »
« Cet homme a existé, ceci est patent et reconnu, ses ouvrages sont très importants et nombreux. Il a également composé des livres sur la doctrine des Chiites, que j'énumérerai en leur temps, ainsi que des ouvrages sur des sujets scientifiques divers, ouvrages que j'ai aussi mentionnés dans ce volume. On dit qu'il était originaire de Khurasan. »
Il attend de mes lumières quelque documentation sur l'introduction des ouvrages de Jâbir en Occident. Jâbir y fut en effet connu sous le nom latinisé de Geber, et considéré, à l'égal d'Aristote, comme le plus grand maître de l'alchimie.
J'avais moi-même tenté, il y a plusieurs années, de comparer ses traductions latines avec les textes arabes, et je n'y avais trouvé aucun rapport. On n'en conserve que des éditions du dix-septième siècle et même du dix-huitième. Elles sont de toute évidence des faux, exploités par un libraire-imprimeur : il était fréquent en ce temps de vendre des livres en leur attribuant des noms d'auteurs célèbres et recherchés. Le texte paraît cependant plus ancien que l'édition, et l'imprimeur était peut-être de bonne foi.
C'est ce que je lui réponds en lui joignant quelques URL, notamment celui de la thèse d'un étudiant minutieux qui a relevé toutes les références et les citations d'auteurs dans les œuvres de Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). (Mais Pico lisait l'arabe.)
|