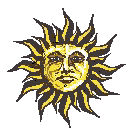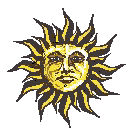Cahier XXVI
Promenade à Bolgobol
Le 21 juillet
Dans Bolgobol
Accroché au sac qui contient mon powerbook, un grand parapluie
bat mes hanches. Il a pris la place du sabre étrenné la
semaine dernière. C'est un très grand parapluie au manche
de bois que j'ai acheté au marché de Bolgobol. Je n'en avais
plus vus de semblables depuis mon enfance.
Je ne connais que trois ou quatre quartiers depuis que je suis arrivé à Bolgobol : la vieille ville derrière ses remparts, le quartier des universités, autour du Parc Ibn Rochd, la rive de l'Ardor avec ses restaurants et ses buvettes, et le quartier Al Watan où j'ai trouvé à loger. J'ai décidé de découvrir un peu plus la ville.
Je ne l'ai jusqu'à maintenant qu'effleurée, et j'ai l'impression de moins la connaître encore qu'Algarod, où je ne me suis pourtant arrêté que très peu de temps. Bolgobol reste toujours sous mon impression première : les imposants bulbes de pierre de ses tours, l'herbe dans les failles des trottoirs.
L'urbanisme à flanc de montagne impose quelques contraintes, surtout
quand une métropole commence à atteindre une taille imposante.
À certains endroits, la topographie reprend ses droits, déchirant
son tissu urbain.
J'aime ce mot « tissu », avec sa famille, « tisser », « tissage »... et son voisinage, « trame », « métier ». Il est la traduction exacte de web, dont je ne comprends pas pourquoi des esprits égarés lui ont préféré « toile ». J'aime mieux employer le mot anglais que cette prétendue traduction.
La ville ainsi est découpée de terrains vierges, très accidentés, faisant des frontières naturelles entre des quartiers qui entretiennent alors leur singularité.
Le chemin de terre que j'emprunte serpente mais reste raide. Il est jonché
de cailloux qui peuvent le rendre impraticable pour une voiture ordinaire.
Je me suis encombré de mon ordinateur, pour lire mon courrier au cours de mes pérégrinations. La demi-journée perdue hier à réinstaller mon système, et les échanges denses qui ont suivi entre Hammad, Razzi et Manzi, m'ont fait prendre du retard dans les autres débats auxquels je participe en même temps. Si je n'ai pas la disponibilité d'y intervenir, je me sens au moins tenu de suivre des discussions que j'ai parfois contribué à lancer.
Remarques sur le SMTP
Il n'y a pas cinq ans que j'utilise des courriels, et je me demande déjà comment on pouvait vivre avant. L'écriture en a acquis la souplesse et la rapidité de la parole sans rien perdre de sa puissance propre. Aussi est-il devenu préférable de correspondre par courriels que se parler de vive-voix, si du moins on tient à se comprendre et à avancer d'un bon pas.
On peut dialoguer à plusieurs sans subir les confusions et les altérations que génère immanquablement l'oralité. Plus question de se couper la parole, d'interrompre le cheminement d'une idée, de la mêler avec celle des autres jusqu'à en faire un brouilli où nul ne reconnaît plus la sienne. Il est aussi difficile d'entretenir longtemps le malentendu, et si simple de le lever.
Rien ne montre mieux comment un esprit suit sa route tout en croisant celle des autres et en s'en nourrissant. La même phrase déploie des sens différents selon comment elle est reprise, sans que cela n'oblitère son articulation dans son contexte initial.
Non seulement le courriel est une invention remarquable, mais il est un parfait entraînement à la conversation orale. Comme je l'ai déjà écrit dans ce journal, je reconnais en leur parlant ceux qui en ont l'usage. Je dois cependant admettre qu'il arrive que d'excellents parleurs ne l'aient pas, ou encore que des bavards du net ne sachent s'en servir. Je ne crois pas qu'il soit possible, en tout cas, de mener une conversation orale soutenue à plus de trois personnes avec la même rigueur, sans au moins désigner un modérateur ou un président de séance.
Beaucoup d'utilisateurs n'ont pas encore compris hélas qu'un tel
outil a des exigences. Les facilités qu'il leur offre les encouragent
au contraire au relâchement. Ils n'y voient qu'un moyen facile de
communiquer à distance, sans considérer que la commodité
de la parole se voit renforcée ici par les ressources de l'écrit.
Aussi les perdent-ils, sans retrouver pour autant la spontanéité
orale.
L'écriture soutenue n'a pas besoin de spontanéité, car elle la compense, ou encore, si l'on veut, elle demeure spontanée. Qu'est-ce en effet que la spontanéité sinon cette capacité à opérer des connexions qui prennent de vitesse les inférences de la raison ? Elle est toujours présente dans la manipulation de signes écrits, et plus encore dans la réécriture.
Une écriture est d'autant plus spontanée qu'elle est relue,
corrigée, recomposée et condensée. Proposée
ainsi à la lecture d'un autre auteur, elle donne d'autant plus
de consistance à sa propre suite d'idées.
Pour la première fois, le smtp offre la possibilité d'une écriture à plusieurs mains. Le texte qui en résulte a une structure complexe, à plusieurs dimensions. Il évoque une table de permutation, une arborescence, voire un réseau hydrographique, mais dont les bifurcations reviennent pourtant toujours converger et se croiser. On en trouverait les prémisses dans les commentaires des écoles confucéennes ou du Tchan, dans la correspondance publiée par Descartes dans le seconde édition de ses Meditatione, ou dans la structure du Tractatus de Wittgenstein. On en chercherait en vain cependant des exemples antérieurs.
Une suite de courriels a pourtant une temporalité linéaire. La chronologie en est même le seul ordre réel.
La transcription d'un tel écrit pourrait faire appel à une formule semblable à celle des partitions d'orchestres, avec plusieurs portées, si ce n'est que l'esprit n'en a pas réellement besoin pour en distinguer la structure.
Anecdote musicale
Ces réflexions me rappellent une récente expérience involontaire. Il m'arrive parfois de composer sur mon ordinateur. J'utilise pour cela un éditeur de partition classique — je ne sais pas me servir d'un éditeur numérique —en m'aidant éventuellement d'un clavier virtuel.
Je ne cesse de m'émerveiller quand, par une simple combinaison de touches, je fais exécuter mes portées par des instruments dont je ne sais même pas jouer. Je fabrique ainsi pour mon seul plaisir quelques mesures de jazz, quelques compositions diverses, ou encore j'essaie d'improviser à partir de musiques locales, comme ici dans le Marmat.
Je m'amusais donc à cela ces jours-ci, quand, par une fausse manœuvre, j'attribuai le même instrument à toutes mes portées. Un programme est aussi virtuose que bête. Il exécuta scrupuleusement la commande, transformant mes subtils accords en une inextricable cacophonie. Il m'offrait ainsi une image sonore de ce que peut devenir un texte collectif lorsque les auteurs ne s'y distinguent plus.
Déplier Bolgobol
En suivant mon chemin de terre, me suis retrouvé en plein cœur du quartier Adonpadomga sans savoir comment. La rue principale regorge de cafés, de salons de thé, et de boutiques. La circulation automobile est dense, plus que dans d'autres parties de la ville, me semble-t-il. On y trouve de nombreux magasins de couture et d'ameublement, à la fois traditionnels et luxueux. La déclivité relativement faible a permis de tracer des axes à peu près droits, et les croisements n'y sont plus en dents de scie.
Ça ne dure évidemment pas longtemps. Je longe maintenant une rue dont le trottoir de droite, protégé par un parapet de pierre, surplombe les toits d'une autre en contrebas. Elle offre une vue panoramique, et même un peu vertigineuse sur la vallée de l'Ardor.
Quelques centaines de mètres plus loin, il n'y a plus de toits sous la route, qui surplombe une large gorge. Je comprends mieux pourquoi il me semblait toujours ne pas avoir vraiment vu Bolgobol. Bolgobol est une ville qui ne se voit pas. Elle est invisible en totalité, de quelque point d'où l'on se place, et peut-être même du ciel. Elle est littéralement pliée, froissée sur son versant de montagne.
Je passe encore sous un pont vertigineux qui traverse l'abîme à quelques cinquante mètres au-dessus de moi, et rend mes jambes un peu cotonneuses. Les cheminements dans l'espace et ceux dans la pensée ont ceci en commun qui me plaît, qu'on peut aisément jouer à s'y perdre, sans pourtant s'y égarer définitivement. Tout reste en place, et l'on parvient toujours à retrouver son chemin.
L'homme et la terre
De l'autre côté du pont, la rue fait un large demi-cercle pour contourner le massif. Elle est taillée dans la roche, et l'on ne rencontre plus aucune construction sur trois cents mètres. Puis elle zigzague en se moulant aux irrégularités de la pente, monte et descend.
Les maisons sont alors faites de matériaux plus bruts. Elles sont plus artisanales, plus rurales qu'à quelques dizaines de mètres plus bas. Elles ne dépassent pas deux étages, avec de longs balcons qui rejoignent la rue par des marches. Les toits très larges débordent sur les trottoirs, surmontant la façade d'une avancée triangulaire souvent percée d'une ou plusieurs fenêtres en ogives.
C'est ce que je vois, du moins, de l'autre côté de la chaussée. Le trottoir où je marche est longé d'un parapet d'où de petits escaliers descendent vers les habitations, dont les toits ne dépassent pas la rue d'un étage. Je longe parfois de petites places terreuses où picorent des poules.
La déclivité s'atténue. Ce ne sont bientôt plus des escaliers mais des ruelles qui coupent la chaussée. J'en emprunte une.
Les maisons dont on ne voyait que les toits montrent leurs façades ensoleillées, dont l'avancée est parfois soutenue par des pilotis de béton ou de pierre. À leurs pieds s'étendent des jardins et des vergers que ne cachent pas les murs bas et les barrières de bois. Des chiens aboient à mon passage, essayant sans conviction de paraître méchants.
Bolgobol n'est pourtant pas une ville figée dans le passé.
On peut n'y emprunter que les grands axes et ignorer toujours ces sortes
de périphéries internes : ces lieux paradoxaux par
lesquels nous trouvons des sorties alors même que nous plongeons
dans ses entrailles. On ferait la même expérience à
Marseille. Promenant au hasard entre la station de métro de la
Rose et l'Institut Méditerranéen de technologie de Château-Gombert,
je me suis retrouvé un jour parmi de petits mas et des chemins
entre des champs, longeant des murs bas en pierres sèches. Je suis
alors tombé nez-à-nez avec un troupeau de moutons.
J'éprouve toujours une impression très forte à circuler dans des lieux façonnés par tant de vies différentes que je pressens à peine. Ces maisons, leurs appartements que l'on devine derrière les rideaux, avec leurs esthétiques à la fois marquées par la culture, collective, et le goût, personnel, sont autant de traces muettes et contradictoires de la multitude et de l'unicité. Et il en est ainsi sur toute la surface de la terre. Le voyage de Marseille à Bolgobol m'en a imposé la vision jusqu'au vertige.
Parmi cette multitude, comment me suis-je attaché ici à une demi-douzaine de personnes ? Chacune d'elles compte pourtant bien une centaine d'amis et de relations diverses. À leur tour, chacun en compte autant, ce qui nous mène à un nombre facteur de dix puissance quatre, et fait déjà une part représentative de la population de Bolgobol. Au niveau suivant, nous sommes à dix puissance six. Au prochain, nous ne sommes plus loin de la population de l'Asie Centrale. Un niveau encore, et on dépasse la population terrestre.
Naturellement, les relations entre les hommes ne se font pas d'une façon
aussi directe, ni si mathématique. On s'enferme en groupes, en
milieux, en classes, en communautés, en castes, et surtout, on
se hiérarchise. Sans hiérarchie, chaque homme serait le
centre d'un réseau qui le relierait à tous les autres. Aucun
homme ne serait jamais éloigné d'un autre de plus de six
niveaux. Au lieu de cela, on se donne des médiateurs, des représentants,
des porte-parole, des commissaires, des guides, des pasteurs, des présidents,
des administrateurs... qui, comme les étagères, servent
d'autant moins qu'ils sont hauts.
Le grand nombre devient alors une gène considérable à la nécessaire organisation de la vie humaine. « On s'organise », dit-on, plutôt qu'on n'organise les conditions concrètes de la vie. La concentration humaine en devient oppressante, si ce n'est oppressive et, en même temps, plus complexe et finalement ingérable. L'histoire des civilisations est celle des naufrages qui en résultent.
Sinon, la distance entre les hommes n'est pas si grande, non plus qu'entre les siècles. Il n'y a entre nous que des langages dont la diversité, dans le fond, nous lie bien plus qu'elle ne nous sépare.
Je longe encore un canal en ciment, me régalant de quelques framboises qui poussent sur sa berge. La ruelle s'est transformée en chemin de terre, puis en sentier, jusqu'à une passerelle qui rejoint un chemin pavé de dalles de gré.
Je le suis jusqu'à un bassin de rétention de seize mètres
carrés environ, où l'eau tournoie dans un vert turquoise
profond, frangé d'écume. Elle se déverse dans un
blockhaus de pierre après qu'une large grille de fer en ait retenu
les bois morts et des déchets divers. Un barrage métallique
ferme le bassin sur son côté sud, en direction de la pente,
laissant passer un filet d'eau dans un grand entonnoir de ciment qui plonge
dans la roche.
Une rambarde métallique protège du vide. La paroi rocheuse semble d'ici tomber en à-pic sur l'Ardor. La vue porte sur l'entrelacs des massifs et des vallées environnantes aussi loin que le permet la nébulosité.
Je reviens sur mes pas. À quelque cinq cents mètres, le canal est couvert, puis se perd sous un piton rocheux, tandis que la route le contourne par le sud. Je passe un portail de fer ouvert, rouillé et couvert de ronces, puis rejoins une rue qui serpente, bordée de petites villas avec des jardins individuels. À mi-lacets, elle est coupée par un grand escalier que je descends. Il me conduit presque sans transition sur une place cernée de hauts immeubles de pierre et ombragée de platanes.
Le temps de faire une pause
La terrasse d'un café m'offre très à propos l'occasion
de me reposer de cette longue marche et de lire mon courrier : une
discussion très technique sur l'accessibilité du html, un
nouvel adhérent à la liste Nisus en Français qui
se présente, un débat sur les possibilités de retrouver
la typographie française grâce aux feuilles de style, la
poursuite d'une vigoureuse polémique sur la liste copyleft-attitude
à propos de la disparition de l'auteur, lancée par Pierre
Petiot..., et cette lettre d'un inconnu :
Subject: Regarding the definition of a text
Dear Sir;
I am an undergraduate at John Brown University in Arkansas, and I am working on a paper for my literary theory class. My paper has three parts, and in researching one part, I found your work at www.zazie.at/language/... etc. Presented with the link to email you directly, I figured it would be worth a shot.
So, I'm trying to argue that any chapter of a book can be analyzed by itself without having to acknowledge its context, since contexts are always changing and there is no definitive context. [...] The question, then, is whether a text is defined by the author or by the reader; and can I legitimately argue that the deconstruction of a passage is legitimate, even without regard for its context. Any information you could provide would be outstandingly helpful. At the very least, thank you so much for your time.
Have a good day.
-Joshua W.
L'homo-sciptor
Je décide de répondre à chaud à la dernière
intervention de Pierre Petiot sur la liste copyleft-attitude, mais
en changeant le sujet « Re-disparition de l'auteur »
en « l'apparition de l'auteur ».
L'auteur ne disparaît pas plus qu'il ne l'a toujours fait. Il n'a jamais cessé de disparaître et n'est même jamais apparu. L'écriture a bien soixante siècles, et nous ne pourrions citer un auteur qui en ait plus de vingt-sept, et ceux-là mêmes disparaissaient vivants dans leurs propres légendes.
Plus vieille encore est l'inscription, la production d'objets symboliques, et pourtant, il y a encore un siècle, combien d'humains savaient écrire? Combien ne savent toujours pas?
Celui qui écrit ne peut s'adresser qu'à celui qui sait lire, et donc écrire aussi. Bref, il n'est d'auteur que pour un autre auteur. Pour ce que vaut l'étymologie, j'en invente une. Auteur est de la même famille que "autre" et "altération". L'auteur altère l'énoncé d'un autre, et le fait autre en somme. C'est pourquoi les auteurs ont toujours disparu: ils sont solubles dans l'illettrisme, ils sont solubles dans la célébrité que leur confère l'illettrisme, ou dans l'anonymat, ce qui est à peu près la même chose.
Comme les maquisards, ils n'existent qu'en réseau. Loin de disparaître aujourd'hui comme ils l'ont toujours fait, je les vois plutôt en train d'apparaître, comme la succession de l'homo-sapiens sous le jour de l'homo-sciptor.
Ce n'est pas l'auteur qui disparaît, mais le lecteur, ou plutôt son illusion comme la condition de l'existence de l'auteur. L'idée qu'il y aurait un cercle d'auteurs et un cercle encore plus large de lecteurs est une illusion entretenue. Les deux cercles se sont presque toujours à peu près confondus.
Ou alors, l'auteur disparaît dans la production d'une consommation de masse. Qui me dira quel poète a eu le prix Nobel quand Mallarmé n'était connu que de son réseau de poètes?
Pourtant, cette apparition de l'auteur, à supposer qu'elle ne soit pas une hallucination de ma part, ne manque pas de me troubler profondément. Je ne suis pas plus capable d'imaginer le règne de l'homo-scriptor que l'homo-faber ne pouvait imaginer celui de l'homo-sapiens.
Peut-être vaut-il mieux regarder alors par le petit bout de la lorgnette. Quand on ouvre une page web, elle est toujours au format de la fenêtre. Ton site, celui de l'Assemblée Nationale ou du Saint-Siège, tout est au même plan. Rien ne me prévient non plus que le site ne soit pas un faux. Rien ne me garantit qu'une information soit vraie, ni ne me prévient qu'elle pourrait être fausse. La découverte de génie côtoie le galimatias de l'idiot.
Ceux qui n'ont rien compris disent qu'on peut mentir, tricher, désinformer. C'est le contraire, on ne peut plus. Quoi qui soit montré ou caché, on juge sur pièce. Qu'on parle en son nom, en celui de tous, d'une élite, des masses ou de Dieu, la fenêtre ne s'agrandira pas.
Ce n'est rien, je sais, mais c'est énorme. Ça n'avait
jamais existé. L'auteur est en train d'apparaître.
Puis je réponds à mon correspondant inconnu en traduisant un bon nombre des éléments du courrier précédent et des notes de mon journal.
En écrivant ces pages
You're right about the fountain pen, m'a aussi écrit Ziddhâ. We are not pure minds, and our understanding pleasures must give some place for our bodies and our souls too. We don't write for the pleasure alone of drawing letters, but how is it easier when the hand asks for more.
Je fais prononcer son courriel par la voix Victoria hight quality, qui me rappelle la sienne quand je la règle sur faster.
|