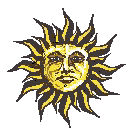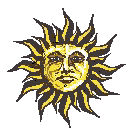Cahier XXI
En retrouvant Ziddha
Le 8 juillet
Rue Al Kobra
Voilà que ce précoce été a brusquement cédé la place à un temps d'automne. Des masses chaudes étouffent l'Europe, l'air froid doit bien être quelque part. J'ai regagné mon petit appartement de la rue Al Kobra, qui me parait bien changé alors que le temps torride a cédé le pas à un fort vent des cimes, et que des nuages d'une étonnante variété tour à tour cachent et laissent passer le soleil, lâchant parfois de grosses gouttes, mais pas longtemps, pas assez pour mouiller le sol. Le bruit de la rivière est maintenant accompagné de celui des feuillages.
Depuis avant hier soir, j'ai pris beaucoup de temps à lire, ce dont je m'étais un peu privé pendant mon séjour à Aggadhar. Ou plutôt, j'y ai beaucoup lu, mais surtout des articles et des interventions.
Le désert du Takla-Makan
J'ai découvert chez le marchand de légume un fort intéressant ouvrage en anglais sur la société du Takla-Makan avant son annexion à l'Empire Tang. Ce n'est pas si loin d'ici en fait, derrière la chaîne de montagnes d'où souffle le vent. À moins de cinq cents kilomètres au sud-est, l'hydrométrie devient presque nulle, et les montagnes tombent brusquement sur le désert du Takla-Makan, au sud de la Région Autonome du Xin Jiang, prolongeant le désert de Gobi.
Le Bouddhisme Mahayana y avait pénétré très tôt, dans les régions de Karadong et de Djimbulak Kum. Bien plus tard, les invasions mongoles y introduisirent l'Islam, qui reste aujourd'hui largement dominant.
La sécheresse du désert, d'un désert froid, conserve bien les matériaux. Des corps naturellement momifiés portent encore des vêtements dont les couleurs sont restées presque intactes. Les tissus, les cuirs et les peaux sont étonnamment bien travaillés. La confection est très sophistiquée : pantalons de cuir brodés, bottes où sont cousues côte à côte des peaux de loup et de renne pour jouer sur des alternances de motifs, invraisemblable bonnet cornu de cuir rouge fourré. Une civilisation de modistes fous.
Les motifs décoratifs sont assez proches de ceux des Scythes.
Le peuple était composé de types ethniques très variés
et déjà très métissés, dans ces villes
aujourd'hui noyées par les dunes depuis que le fleuve Tarin — qui
se jette dans le désert comme d'autres dans la mer —
a déplacé son lit.
Des crânes retrouvés avec des trous ronds, comme des impacts de balles, m'étonnent autant que les auteurs de l'ouvrage. Les armes à feu n'existaient pas il y a deux mille cinq cents ans, même en Chine. Si l'on a utilisé très tôt de la poudre dans des tubes de roseau pour lancer des projectiles, rien de cet ordre ne pouvait de toute façon provoquer de telles blessures. Les crânes ne contiennent d'ailleurs aucun projectile. Des flèches ? Des flèches à pointes rondes ? L'arme devait alors avoir une force singulière pour creuser dans l'os des trous aussi nets sans le briser.
Ce monde était aux confins du royaume des Xixia, envahi par les Mongols en 1207, puis repris par les Tang qui poussèrent leur conquête bien au-delà de Dunhuang et même de Tourfan. Avant cette époque, aucune trace écrite ne demeure de cette civilisation, pourtant évoluée et ouverte sur le monde depuis l'antiquité.
Le pays est très excentré de la Chine. Il est deux fois plus proche du Marmat que de la limite occidentale de la Grande Muraille. Il s'industrialise à marche forcée depuis une vingtaine d'années, et des flots de paysans immigrent depuis les rives du Yangzi Jiang, ou viennent pour la saison prêter main forte à la récolte du coton. J'ai bien envie d'aller y faire un tour avant de rentrer à Marseille. Je demanderai peut-être à Tchanji s'il n'a pas des contacts à me donner.
Le 9 juillet
Les postes de travail de mes amis
Ziddhâ travaille sur un Amiga 3000UX. Sorti au début des années quatre-vingt-dix, il était livré avec un Unix maison SVR4, nommé Amix. Il possède un microprocesseur 68030 à 25 Mhz avec 16 Mo de RAM et un coprocesseur arithmétique. Il embarque aussi une carte réseau et une carte graphique qui pousse la résolution jusqu'en 1024 pixels en 256 couleurs.
Manzi possède un NeXT de 1988. Une station toute noire qui contient un Motorola 68030 à 25 Mhz épaulé par un coprocesseur mathématique, une puce graphique qui affiche du 1280x900 en quatre niveaux de gris. Douha, elle, utilise une NeXT station de 1992, en forme de boîte à pizza, qui malgré ses quatre ans de moins n'offre pas une configuration bien supérieure, mais affiche 1120x832 pixels en milliers de couleurs, et surtout possède un CPU de 64 bits dont le système local sait exploiter toute la puissance de calcul.
Mon vieux Powerbook fait ici figure de machine récente, mais
les postes de travail de mes amis n'ont pourtant rien de bien décisif
à lui envier, malgré ses 48 Mo et ses 166 Mhz
qui ne poussent de toute façon pas la résolution au-delà
de 800x600 pixels.
Nous ne nous sommes plus rencontrés depuis le retour d'Aggadhar. Je suppose que nous nous reverrons bientôt pour en parler. Je ne suis pas prêt d'avoir entièrement filtré l'événement, et je ne me plains pas de me retrouver un peu seul.
Remarques sur les rencontres d'Aggadhar
L'instituteur de Fordoc peut dire ce qu'il veut de Babel, la frontière des langues m'est bien souvent un sujet de désespoir. Je ne me suis pas senti très à l'aise au début des rencontres, où je me trouvais être le seul auteur purement francophone, et même le seul représentant des langues romanes. La plupart des participants venaient des environs immédiats, et une bonne part, des régions limitrophes du Marmat. Si je crois parler un anglais correct, mon accent en rend ici la compréhension difficile tant qu'on ne s'y est pas accoutumé, du moins pour des conversations soutenues. Je me sentis donc d'abord à l'écart.
Heureusement, les pages du site des rencontres étaient de toute évidence épluchées. Les liens qui renvoyaient à mon essai et à mes pages en anglais m'ont valu de nombreux contacts par courriel et de vive-voix. Je n'ai donc pas tardé à participer aux échanges. Si les tables rondes étaient généralement bien préparées, du moins pour ce qui concerne les interventions individuelles, leur organisation restait très ouverte à l'improvisation.
J'ai été plutôt surpris de voir que tous ceux qui
m'ont parlé de mes textes paraissaient y reconnaître les
signes caractéristiques des lettres françaises : ironie,
esprit, volonté de clarté... Quelques-uns y voyaient même
les spécificités d'une littérature occitane, et ils
citaient pêle-mêle Valéry, Sade, Paulhan, Montaigne,
Char ou Cyrano de Bergerac, alors qu'il ne m'avait jamais traversé
l'esprit de chercher seulement un rapport entre tous ces auteurs, et moins
encore de réfléchir à ce que je pouvais avoir de
commun avec eux.
Je me demande s'ils m'auraient lu de la même façon si j'avais présenté mes textes en anglais en cachant ma nationalité. C'est une question bien difficile à trancher. Après tout, les œuvres de Lou Sin lui paraissaient-elles aussi chinoises qu'elles le sont à nos yeux ? Il prétendait lui-même se nourrir principalement de littérature française, russe et japonaise, mais l'aurais-je seulement deviné s'il ne l'avait pas écrit ?
Est-il possible que, plus on parvient à prendre de distance avec toute prégnance de la culture où l'on est né, plus elle devient saillante dans nos actes et nos œuvres ? Et que, plus on devienne universel, en somme, plus on soit enraciné ?
Il est vrai que souvent ceux qui ne sont pas porteurs de leur culture ne sont pas pour autant universels. Ils sont seulement colonisés par d'autres.
Le 10 juillet
Promenade nocturne
J'ai demandé à mon logeur de me louer sa moto pour la nuit. Pour quoi faire ? Pour rouler dans la nuit, évidemment. Il a refusé tout argent, prétextant que j'avais loué mon appartement sans presque l'avoir occupé depuis mon arrivée. Demain vendredi, il ne travaille pas et il tient à me la prêter. Je cesse donc d'insister.
Les nuits sont si belles ici, et le ciel si étoilé. J'ai envie de profiter du vent qui a fini par chasser les nuages. La lune n'est pas encore pleine, mais elle éclaire déjà bien la campagne, et j'espère veiller assez tard pour la voir se coucher derrière le Mont Iblis avant que le soleil ne se lève.
J'aime rouler la nuit, surtout en moto, où l'on ne se sent pas prisonnier d'un habitacle. Il fait très froid. Je profite autant que je peux de l'ignorance ici de toute limitation de vitesse. La nuit, les phares qu'on voit de loin préservent des mauvaises surprises dans les virages et les croisements.
La moto est nerveuse et répond bien. Il faudrait que je demande à son propriétaire s'il veut bien que je règle son embrayage.
Les moustiques s'écrasent nombreux sur mes lunettes, et le foulard me cache le visage jusqu'au nez. J'ai d'abord remonté l'Ardor jusqu'à la raffinerie, puis j'ai pris la direction de l'Oumrouat en passant par la vieille route, celle qui monte en d'interminables lacets. Les derniers kilomètres sont parfois taillés dans la roche en a-pic. On voit en bas les feux de la vallée. Je suis sûr que j'aurais le vertige à pieds.
Je m'arrête au-dessus des gorges. Il fait vraiment très froid. Je m'assois dans l'herbe du talus et allume une pipe. La lune se lève à peine au-dessus de Bolgobol, rouge d'abord, comme un début d'incendie sur la montagne. La Lyre est en face de moi, en plein sud, au milieu du ciel. En jetant ma tête en arrière, j'aperçois Jupiter au-dessus des cimes.
J'ai perdu l'habitude de voir autant d'étoiles, et j'ai du mal à les reconnaître. Le froid n'empêche pas les insectes de chanter, ni les oiseaux nocturnes. Je pense un instant avec émotion à l'air que respirent mes amis à Marseille, et je ne me sens pas pressé de rentrer.
Je roule encore jusqu'à la cluse qui coupe les deux parties de la vallée. Je me gare au-dessus du barrage, où, avec Ziddhâ, nous nous sommes baignés. La lune est cachée par des crêtes et la nuit est très noire. Je dissimule la moto derrière des buissons et je dois utiliser la torche électrique pour descendre au bord de l'eau. J'entends des branches craquer et des bruits qui s'éloignent dans les fourrés. J'ai dû effrayer un animal assez gros.
J'éteins la lampe près de la rivière, et m'étends contre un rocher lisse. J'entends le bruit puissant des lames plus que je ne les vois, accompagné du plus léger clapotis de l'eau sur les roches de la rive. La faible clarté du ciel les strie de lueurs à peine perceptibles. J'en ressens la fraîcheur. Je regarde le ciel jusqu'à ce qu'il cesse de me paraître en haut.
Je devrais mourir maintenant, je n'aurais ni peur ni regret : l'arrêt d'une séparation ; redevenir tout — une séparation qu'on ne voudrait pourtant jamais voir cesser, comme dans l'amour.
Il y a une passerelle à quelques centaines de mètres en amont.
Elle rejoint une petite plaine qu'éclaire maintenant la lune sur
l'autre rive. Je me suis bien couvert et le froid est vivifiant. J'en
prends la direction. Je traverse la rivière, puis la prairie, pour
marcher jusqu'à la lisière du bois en début de côte.
Cela paraît facile à dire, mais c'est bien plus périlleux à faire en pleine nuit. Ce trajet à bien dû me prendre une heure, pendant laquelle j'ai cru me perdre plusieurs fois. J'ai vu ma route coupée par des marais, simples flaques à contourner, sans doute, en plein jour, mais rendues démesurées par l'obscurité, dans laquelle il est bien dur de suivre un sentier. J'ai cessé de me servir de la torche, et mes yeux se sont vite habitués à la nuit.
En atteignant les premiers sapins, je prends conscience de l'imprudence que j'ai peut-être commise en m'aventurant seul jusqu'ici. Je ne suis plus dans les vallées des Alpes ou de la Lozère. Il reste encore des animaux dangereux dans ces régions : buffles sauvages, ours, loups... qui doivent dormir à l'heure qu'il est, me dis-je pour dissiper rapidement mon inquiétude.
La lune rend presque blanches les montagnes de l'autre côté de la vallée. D'une source toute proche, monte comme une odeur de mélisse où se mêle l'arôme des plantes que mes pas ont écrasées. Où que je regarde, je ne vois pas même les phares lointains d'un véhicule égaré dans l'immensité.
Il est déjà plus de minuit quand je redescends la route de la vallée. Je ralentis un peu pour regarder vers la maison de Ziddhâ en passant à sa hauteur. Je suis surpris de voir la fenêtre éclairée. Peut-être de ses parents s'y sont-ils momentanément installés.
S'il y a de la lumière, je ne réveillerai personne. J'emprunte le chemin de terre pour aller y voir de plus près. En arrêtant le moteur, je crie la question idiote : « C'est toi ? » Je reconnais la voix de Ziddhâ qui répond, facétieuse : « Oui, et je vois que je ne suis pas la seule. Toi aussi, c'est toi. »
Encore sur les rencontres d'Aggadhar
Ziddhâ a subitement eu envie d'aller passer la nuit dans l'Oumrouat. Pas plus que moi, elle ne s'attendait à m'y trouver. J'ai craint un court moment d'être venu bouleverser quelque projet, mais elle n'en avait pas de plus précis que moi.
Je n'aurai ni veillé assez tard pour voir la lune se coucher sur le Mont Iblis, ni ne me serai levé assez tôt.
Le caractère plutôt savant des interventions de Manzi et de Gondopharès à Aggadhar, dont j'ai déjà parlé, n'était pas très représentatif. La plupart des intervenants disaient seulement leurs œuvres, poèmes généralement traditionnels, d'où résultaient d'interminables discussions sur le rythme et la versification. C'est du moins ce que j'ai déduit des bribes de traductions et de commentaires que l'on m'en donna, car les langues m'en étaient inconnues.
Je m'interroge encore sur la finalité de ces rencontres. Sans doute pourrait-on me répondre que tout n'a pas besoin de finalité, mais si c'est pour s'en remettre à la causalité, j'aime encore mieux être utilitariste.
« À quoi ça sert » n'est pas pour moi
une question triviale, pour peu que je la corrige sensiblement en « à
quoi je m'en sers », ou « comment je m'en sers ».
(« Wo es war, Ich muß werden » disait le bon
docteur Freud dans une de ses conférences.)
Manifestement, ces rencontres ne servaient pas à stimuler un marché
de l'art ou de la culture. Elles n'avaient pas davantage pour but de divertir
une classe moyenne qui brillait par son absence. Elles n'apportaient rien
non plus au tourisme ni au commerce local. Elles eussent été
perçues comme un événement absurde d'où je
viens, complètement inconcevable, et certainement interdit.
Tout le monde campait, et les coopératives agricoles qui venaient ravitailler les participants en tenant marché sur le quai, cédaient leurs produits à prix coûtant, quand ils ne les distribuaient pas gratuitement, à la grande surprise de la délégation chinoise.
Ce matin, je dois redescendre la moto à Bolgobol. Ziddhâ
veut m'accompagner pour que nous remontions ensemble.
« C'est curieux, tous ces noms cités à ton propos lors des rencontres, me dit-elle. — Oui, c'est une liste plutôt disparate, mais je n'invente rien, c'est bien ce qu'on m'a dit. »
« Non, ce n'est pas cela que je trouve curieux, précise-t-elle, c'est qu'une telle liste puisse être dressée pour une époque encore récente, mais qu'elle ne le soit plus aujourd'hui. Il me semble qu'elle ne le sera plus jamais. — Que veux-tu dire ? »
« L'organisation humaine change. Elle fut hiérarchique jusqu'à aujourd'hui, mais elle ne peut plus l'être. — Pourquoi ? Lui demandé-je — Parce qu'elle devient trop complexe. Depuis les temps historiques, les sociétés ont été dominées par les figures des grands hommes : des savants, des saints, des prophètes, des chefs, des poètes, des généraux, des ingénieurs, des artistes... »
« Il me semble pourtant que ce phénomène s'est accentué au cours de l'histoire, bien davantage qu'il ne s'est estompé, la contredis-je. Au début les grands hommes s'identifiaient à des demi-dieux, à des personnages mythologiques, et les œuvres humaines étaient plutôt anonymes. »
« Bien sûr, ce type d'organisation n'a fait que s'étendre
et se complexifier de façon géométrique. C'est pourquoi
il atteint sa limite. Tu le sais très bien d'ailleurs, c'est même
toi le premier qui m'y a fait réfléchir quand tu es intervenu
au séminaire de Manzi sur Jâbîr Ibn Hayyan. »
Culture et mathématique du chaos
— Je ne suis jamais intervenu sur Jâbîr Ibn Hayyan, même pas sur le Geber des néoplatoniciens. J'en serais bien incapable.
— D'accord, tu es intervenu sur l'inextricable cheminement
des idées dans une civilisation humaine planétaire, se reprend-elle.
Tu m'as montré la culture comme un inextricable chaos dont toute
tentative d'exhaustion serait vaine, et même dangereuse. Elle ne
pourrait conduire qu'à déterminer une culture dominante,
et, en définitive, en faire une discrimination entre les hommes.
Pour autant, on pourrait n'avoir rien d'autre à opposer à
la barbarie de l'orthodoxie que la barbarie de la confusion indifférenciée.
— Le spectacle marchand arrive très bien à concilier les deux, non ?
— Toi et Douha avez une autre conception de la civilisation si
je vous ai bien compris.
— Si tant est que nous nous soyons mutuellement compris : sa théorie des nombres imaginaires et des mathématiques du chaos m'échappe bien un peu.
— Tu me rassures, je croyais être la seule. J'ai bien
compris cependant que tu privilégies l'approfondissement plutôt
que l'exhaustivité : une réalité contient tout
le réel.
— Sans doute en voyant midi à sa porte, on ne le voit pas ailleurs, mais au moins sait-on qu'il est midi. On pourra toujours se comprendre avec celui qui le voit de la sienne.
— J'ai quand même compris ce qu'a dit Douha quand elle expliquait qu'on ne peut analyser une image fractale dans sa totalité, puisqu'elle n'est jamais achevée. On peut en analyser les fragments récursifs et en extraire des fonctions, relativement simples, qui demeurent en procès. Ajoute-t-elle pendant que nous finissons de ranger la cuisine.
— Pourtant, nous n'avons pas cessé de citer des auteurs, des écoles et des ouvrages, et je ne vois pas comment on pourrait en venir à cesser de le faire.
— Ce n'est pas si contradictoire, tu l'as bien montré, en parlant justement de Picco della Marandola et des néoplatoniciens.
— Je ne sais pas. Doit-on supposer que nul n'ignore la roue, ou doit-on perpétuellement recommencer à tout expliquer ?
— Ton exemple répond de lui-même, dit Ziddhâ en fermant la porte. Ce n'est pas la mort d'expliquer la roue, l'eau chaude ou le fil à couper le beurre.
— Je suis pourtant bien conscient que tout ce que nous avons dit ne résoud pas grand chose en pratique. Il n'est pas toujours évident de travailler ensemble sans partager de prémisses.
— Il est peut-être moins évident encore de s'entendre sur des prémisses.
— Sans doute on l'oublie trop souvent. Comme en témoigne la thèse de Manzi, la question est moins récente que la situation présente que tu décris. Elle a de profondes racines.
— Alors, soyons radicaux, allons jusqu'aux racines, dit Ziddhâ en tournant la clé de contact.
J'appuie sur la pédale et les deux véhicules s'élancent dans la fraîcheur du matin. Des bancs de brume traînent encore au fond de la vallée de l'Oumrouat.
|