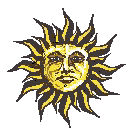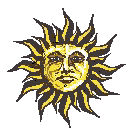Cahier XX
En rentrant à Bolgobol
Le 6 juillet
Sur la route de Bolgobol
« Le néophyte croit que le principal intérêt de l'appareil photographique est de saisir la scène qu'on a sous les yeux pour nous la restituer en deux dimensions. En réalité, l'image photographique vaut plus pour ce qu'elle cache que pour ce qu'elle montre. Elle découpe une fenêtre, et supprime tout ce qui se trouve autour des quatre côtés de la pellicule. Aussi, quoi que nous voyions sur une photo, elle nous laisse imaginer ce qu'en réalité nous ne voyons pas. »
« La même remarque peut se faire pour toute sorte d'images, et même de sculptures. Connais-tu la remarquable analyse que fit Sigmund Freud du Moïse de Michel Ange ? Dans le cas de la photo, toutefois, si l'on veut bien omettre le travail de studio, l'intervention de l'artiste se réduit presque exclusivement au seul cadrage, c'est à dire à ce seul découpage, ce masquage de la réalité. »
« On ne peut manquer de faire un rapprochement avec la peinture à l'encre de Chine, qui suppose une valeur au moins égale des réserves de blanc par rapport aux surfaces peintes. Naturellement, le blanc est alors à l'intérieur de la surface de l'image, et non à l'extérieur. Si, au contraire, il constitue même ce qui en est le plus visiblement saillant, il n'en est pas moins une surface vide et vierge. Tu remarqueras que les cultures qui excellent le mieux dans la photographie, que ce soit pour en produire les instruments ou pour les utiliser, sont justement celles qui excellèrent le plus dans la peinture à l'encre. »
L'orage nous a surpris à peine passé le Col du Gargon. Brusque, violent, avec des éclairs et des tonnerres étourdissants, ses trombes d'eau n'ont pas duré, mais nous ont contraints de trouver un abri dans un tunnel en attendant que la route devienne moins dangereuse. Les odeurs que j'avais senties à l'aller au même endroit, sont maintenant différentes et beaucoup plus fortes, de terre humide et de résineux trempés.
« Jean-Pierre, nous apprécions tous ton étonnante capacité à établir des rapprochements inattendus et à opérer des inférences athlétiques, mais je t'ai posé une question fort simple sur la notion de dérive psycho-géographique, dit Manzi. »
Une pluie fine s'est remise à tomber alors que nous descendons la route en lacets qui nous conduit au fond de la vallée de l'Ardor.
« Manzi, vois-tu le pont en bas ? N'apprécies-tu pas aussi que je tourne le volant plutôt que de donner un grand coup d'accélérateur qui nous ferait nous y écraser en quelques secondes ? »
Manzi me répond d'un soupir. L'Ardor n'est encore qu'une petite rivière et nous sommes loin de Bolgobol.
— La notion de psychogéo-graphie, continué-je, a été conçue par l'Internationale Situationniste dans la perspective d'un Urbanisme Unitaire. Elle-même était dans le prolongement des travaux du Bauhaus et du Constructivisme soviétique. Une telle perspective, remarque-le, pouvait très bien prendre un tour concret dans les années cinquante, alors que tu n'étais pas né. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est plus à l'ordre du jour. Elle ne se concrétisa d'ailleurs pas à l'époque, où il eût été pourtant profitable aux uns comme aux autres, que l'IS collaborât avec quelques municipalités communistes européennes à des réalisations précises, au moins de façon expérimentale.
— Je me disais aussi qu'avec notre appareil photo nous aurions plutôt eu l'air de touristes stupides aux yeux des situationnistes.
— Les situationnistes n'ont jamais compris la photographie. Ils prenaient trop au sérieux les dépliants publicitaires. Aujourd'hui, ils croiraient que les ordinateurs servent à échanger de la musique et à commander des pizzas.
— Ta perspective, alors, en quoi consiste-t-elle ?
— Veux-tu que je coupe droit ou que je négocie les virages ?
— Coupe droit.
— Réconcilier la notion mécanique de travail et celle de travail intellectuel.
— Bon, négocie les virages.
Ce matin à Algarod
Les essuie-glaces de la voiture de Ziddha sont très bruyants. Ce bruit ne me dérange pas, tout au contraire. Rien, je crois, ne permet mieux d'apprécier la pluie que le mouvement et le bruit des essuie-glaces.
« Ce matin à Algarod, commencé-je, nous nous sommes évertués de quitter les chemins tout tracés que nous aurions pris si nous avions eu quelque chose de précis à faire. Même si nous avions fait du tourisme, nous serions au moins allé visiter les citadelles. Nous avons au contraire cherché des chemins de traverse et nous avons trouvé ce que nous pourrions appeler des passages dérobés. À quoi ressemble le monde alors ? »
« Je te le demande, me répond Manzi. »
« Il ressemble à un cadavre-exquis, dis-je, à un collage surréaliste, à une figure alchimique. Il est fait de cassures saisissantes, comme celle qui nous a frappé ce matin en passant l'enceinte de la vieille ville. Souvent moins criantes, ces cassures sont cependant de chaque instant dans un paysage urbain, et même naturel. »
« C'est ce que nous pouvons expérimenter tout à loisir avec un appareil photographique, et notamment avec un bon programme de retouche d'image. Il n'y a qu'à zoomer successivement sur un point, même pris au hasard. De nouveaux détails vont à chaque étape modifier notre appréhension du lieu tout entier, comme du détail. »
« Note bien ici ce que je veux te faire remarquer. Ne t'arrête pas à la conception triviale qui croirait qu'un grossissement nous révélerait davantage et nous rapprocherait de la réalité ; il nous renseignerait plutôt sur le peu de réalité. »
« Un détail modifie notre appréhension de l'ensemble. Comme, dans l'autre sens, l'ensemble modifie notre appréhension du détail. Comment fait-il cela ? En nous entraînant à construire, pour chaque détail, un nouvel ensemble virtuel. Alors pose-toi la question. Où et quand y aurait-il un ensemble réel ? »
« Je ne suis pas sûr de te comprendre, m'interroge Manzi. »
« Souviens-toi quand tu étais enfant. Quand j'étais petit, je descendais la rue, mais en réalité, je longeais un cañon. Les cheminées des toits étaient des cactus qui dominaient ses parois. Au croisement pouvaient surgir des peaux-rouges. »
« Peut-être penses-tu que je ne devrais pas dire "en réalité" ? Si, au contraire. J'étais bien plus dans la réalité qu'un adulte qui sort machinalement de chez lui pour un parcours quotidien. Je voyais le monde avec une telle intensité qu'il est bien difficile d'en conserver une semblable capacité toute sa vie sans la cultiver. »
« Un de mes oncles était bâtisseur. Devant un terrain, il voyait déjà des fondations, des heures de travail, le prix des matériaux. Il voyait tout ça comme enfant j'aurais vu des indiens. J'ai un voisin paléontologue. Au même endroit, il verrait le cours des siècles, celui des millions d'années. Qui est hors de la réalité ? Tous la voient. Et ils ne verraient rien s'ils ne la rêvaient pas. »
— Tes virages commencent à me donner le tournis, renvoie Manzi. Tu ne connais pas un chemin plus droit ?
— Cesse de te plaindre. Il est impossible d'aller plus droit, et je peux même t'expliquer pourquoi. Admettons que nous pensions avec notre cerveau.
— Soit.
— Le cerveau accumule et conserve en mémoire toutes les données sensibles qu'il reçoit par le tissu nerveux. Comment s'y prend-on alors pour penser avec ?
— Je suppose que tu vas me le dire.
— On le fait un peu à la manière dont se constitue un réseau hydrographique sur un territoire. La pluie ruisselle, s'écoule, suit au début la pente et les anfractuosités, mais se met très vite à raviner, creuse des rigoles, des rus, des vallées, dessine des plaines alluviales. Comme la pluie, nous dessinons nous-mêmes notre paysage mental.
Je ne sais si Manzi perçoit mieux mon idée, ces derniers mots, toutefois semblent lui parler davantage, et sans doute entrent-ils en résonance avec les propos qu'il me tenait le mois dernier au bord de l'Ardor.
— Tu veux dire que nous établissons des liens entre des percepts d'origines diverses, par exemple l'éclair et le bruit du tonnerre, ou la taille des ombres et la hauteur du soleil.
— Oui, si ce n'est que les liens ne sont pas nécessairement déterminés par la causalité. Ils peuvent l'être parfois, sans que l'esprit ne l'identifie en tant que telle, ou encore lui être totalement étrangers. Ces liens ne sont pas davantage logiques, ils sont sémantiques.
— Par exemple, précise-t-il, si quelqu'un qui a des yeux bleus nous cause des ennuis, ensuite nous nous méfions de tous les gens qui ont des yeux bleus, même s'il n'y a aucun lien logique ni causal ?
— Exactement, pour concevoir la nature d'un lien, on doit d'abord le percevoir, et même l'inventer. Comme pour produire des énoncés sensés, on doit d'abord avoir un langage, qui lui n'a pas de sens a priori.
— Tu passes peut-être un peu vite du sémantique au linguistique.
— Sans doute. Un système linguistique, c'est à dire syntaxique, principalement, renforce les possibilités de cette circulation. Elle est ce qui permet l'aménagement de canaux, de barrages, de dérivations, d'irrigation, de pompages, etc.
— Oui, mais c'est quoi alors l'esprit dans ta métaphore ? L'eau ou l'ingénieur des eaux ?
— De toute façon, un ingénieur est constitué d'eau à plus de 90%.
La pluie ne tombe presque plus. Le ciel et les montagnes maintenant se pénètrent. On est entouré de nuages. On en voit à gauche, à droite, et même dessous. S'étirant sur les pentes, ils accentuent leur verticalité.
— Tu essaies peut-être de me dire, reprend Manzi, qu'il y a une solution de continuité entre le déplacement des stimuli qui dessinent le réseau synaptique et le mouvement dans l'espace géographique.
— Oui, si ce n'est que ce qui se passe exactement dans un cerveau n'a aucune importance, puisque le savoir n'enseignerait pas comment s'en servir. Par exemple, si je demande à quelqu'un d'être moins attentif aux sens des mots, mais davantage à leur forme sonore et à leur ponctuation, je n'ai pas besoin de lui dire quelle partie de son cerveau il doit activer, à supposer que je le sache.
Supposons que ce soit le lobe frontal droit. Quel sens y a-t-il à conseiller de se servir de son lobe frontal droit ? Sauf à faire une métaphore ?
— Je crains fort, justement, que tout ce que tu as dit soit une suite de métaphores peu fertiles. Il y a sans doute d'intéressantes images à faire entre le déplacement dans l'espace physique, les connexions neuronales, et les associations linguistiques, mais il est bien problématique d'aller plus loin.
Sais-tu pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre une image et un modèle. La première n'est qu'intuitive — et tu sais déjà que je ne sous-estime pas cet aspect-là —, l'autre s'établit sur une quantification exacte.
— Tu veux dire que qualitative is poor quantitative ?
— Il ne s'agit pas de cela. Qu'importe lequel on déduit de l'autre. Il nous faut les deux.
Les nuages cachent complètement la rivière en dessous de la route, dont il me semble pourtant entendre le courant.
« C'est plutôt de cela qu'il s'agit au contraire, insisté-je. Est-ce que tu dois d'abord découvrir la balance pour trouver le levier ? A priori, il n'y a rien de quantitatif dans un levier, ni la longueur de la barre, ni la place du point d'appui, ni la masse, ni la poussée. Tout cela est qualitatif avant d'être quantifié. D'ailleurs la quantification se fait comme seule, quand tu as le qualitatif, ou plutôt, elle se fait par le dispositif. Vois d'ailleurs les premières unités de mesure : le pouce, la coudée, la brassée, etc. »
« Un simple rapport topologique suffit pour qu'un dispositif matériel le quantifie automatiquement. Il n'y a plus aucune raison alors de s'ébahir que les nombres rendent compte des comportements réels. Ils en sont déduits. »
« C'est la philosophie implicite de Galilée que n'a jamais perçue Descartes. C'est aussi bien son athéisme implicite que l'Église cherchait à condamner sans pouvoir l'expliciter. Il est évident alors qu'aucun Créateur ne peut avoir donné des lois auxquelles se soumettrait sa création. »
« Quand Newton a inventé le quadrilatère des forces, il n'a pas dit que c'était une image. Il a dit que c'était une loi. Ça signifie que ça marchait. On pouvait s'en servir pour construire des voiles triangulaires. Quand Freud a repris ce même quadrilatère des forces pour expliquer le déplacement et la condensation dans le rêve, il a dit que ce n'était qu'une métaphore. Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-il pas dit que les mêmes lois de la mécanique s'appliquaient au travail de l'esprit ? »
« Parce qu'il lui manquait des unités de mesure, m'interrompt encore Manzi. »
« Peut-être le croyait-il, dis-je. Dans ce cas il avait tort. Newton n'en aurait pas trouvé s'il avait pensé ainsi. En réalité, c'est parce que Freud ne pouvait pas dire comment on devait se servir de son modèle. Il expliquait comment fonctionnait le rêve, pas comment on devait s'y prendre pour rêver. Newton apprenait au charpentier de marine comment dessiner un voilier. »
« Si Freud avait eu une telle posture, il n'aurait pas écrit Sur le Rêve, il aurait écrit un traité de poétique, ou le Manifeste du Surréalisme. Il n'aurait pas inventé la Science des rêves, il aurait jeté les bases d'une science poétique. »
« André Breton, lui, s'est engouffré dans cette voie. Quand il cite Pierre Reverdy, "plus le rapport sera lointain et juste, plus l'image sera forte..." il n'explique pas l'image poétique par une image poétique : c'est quasiment une loi scientifique. Elle en a la forme et le fonctionnement, mais ni lointain, ni juste, ni forte ne peuvent prendre de valeur quantitative. »
« Oui, fait Manzi, je commence à voir où tu veux en venir. Justement, toutes les premières unités de mesure que tu nommais évoquent toujours des gestes : pas, coudée, brassée... »
« Tu as bien de la chance. Moi, je crois qu'à force de virer, je me suis perdu. En tout cas, si tu n'as pas oublié ta question, je ne crois pas y avoir répondu »
« Si. Et pas si mal. Tu décris la dérive psycho-géographique comme la forme d'expérimentation la plus simple du fonctionnement réel de la pensée. Tu as bien raison de recommander de s'équiper pour prendre des notes et des photos. Tu pourrais aussi penser à enregistrer du son. Enfin, l'écriture est le plus important. On peut tout noter : ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent... tout. »
Pour permettre de bien comprendre la conclusion de Manzi, je me rends compte ici que j'aurais dû décrire avec plus de précision comment nous avons procédé ce matin. Nous avons marché, mais nous nous sommes aussi arrêtés pour écrire.
J'ai recommandé à mes amis de s'attacher à des détails parmi ceux qui s'offraient à leurs yeux, et d'y focaliser leur attention. Le mieux était alors de les décrire minutieusement. Voilà pourquoi j'ai insisté pour emporter un appareil photographique, qui permet de cadrer une image, et d'oublier tout ce qui est hors-champ.
À partir de ces descriptions locales, je leur ai demandé de continuer en passant à l'environnement. Il devenait alors manifeste qu'en commençant par dépeindre avec minutie des détails distincts, l'ensemble du lieu, qui était objectivement identique pour tous, devenait subjectivement très différent pour chacun.
Le même procès pouvait être reproduit plusieurs fois dans un même lieu à partir d'autres détails, et la vision d'ensemble se trouvait modifiée encore pour le même observateur. En somme, sans changer de place, nous nous trouvions au même instant dans des lieux totalement différents.
Vers midi
J'aime la pluie. Naturellement, je n'aime pas me tremper en marchant ni m'encombrer d'un parapluie. Je n'aime pas non plus rester dans des vêtements humides, ni n'apprécie les gouttes d'eau sur mes lunettes, mais la pluie à l'abri, que ce soit derrière un pare-brise ou les vitres d'un relais routier, est une des plus belles visions que puisse offrir le monde.
Les nuages font leur réserve de blanc sur la campagne comme dans une peinture à l'encre. Lumières et couleurs offrent des variations bien plus riches et plus douces que par temps sec. Les sons, avec l'humidité de l'air, sont plus purs et portent mieux, et la pluie dégage des arômes de ce qu'on croirait sans odeur, les pierres, les planches, les tôles. Même l'eau n'est plus tout à fait incolore, inodore et insipide.
C'est un temps excellent pour s'arrêter dîner dans un relais routier. Le restaurant est un peu retiré de la route, presque indécelable sans son panneau, dans un vaste plan jonché de flaques entre l'usine et la rivière, où stationne une douzaine de camions. On y accède par un chemin de terre bordé de buis et de quelques joncs.
Le visage de Ziddhâ se reflète dans la vitre et se surimpose à ce que je vois à travers : d'abord les installations industrielles au premier plan, deux sortes de fourneaux, peut-être des caissons de rétention de je ne sais quel fluide, avec leur treillis de tuyaux, de vannes et de robinets, et derrière, un massif rocheux tacheté de neige et de nuages. Des gouttelettes ruissellent sur cette image composite, comme si elles étaient sur la peau de Ziddhâ.
|