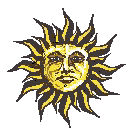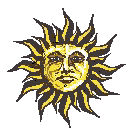Cahier XIX
De retour
Le 5 juillet
Une semaine plus tard
Le soleil se lève trop tôt maintenant pour que je sois plus matinal que lui. C'est aussi bien, car, si les journées sont chaudes, les aubes sont glacées. Tard encore, les feuilles étaient couvertes de minuscules gouttelettes de rosée blanche, près de la cabane, de l'autre côté du verger abandonné, où nous avons campé pendant une douzaine de jours.
Je n'ai plus tenu mon journal depuis le début des rencontres, ou plutôt, tout ce que j'ai écrit à cette occasion n'y aurait plus sa place. On peut de toute façon en trouver une part substantielle en cherchant sur le site de la manifestation. (Il suffit d'interroger un moteur de recherche en rentrant « rencontres d'Aggadhar » en palanzi.)
À Algarod
Ce matin encore, assis sous les arcades de la madrassat déserte, je méditais sur ces portiques qui ont donné leur nom dans deux langues différentes à deux écoles de philosophie, qui n'en font qu'une à deux moments différents. Épictète était bien un Grec de Damas, devenue plus tard la capitale de la falsafa.
Nous voilà déjà ce soir à Algarod pour passer la nuit. Je ne sais pourquoi, il est des lieux auxquels on s'attache plus qu'à d'autres. À l'aller, je ne me suis pas attardé plus de deux heures sur la Place des Darlabats, et cette ville m'est devenue familière.
Une impression de bien-être m'envahit parmi ces murs de pierres grises, ces toits d'ardoises aux festons de bois, ces volets pleins, dont les fleurs à toutes les fenêtres compensent l'austérité. Est-ce son assise fortifiée, ses citadelles en surplomb, qui donnent irrationnellement un profond sentiment de sécurité ?
Le 6 juillet
Petit déjeuner à Algarod
« Finalement, me demande Manzi, qui fait des progrès en Français de jour en jour, et sait de mieux en mieux lire mon journal, ta famille est-elle originaire de Jordanie, ou descend-elle d'un général romain, qui était Catalan, je crois ? »
« Ni l'un, ni l'autre. Je plaisantais. Elle a toujours été de Marseille, de la même lignée que Pétrone, le premier romancier occidental, qui n'habitait d'ailleurs pas loin de chez moi, de l'autre côté du Vieux-Port. »
« C'est vrai ? s'exclame-t-il. »
« Bien sûr, mes ancêtres étaient déjà là au néolithique. À la veillée, j'entendais des histoires qui se transmettaient des génération en génération, et qui remontaient jusqu'à l'époque de la grande glaciation. Il y avait alors des villages dans toutes les calanques, et le niveau de la mer était plus bas... »
« Allons, réfléchis un peu. Qui peut faire remonter sa généalogie sur une vingtaine de siècles ? Je n'ai même jamais connu mon grand-père. Ma grand-mère vivait dans une communauté anarcho-syndicaliste et elle fût sans doute la seule à savoir qui c'était. »
« C'est vrai ? répète Douha. »
« Va donc savoir. »
« Il descend d'un amphioxus, ajoute Ziddhâ. »
Une expérience psycho-géographique
La vallée de l'Ar Roula, qui remonte jusqu'aux Sources Chaudes et, de là, au Col du Gargon, parvient à concilier dans ses paysages des impressions contraires. À la fois hiératiques et souriants, démesurés, accueillants et sauvages, ils sont particulièrement variés avec des forêts épaisses, des zones rocheuses et pelées, des prairies vallonnées, des parois déchiquetées. La ville d'Algarod, qui en ferme l'entrée, en conserve quelque chose.
Ses murs, son architecture en sont-ils réellement porteurs, comme si la ville était la « conversion » au format urbain, de celui de la nature ? Ou bien est-ce parce que mon image de la ville est contaminée par les territoires qui l'environnent ? L'appréhension que nous avons des lieux est au moins aussi changée par les trajets que nous traçons autour, que le sens d'un mot l'est par son contexte. (Cette remarque complète bien celles que j'avais faites à l'aller.)
D'ailleurs, le chemin du retour m'a fait découvrir des paysages sensiblement différents. Quand je voyais dans un sens des régions qui m'évoquaient déjà la steppe mongole ou la taïga sibérienne, au retour, je reconnaissais au même endroit les prémisses des contreforts himalayens.
Ces réflexions m'ont donné l'idée ce matin d'entraîner mes amis dans une expérience amusante.
Le stylo, c'est l'homme
Nous nous munissons chacun du nécessaire pour prendre des notes et des croquis. Manzi et Douha emportent aussi leur appareil photo : un Zénith soviétique, excellent reflex qui doit être plus vieux que Ziddhâ, et que j'ai déjà utilisé quand on était dans la vallée de Bor Argod. Puis nous nous engageons au hasard dans les rues d'Algarod.
Je remarque alors avec horreur que Ziddhâ s'est munie d'un stylo bille en plastique. J'avais bien quelquefois observé qu'elle prenait des notes avec n'importe quoi quand nous étions ensemble au travail devant l'écran, mais ce n'était pas proprement écrire.
« Tu ne vas pas me dire que tu vas te servir de ça ? » Elle me regarde étonnée. « Enfin, Ziddhâ, le stylo, c'est tout » insisté-je. « Tu n'exagères pas un peu ? »
« Pas du tout, crois-moi. Le style, la qualité du papier, les documents, la culture personnelle, l'ambiance, le confort, les idées, le talent, l'imagination, tout cela n'est rien, rien du tout sans un bon stylo. »
« L'écriture a besoin du plaisir d'écrire, et ce plaisir est physique. Si l'on n'éprouve pas du plaisir à tenir un stylo entre ses doigts et à faire danser la plume sur la surface qu'elle noircit, que pourrait-on écrire de bon ? Et ne viens pas me dire qu'un bon écrivain n'a besoin de rien de tel. A-t-on déjà vu un bon cavalier chevaucher un âne ? On ne pense pas bien si l'on écrit mal, et l'on n'écrit pas bien si l'on ne sent pas ses doigts épouser le fil de sa pensée et tresser le contour des lettres. Sans le plaisir que donne un bon stylo, l'esprit se vide et se dessèche, on n'est plus rien, rien du tout. »
« Eh bien je n'ai rien d'autre », me répond-elle inconsciente. « Qu'à cela ne tienne », dis-je en lui saisissant le bras à la recherche de la plus proche papeterie.
« Un bon stylo doit avoir un certain poids et être composé dans un matériau agréable au toucher : ébonite, cuivre, acier, bois, or, bachélite, tungstène, platine... Il n'est pas nécessaire qu'il soit précieux et cher, il doit être sensuel. Il importe aussi que la plume ne sèche pas si on la laisse décapuchonnée un certain temps. »
« On peut bien préférer une plume fine ou large, qui fasse un trait délié ou uniforme, qui soit souple, ou dure comme un poinçon. Tout ça n'est que question de goût, mais l'encre doit couler fluide et généreuse. Rien n'est plus insupportable qu'un trait qui a des ratées. »
« On n'est pas obligé toutefois d'écrire avec un stylo. On peut utiliser une plume d'oiseau, un pinceau, un roseau, mais ce n'est pas très pratique. On peut préférer un crayon, ou une mine de plomb. Dans tous les cas, on doit choisir un parfait instrument, apprécié par sa main. On ne m'a pas attendu pour rédiger des traités apprenant à tailler une plume d'oie ou un roseau, ou à préparer son encre sur une pierre. Sais-tu qu'il existe peut-être plus de manuels à ce propos que de traités de grammaire ou de rhétorique ? C'est comme aujourd'hui les ouvrages sur l'édition et l'encodage de texte, sur le HTML, les CSS ou le PHP, ou encore les manuels de traitements de texte. Utiliserais-tu n'importe quel traitement de texte pour écrire ? »
« T'es-tu déjà servi d'un pinceau et d'une pierre d'encre ? Crois-tu qu'on ait inventé le stylo-plume pour se mettre, après tant de progrès, à écrire comme des cochons ? Non, le stylo est l'apothéose de dizaines de siècles, de centaines même devrais-je dire, car l'écriture ne serait rien sans le dessin, le trait, l'inscription sous toutes ses formes. »
« C'est très important, continué-je en me tournant vers Manzi et Douha, surtout pour vous qui avez des enfants. Que faut-il pour réussir des études ? Un bon stylo. Qu'importe même d'écrire à genoux et sur du papier d'emballage ? L'élève remplit alors ses pages d'équations, de rédactions, de versions... pour le seul plaisir de s'en servir. »
« Croyez-vous que si les hommes choisissaient mieux leurs stylos, le monde irait comme il va ? Croyez-vous qu'il y aurait tant d'enfants et d'adultes illettrés ? Ne soupçonnez-vous pas le complot du baron Bic contre l'éducation libre et gratuite ? Et pourquoi nos ancêtres auraient pris la Bastille, si leurs enfants devaient écrire au stylo bille ? »
Sur ces deux alexandrins, la vieille ville n'étant pas bien grande, nous débouchons sur la Place des Darlabats. C'est alors que je vois, tout à côté du café où je m'étais assis une première fois sans y préter la moindre attention, écrit en grosses lettres koufiques sur la devanture : Dar al Kalam, et dessous, en plus petites lettres latines : The Fountain Pen Home. Le destin a parlé : « Maison du Stylo ».
« L'important, dis-je encore en entrant, ce n'est pas seulement de trouver un bon stylo, mais de trouver le sien. »
Mon stylo
Acquérir un stylo est une opération difficile, et cela pour deux raisons principales. La première est que les vendeurs ont tendance à se prendre pour des bijoutiers. La beauté de l'objet n'est certes pas négligeable. Elle est nécessaire, mais loin toutefois d'être suffisante. On ne se contente pas de le contempler ; on écrit avec. Le plus important est donc ce qui se voit le moins : le système d'alimentation qui conduit l'encre jusqu'à la plume. Celui-ci doit laisser passer un peu d'air, permettant de contrôler le débit de l'encre et d'éviter qu'elle ne se répande indûment. On ne peut se livrer à une telle vérification chez un marchand, qui ne nous laissera jamais utiliser la pompe, ou placer une cartouche d'encre dans un stylo neuf. On ne pourrait de toute façon pas s'assurer de son bon fonctionnement sans un assez long usage.
Le seul critère pourrait encore être le prix. Si l'on suppose
qu'un bon stylo soit plus cher qu'un mauvais, qu'on se détrompe.
Et c'est la deuxième source des difficultés, qui n'est pas
sans rapport avec la première. Les différences de prix entre
des stylos sont proprement extravagantes. Elles s'expliquent principalement
par la préciosité des matériaux, mais cette dernière
n'a généralement pas d'autre fonction que cosmétique.
Si les stylos hors de prix, qu'on utilise surtout pour signer des contrats et des chèques, marchent généralement bien, et si les bon-marchés qu'on réserve aux écoliers sont presque toujours inutilisables, il est à peu près impossible de savoir à quoi s'attendre avec ceux qui ont un prix raisonnable.
Celui que j'utilise en est un bon exemple. Il y aura bientôt une dizaine d'années, j'ai acheté une parure complète, composée du stylo-plume, du stylo-bille et du porte-mine, dans une grande surface. En fait, seul le porte-mine m'intéressait, mais le prix dérisoire auquel l'ensemble était soldé faisait du lot une meilleure affaire que d'acheter un porte-mine seul.
Je supposais que le stylo-plume serait un jouet inutile, mais je fus surpris de voir qu'il écrivait bien et, en cuivre laqué, qu'il se tenait bien en main. À l'usage, je découvris qu'il ne séchait jamais, aussi longtemps que je le laissais sans capuchon, et que sa plume, en iridium bicolore, était tout à fait à mon goût, dure et d'épaisseur moyenne. Son seul défaut était que sa bague, trop fine pour mes doigts, me fatiguait la main à l'usage. Je ne l'utilisai donc que pour corriger des épreuves à l'encre rouge.
Plus tard, j'en acquis un nouveau, dont la forme et la substance m'avaient séduit, mais le bas prix me laissait prévoir le pire. Dans le style des années cinquante, d'un beau noir laqué comme le précédent, il était beaucoup plus large et me permettait d'écrire sans fatigue.
Je ne me servis plus que de lui pendant quelques mois, mais, au-delà de cette période, l'alimentation de l'encre commença à me jouer des tours. Je découvris alors que le pas de vis du système d'alimentation était exactement le même que celui du précédent. Je les échangeai donc. Je gagnai même un ou deux millimètres qui éloignaient mes doigts du papier et rendaient plus souples leurs mouvements, sans gêner la fermeture du capuchon.
J'utilise maintenant un stylo absolument unique, et je dois dire qu'entre temps j'en avais acheté plusieurs dont le prix était bien supérieur à la somme des deux dont j'avais fait un seul.
Ad Dar al Kalam
Dans la boutique, je prends les choses en main et détaille mes exigences à la jeune vendeuse, au demeurant fort compétente, qui nous renseigne longuement sur les systèmes d'alimentation de l'encre. Elle me conseille des stylos de fabrications locales en nous entraînant vers leur présentoir : une vitrine aux montants de bois ciré, dans laquelle, sur trois niveaux coulissants lorsqu'on ouvre l'élégant petit meuble, ils reposent dans des cannelures tapissées de velours ocre.
De ma vie, je n'en ai jamais vus de semblables. D'un très bel acier, ils m'évoquent des canons d'armes anciennes. Leurs tailles sont à peu près égales, mais leurs formes et leurs couleurs différent : certains sont cylindriques, d'autres biseautés. Il y en a d'acier clair, noir, et moiré. Quelques-uns sont ciselés. Quelques-uns ne sont qu'un tube droit, coupé net aux extrémités. D'autres ont, vissées, des bouchons en forme d'ogives, ou en tubes de moindre gabarit.
Ma main se porte spontanément vers un noir moiré, biseauté sur huit côtés, et dont le capuchon est ciselé d'une calligraphie de style floral, si ramifiée que je ne parviens pas à la déchiffrer. « L'important n'a aucune importance, » lit Ziddhâ en arabe.
« C'est un hadith du Prophète, » complète la jeune femme en nous invitant à dévisser le capuchon. « Je croyais que c'était un hadith de John L. Austin, » intervient Manzi. Moi, j'avais pensé à un fragment de Démocrite, mais j'ai tendance à lui faire confiance.
Le stylo se tient par une bague de bois. « De merisier, »
précise la vendeuse. Me le prenant des mains, elle le dévisse
encore. Il contient une pompe, amovible si l'on préfère
utiliser des cartouches. Elle la retire et dévisse l'embout qui
emprisonne la plume, entraînant avec lui tout le corps d'alimentation
de l'encre.
« Si vous voulez l'essayer, nous dit-elle, ils ont tous le même
dispositif d'alimentation, et nous en avons un de prêt. »
Joignant le geste à la parole, elle en visse un autre, prolongé
d'une cartouche pleine. Tandis que Ziddhâ s'en saisit, je m'inquiète
du poids de l'objet pour de fines mains féminines. Je le trouve
d'autre part un peu viril pour elle. Il n'en fallait pas davantage pour
qu'elle ne veuille plus s'en séparer. Elle hésite à
reconnaître que le trait est épais pour son goût, mais
l'admet quand on lui dit qu'on peut changer la plume.
Ceci fait, je lui suggère d'acheter des cartouches, de le remplir et de l'essayer à nouveau ici même, afin de pouvoir l'utiliser sans délai. J'en profite pour régler discrètement la facture, qui ne me semble pas excessive, même pour le pays.
« C'est un beau cadeau que tu m'as fait là, dit-elle quand on se retrouve sur la place. Il faudra que je t'en fasse aussi un en retour. »
« En attendant, ajouté-je alors que nous longeons la fontaine, ne tombe pas à l'eau avec. Tu ne remonterais pas. »
À travers la vieille ville
Nous commençons par monter en direction des forteresses. Les rues deviennent plus étroites, plus serpentines, se prolongent d'escaliers, s'ouvrent de petits porches, conduisant à des escaliers plus étroits encore. Il n'est pas encore sept heures trente.
Qu'on ne s'y trompe pas. Nous sommes ici à l'heure locale. La France est restée à l'heure d'été après l'occupation allemande, et avait donc une heure d'avance sur le soleil. Quand on revint à la coutume de rajouter une heure en été, dans les années soixante-dix, on avançait donc les horloges de deux heures. Quand les montres françaises indiquent neuf heures, il est en réalité sept heures au soleil.
On ne comprend pas bien le sens d'un tel usage, puisque, insensiblement, on prend coutume de se coucher et de se lever plus tard. Je ne suis donc pas tellement plus matinal que mes compatriotes en me levant avant six heures, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un magasin de stylos ouvre à sept.
Nos pas nous conduisent sur un chemin pavé qui longe les murailles à la hauteur des toits. Il a à peine la largeur nécessaire à un petit attelage, et un parapet d'une trentaine de centimètres de haut et d'épaisseur protège du vide. Il contourne le piton central, et nous finissons par nous retrouver en aplomb de la vallée de l'Af Fawoura. Nous passons les murs de la vieille ville par une dernière redoute déserte.
Sans transition, alors que nous n'avons pas dû marcher plus d'un quart d'heure depuis le magasin, nous nous retrouvons dans un paysage qui n'a plus rien d'urbain. Quelques petites fermes à moitié troglodytes, telles que je ne me souviens pas d'en avoir jamais vues à l'aspect si misérable, s'accrochent à la côte.
Des sentiers terreux, des escaliers taillés dans le roc et devenus lisses, les relient à de minuscules potagers ou des champs de luzernes, exploitant le moindre bout de terre en pente. Des cordes sont fixées par endroits pour aider le paysan chargé de ballots dans les passes difficiles. Des poulaillers de planches et de grillages composites mêlent leur bruit à celui du vent.
Le vent, qui n'est pourtant pas très fort, produit une sorte de rumeur, à peine perceptible, faite d'agitation de buissons, de souffle entre les roches, et peut-être de rien du tout, seulement ce vide qui s'ouvre devant nous, limité au loin par des crêtes de neiges.
|