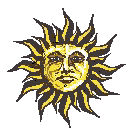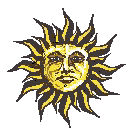Cahier XVIII
À la veille des rencontres
Le 26 juin
En quatre jours, le nombre de personnes qui sont déjà venues s'affairer autour de la madrassat s'est sensiblement accru. L'anglais demeure largement la langue de communication, mais déjà certains n'en parlent pas un mot. J'ai quelquefois reconnu de l'ourdou, et même du russe.
Je suis de plus en plus perplexe sur la forme que vont prendre ces rencontres, et me demande la place que je vais devoir y tenir.
La bibliothèque de la Madrassat d'Aggadhar
Je suis allé voir dans la bibliothèque. Le bâtiment a plutôt bien résisté au temps, mais il est évident qu'on l'y a aidé. La toiture et les combles ont été restaurés à plusieurs reprises, contrairement aux habitations qui sont largement en ruine et totalement inutilisables. La bibliothèque a eu un régime de faveur dont n'a même pas bénéficié la mosquée, et elle conserve une grande quantité d'ouvrages manuscrits. Aucune pièce unique, cependant, ni un manuscrit antérieur à sa construction, n'y est encore conservé, m'ont affirmé tous ceux qui m'en ont parlé.
La madrassat n'a pas fonctionné longtemps, une génération tout au plus, et jamais elle n'abrita le nombre d'étudiants pour lequel elle avait été construite. L'idée de bâtir une telle université, loin de tout, coupée du monde, ne s'est pas révélée viable, et il est bien dur d'imaginer comment et pourquoi elle a pu être conçue.
Parfois des hommes s'isolent pour se protéger du pouvoir. Ils se regroupent derrière des montagnes, des déserts ou des mers. Se créent alors des centres dérobés — comme on dit passage dérobé —, dont parfois même la mémoire s'efface, mais pas l'empreinte dans l'Histoire. Parfois ces centres paradoxaux — dans tous les sens du terme — font de violents retours en force.
Sinon, la fuite du monde sans autre intention que de ne pas se laisser distraire par lui n'a jamais été une voie fertile, et je conçois mal quelle autre raison aurait pu inspirer la construction d'une madrassat à Aggadhar.
Je soupçonne même que cette concentration d'intellectuels oisifs était le meilleur moyen de mettre un terme à l'extension de l'Islam, comme la suite a paru le confirmer. Ne produisant rien d'autre qu'une part de leur nourriture, leur encre et leur papier, ni ne se préoccupant davantage de combattre et de se défendre, ils ne faisaient qu'accroître leur distance avec leurs contemporains, en prétendant sans doute œuvrer pour les autres.
Je me demande si, aujourd'hui, l'immense industrie des biens culturels ne risque pas d'aboutir au même résultat pour l'expansion occidentale.
Leïla Abindra
À défaut de compatriote, j'ai trouvé une francophone, et qui vient, elle aussi, de Marseille, plus précisément de sa forte communauté comorienne. Une lointaine ascendance du Kérala indien donne à Leïla Abindra des traits plus méditerranéens qu'africains et une peau très noire. Elle parle avec effort un excellent Français, qu'elle a appris au lycée de Moroni, et en saisit toutes les finesses si l'on se donne la peine de prononcer avec lenteur des phrases bien construites, quelle que soit leur complexité. Elle l'écrit parfaitement.
Elle va bientôt entreprendre un stage d'insertion en suivant des cours d'alphabétisation. Comme je m'en surprends, elle m'explique qu'elle voulait étudier l'anglais, mais les travailleurs sociaux ont jugé qu'elle ne les comprenait pas bien quand ils parlaient, et qu'ils ne la comprenaient pas bien non plus. Je la rassure en lui apprenant que je suis exactement dans le même cas, et lui recommande surtout de ne pas perdre son excellent français. Ça la fait rire.
Elle possède aussi un arabe littéral très classique qu'elle parle comme si elle venait du Hidjâz. Elle doit d'ailleurs s'efforcer d'en simplifier la syntaxe quand elle souhaite que je la comprenne. Elle a un peu écrit en ces deux langues, mais son œuvre est essentiellement en comorien.
Elle ressemble à une princesse dans son sari aux couleurs éclatantes. Peut-être en est-elle une.
Les rencontres de demain
Il commence à m'apparaître que ces rencontres vont prendre la forme de tables rondes, ou de petits séminaires, sur des sujets précis autant que divers. Les intervenants mettent en ligne de la documentation et des textes avant leur intervention, et chacun peut ajouter librement les siens, ou insérer des commentaires. Il est seulement demandé de ne pas donner des documents trop longs à parcourir. Parfois une liste de diffusion est proposée pour la préparation de la table ronde.
Quand les participants se rencontrent, ils ont déjà une idée très précise de quoi ils vont parler, et des points de vue de chacun.
En fait de table ronde, il n'y a pas de table du tout, seulement des tapis, carrés, où prennent place, sans ordre défini, une ou plusieurs douzaines de personne qui discutent alors librement. Dans certaines salles, des groupes utilisent du matériel informatique, parfois des matériaux, ou des instruments de musique, traditionnels, parfois rien du tout.
Manzi va intervenir sur les théories de la grammaire et de la musique de Al Farabi à Al Kindy. Je suppose qu'il y pense depuis qu'il m'en a parlé à Bin Al Azar. Son texte préparatoire, en arabe, fait accessoirement allusion à l'incidence des travaux des philologues motazilites sur l'origine de la chimie. Al Kimiya, vient de l'adverbe kam (combien) pour désigner une science des mesures, des proportions et des combinatoires. Le thème du groupe est l'intelligible, le sensible et la puissance sur le réel.
Gondopharès, le délégué de l'électricité, y interviendra aussi sur l'instance du souffle et du signe dans le Sepher Yezirah et les Upanishads du Yoga.
Je savais qu'il n'était pas musulman, et son nom m'avait fait tenir pour évident qu'il était bouddhiste. Gondopharès était en effet le roi Parthe qui fit du Bouddhisme la religion de son empire, puis envoya des missionnaires dans toute l'Asie du Sud-Est et une part de l'Asie Centrale, donnant ainsi naissance aux écoles du Hinayana. Je ne fus pas peu surpris quand il m'a appris qu'il était juif. Quoi que peu nombreux, les Juifs ne sont pas absents du Marmat. Leur nombre s'est même sensiblement accru au début du vingtième siècle avec des réfugiés d'Europe de l'Est, pour baisser ensuite avec la création de l'État d'Israel, qui fait fonction de sas à des juifs d'orient pour immigrer, cette fois, en Europe.
Gondopharès descend, lui, de la très ancienne communauté juive du Marmat, originaire depuis l'antiquité des régions de Bactriane, du Gandhara, de l'Hindou-Kouch et du Sakestan. Il n'est pas croyant, mais reste très attaché à sa culture, à la fois à travers la gnose kabbaliste, et les minorités des révolutions européennes : Gustav Landauer, Rudolph Rocker, Erich Mühsam... En plus de l'hébreu, il manipule un peu de yiddish, et donc l'allemand.
Un retour de courriel de Manzi
------------------------------
Salut Jean-Pierre,
On Wed, 25 jun 2003 08:22:49, jdepetris Wrote:
> Cher Manzi,
>Tes remarques sur une éventuelle origine arabe de la chimie (alchimie) ne semblent pas tenir compte que le mot Kimia existait déjà bien avant en grec.
Oui, mais existaient déjà l'arabe, l'araméen et l'hébreu, toutes langues qui se partageaient la même racine "kam".
La chimie aux temps de Zozime d'Alexandrie concernait la teinture des tissus, et presque tous ses contemporains se préoccupaient de combinaisons de pigments. La chimie était alors celle des couleurs, et n'avait encore rien de commun avec une théorie de la matière comme chez Al Kindy ou Jâbir.
SYS, Manzi
P.S. Je ne t'apprendai pas que "vers" se disait "carmina" en Latin.
------------------------------
Une nouvelle forme d'organisation humaine
Je me rends compte qu'il est absolument impossible que chacun communique avec tout le monde. La barrière des langues l'interdit, mais elle n'est pas la seule. La population qui se rassemble forme des groupes relativement fermés. Même avec une langue commune, on les imagine difficilement se comprendre, ou seulement avoir quelque chose à se dire. Individuellement, pourtant, des rencontres improbables ont lieu.
On trouve un curieux mélange de bardes folkloriques, faisant vivre, envers et contre tout, leur langue, leur littérature et leurs instruments traditionnels, comme de jeunes gens qui ne savent plus écrire qu'avec un clavier, des performeurs excentriques et des adeptes du texte pur et dur, que sais-je encore ?... On chercherait pourtant en vain ce qui ressemblerait à une barrière entre les anciens et les modernes.
Tous ces groupes, aux contours d'ailleurs mal définis, s'ignorent largement, du moins en apparence. En y regardant mieux, beaucoup d'individus peuvent être de plusieurs à la fois.
Cet ensemble sans ordre, mais non sans cohérence, me fait entrevoir plus concrètement que jamais la possibilité d'une nouvelle forme d'organisation humaine tout à fait viable, à la fois plus complexe, plus riche d'infinies connexions, et, somme toute, plus simple à gérer que la traditionnelle division en groupes et en représentants de groupes.
L'architecture de la Madrassat d'Aggadhar
La madrassat est bâtie avec du calcaire rose, assez semblable
à celui qui a servi à la construction du petit temple des
sources chaudes près d'Algarod. Les passages couverts font un feston
de colonnades qui relie entre eux tous les bâtiments. Ces arcades
constituent une efficace protection contre les intempéries, et
devaient être appréciées des oulémas
(savants) et des taliban (étudiants), quand ils arpentaient
leurs galeries, les bras chargés de livres. On soupçonne
vite, pourtant, qu'elles avaient une fonction plus fondamentale. Elles
offraient une remarquable transition entre les différents espaces
d'activités et l'extérieur, et faisaient un idéal
lieu de rencontre. Très différents de ces espaces dans lesquels
on doit se rendre délibérément pour se rencontrer
quand on n'a rien d'autre à faire qu'à tuer le temps en
vains bavardages, ils favorisent la rencontre fortuite, où l'on
retient un ami parce qu'on veut rester un moment avec lui.
Les nombreux bancs de pierre, les petits parterres qui devaient laisser s'épanouir des plantes et des fleurs, les bouches de fontaines aujourd'hui à sec, confirment l'intention délibérée de l'architecte, comme ces avancées des murs entre les bancs, servant de portants à des ogives, et qui pouvaient faire office de séparations, aussi bien que de tables pour lire ou écrire en plein air.
En avant-corps devant les façades ou en chemins couverts entre les corps de constructions, les portiques sont soutenus par d'épaisses colonnes rondes, qui finissent en ogives galbées en forme de bulbe traditionnel de l'architecture du Marmat.
La décoration n'abuse pas de la calligraphie, mais tire au contraire parti des surfaces aveugles et des aplats. Les lettres ne sont pas gravées, mais dessinées en mosaïque à l'aide de blocs calcaires carrés aux tons différents.
Les épais caractères koufis sont aux antipodes de l'arabesque. Il est souvent très difficile de reconnaître une écriture dans ce cubisme abstrait occupant des surfaces carrées, ou en heptaèdres, de deux à six mètres de côtés. On imagine d'abord le plan d'un labyrinthe ; peut-être celui du site lui-même, gravé sur le mur pour aider le promeneur égaré. C'est ce que j'ai cru devant la première inscription que j'ai vue. Je m'amuse depuis, devant chacune, à imaginer la perpétuelle mutation du lieu que je parcours.
Sur la page de Gondopharès
Le mot sanscrit yoga signifie d'abord « attelage ». On le rencontre dans les textes védiques où il désigne l'attelage du char d'Indra ou de Sârya (le Soleil). Maîtrisés par la main du cocher, les chevaux sont dits yukta, c'est à dire contrôlés, dans le sens où leurs efforts sont coordonnés. Le mot yoga prend aussi dès l'origine le sens complémentaire de « méthode », appliqué à n'importe quelle activité intellectuelle.
Les mots atman et brahman désignent deux idées qu'il est bien dur de comprendre séparément. Atman signifie « âme », au sens très large de « vie ». C'est donc ce qui caractérise un être vivant, en ce qu'il a un minimum d'intuition de lui-même, de souvenir de son histoire et de son identité ; mais c'est aussi l'âme universelle, le vivant, non pas en tant que principe, mais en tant que réalité unique qui anime tout ce qui vit. La métaphore de la jarre est alors souvent employée, dont l'espace intérieur épouse la forme, mais n'est pas affecté si l'argile se brise.
Qu'on songe aux vers de Hugo : Pourquoi mettre au-dessus des êtres des fantômes ? / Les clartés, les éthers ne sont pas des royaumes, / Place à l'atome saint qui brûle ou qui ruisselle ! / Place au rayonnement de l'âme universelle !... (La Légende des Siècles - Le Satyre.) Je le cite délibérément parce qu'il a été explicitement assimilé par la vieille religion jaïniste, l'une des plus anciennes de l'Hindouisme.
Comme on pourrait traduire atman par « âme », à la fois source de l'identité et sans identité, on pourrait traduire brahman par esprit. Le brahman est l'idée, l'absolu, l'abstrait. Entendons par là qu'il est la seconde condition de la conscience.
L'atman correspondrait à l'arabe l'anniya, l'ego latin, mais certainement pas le self (soi), même pas myself (moi-même), plutôt un Iness (je-ité, je-itude ?) ; tandis que le brahman serait al furqân (la discrimination). Le brahman, c'est ce qui reconnaît, par exemple, une couleur, disons le rouge, alors que cette couleur n'existe jamais que comme attribut d'un objet particulier coloré, et qu'il n'y a pas deux rouges absolument semblables. C'est aussi bien la conception de la couleur, alors qu'il n'y a pas de couleur dans l'absolu, mais seulement des couleurs particulières. De même qu'il n'y a pas le nombre en général, mais seulement des nombres, et au fond, même pas des nombres, seulement du nombrable, du nombreux.
Le yoga doit se comprendre selon ces deux concepts, dont il se fait la méthode de coordination. Qu'est-ce qui va alors faire fonction d'attelage ? le corps : très exactement le souffle du corps, la parole. C'est précisément ce qui nous intéresse ici, plus que les prémisses de la langue, de la culture et de la métaphysique indienne.
Comprenons bien ici la différence entre parole et langage. Ce dernier désigne seulement une articulation de signes et de significations. La parole émane du corps, du vivant.
Le corps est l'instrument. Chacun sait que la musique n'est pas l'instrument, qu'elle n'est même pas dans l'instrument. On la produit en apprenant à se servir de celui-ci. Au cœur d'un instrument, au cœur d'une machine, il n'y a généralement que du vide, comme au centre du corps, il n'y a que la contenance des poumons, et le creux central du cœur et des vaisseaux sanguins.
[...]
La goutte d'ambroisie (Amrtabindu Upanishad)
13/ Oui, l'atman est comme l'espace/ enfermé dans la jarre : nombreuses celles-ci/ et pourtant lorsqu'une jarre est détruite/ on ne pense pas que l'espace/ qu'elle enfermait est détruit avec elle/ car on sait que l'espace est éternel.
14/ Captif des prestiges du Verbe/ on ne va pas au but suprême/ pas plus qu'on ne trouve un lotus/ en le cherchant dans les ténèbres/ mais que l'on s'en délivre/ et l'on voit aussitôt l'Unité.
15/ Pourtant on dit que le Brahman/ c'est le verbe, la Parole articulée/ en fait lorsque la parole est détruite/ ce qui reste est le Verbe Pur/ la résonnance primordiale/ sachant cela on peut méditer sur le Verbe/ si l'on désire la paix de l'atman.
16/ Ce sont là deux doctrines/ dignes l'une et l'autre d'être connues/ car le brahman est à la fois le verbe/ et l'absolu après le verbe./ Il faut d'abord connaître le verbe-brahman/ puis dépasser le verbe et chercher l'absolu.
Le son immortel (Amrtanâda Upanishad)
24/ Il est le son par excellence/ l'impérissable qui se situe/ au-delà de toutes les catégories :/ voyelles ou consonnes, sourdes ou sonores/ palatales ou gutturales/ labiales ou nasales/ semi-consonnes ou aspirées,
25/ et c'est par lui/ que l'adepte discerne le chemin/ sur lequel il conduit le souffle/ il faut donc qu'il le pratique sans cesse/ pour ouvrir le chemin au souffle.
Historique
Ces upanishads sont écrites en sanscrit classique, et versifiées sous forme de sloka : strophes de quatre octosyllabes. Cela ne veut pas dire qu'ils soient, à notre goût, toujours poétiques, et leur traduction n'arrange rien. On est loin de la rigueur des sûtras ou de l'exactitude des bhâsya. Anonymes et non datées, elles imitent la langue et le style des upanishads des Védas, au moins antérieures au sixième siècle avant J-C. Elles leur sont pourtant très postérieures. On peut imaginer que les auteurs de ces textes quelque peu hérétiques voulaient, au moins par leur aspect formel, s'attribuer une caution védique, mais on peut penser aussi que ceux qui les lisaient ou les entendaient en leur temps étaient parfaitement renseignés sur l'archaïsme de leur style et la modernité de leur contenu.
Des remarques semblables peuvent être faites à propos du Sepher Yesirah. Sans date ni nom d'auteur, il est parfois présenté comme remontant à la captivité à Babylone. Si c'était vrai, il serait alors contemporain des textes védiques qu'imitent les Upanishads du Yoga, mais il est de toute évidence, comme eux, bien plus tardif.
Il serait amusant qu'on parvienne à établir un jour qu'ils sont contemporains les uns des autres. Je n'en serais pas autrement surpris.
Premières lignes du premier chapître du Sepher Yezirah
« C'est selon les trente-deux voies de la Sagesse, les trente-deux Mystérieux Sentiers, que le Seigneur des Armées, Dieu-Vivant et roi de l'Univers, Dieu de Miséricorde et de Grâce, Dieu Sublime séjournant dans l'Éternité a formé et créé l'Univers par trois Sepharim (numération) : Séphar (le nombre), Sipour (le nombrant), Sépher (le nombré), contenus dans dix Séphitoth (propriétés) qui sont un et identiques en Lui. Les trente-deux Mystérieux Sentiers de la sagesse consistent en cette décade sortie du néant et en vingt-deux lettres fondamentales... »
Il est temps d'aller se coucher
Gondopharès, mais aussi la bibliothèque de la madrassat, et ce voyage tout entier, m'entraînent dans un monde qui me donne le vertige. Partout dorment des sommes d'écrits dont l'archivage et la cartographie dépassent l'imagination. La somme des littératures occidentales m'apparaît soudain dérisoire, avec son antiquité dont il ne reste presque plus rien — celle, pour reprendre la phrase de Paul Valéry, de « cette péninsule du continent asiatique ».
C'est peut-être la raison pour laquelle l'imprimerie, venue pourtant d'Asie, a si bien réussi en Europe. Plus encore qu'un moyen de diffusion du texte, elle était celui de son contrôle et de sa régulation : une façon de décider de la venue ou non à l'existence d'un texte, autrement que par sa seule écriture ; de contenir la profusion, le palimpseste et le détournement.
Cette attitude me semble voir son terme, emportée par son propre produit : la numérisation des données et l'internet. Est-ce pour cela, comme le pense Manzi, que les bibliothèques irakiennes ont brûlé, pour détruire ce qui peut encore l'être ?
|