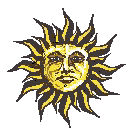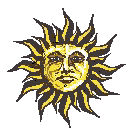Cahier XV
En route vers Agghadar
Le 22 juin
Sur la route d'Agghadar
« Se rendre à Saint Jacques de Compostelle à pied implique que le temps du voyage se déroule essentiellement avant l'arrivée. Prendre l'avion pour Bolgobol, au contraire, implique de voyager une fois arrivé, » a écrit Pierre-Laurent Faure. En fait, je ne suis pas arrivé par avion à Bolgobol, qui n'a qu'un minuscule aéroport à quelques kilomètres au sud. J'ai d'abord atterri à Tangaar, d'où j'ai pris le car.
Voyager, circuler, me donne envie d'écrire. Ce n'est pourtant pas très évident, surtout quand on conduit le véhicule.
J'écris certes beaucoup plus dans ma vie que je ne voyage, mais ces deux activités sont pour moi parentes, complémentaires, au point qu'elles se chevauchent et se bousculent quelque peu. J'aimerais écrire ce que mes mains sur le volant font surgir à mes yeux, mais quand mes mains prennent la plume, elles ont la légitime impression d'avoir déjà accompli ce travail. Le travail de la plume et celui du volant ont en commun de tracer des parcours, mais plus encore, en faisant cela, de déployer des territoires.
Bisdurbal est une ville asghode, même si elle est restée longtemps sous le contrôle du Marmat. Elle n'a été rattachée à la République Tangarde qu'à la fondation de cette dernière, à la fin du dix-neuvième siècle.
J'ai moi-même du mal à imaginer ce que signifiait un tel contrôle, puisque le Marmat n'a jamais constitué ce que nous pourrions appeler un gouvernement. Je suppose que cela devrait se traduire par une présence militaire pour protéger les voies de communication et les croyants des différentes communautés.
Bisdurbal a eu aussi ses fortifications, mais elle ne fut pas bâtie à flanc de côte. L'ancienne ville était en terrain plat, plus en amont de la nouvelle qui utilisa largement les pierres de ses murailles comme matériau de construction.
La route d'Agghadar nous replonge en plein pays Marmat. Ici l'Islam n'a pratiquement pas pénétré, c'est pourquoi la madrassat vers laquelle nous roulons est depuis longtemps abandonnée et partiellement en ruines. La quasi-totalité de la population est restée bouddhiste, ou plutôt a-t-elle largement abandonné toute forme de pratique et de croyance religieuse, ce qui, dans le fond, n'est pas très étranger au Bouddhisme du Marmat.
Ils ont cependant largement intégré ici la versification arabe, pour une raison qui devient évidente si on la connaît : nous sommes dans le Marmat équestre. Il y a des chevaux partout : dans les prairies, au bord des routes, ce qui est normal, mais même au cœurs des agglomérations, attelés à des carrioles, portant des cavaliers, attachés devant les magasins.
La poésie est rythmée sur la marche, le trot ou le galop du cheval. Même quand les gens se parlent, ici, on en devine le rythme. Ils avancent d'abord au pas vers leur sujet, puis, lorsqu'ils l'ont délimité, ils l'approchent au trot, et ils l'emportent alors d'une charge au galop dont ils tirent manifestement plaisir et fierté.
On est sensible à de telles choses quand on ne connaît pas un mot d'une langue. Il semble que parler procure ici un bonheur caractéristique, différent de celui que l'on trouve, par exemple, à Marseille, ou dans d'autres régions où la parole procure aussi une joie certaine.
Notre convoi doit bientôt s'agrandir. Un ami nous attend près de Bor Bolgoby pour finir la route avec nous
Tchandji
« Alors les talibans ? » nous lance d'une voix forte Tchandji tandis que nous descendons de voiture. Manzi s'incline respectueusement et lui répond : « Quel grand homme sous un si petit chapeau ! » Puis ils se jettent dans les bras l'un de l'autre avec force éclats de rire et grandes tapes dans le dos.
Tchandji est un petit homme très vif aux yeux bridés. Je lui donne la cinquantaine si le soleil ne l'a pas prématurément ridé. Il porte une moustache et une barbiche très noires, peu fournies et mal taillées, qui lui donnent un petit air de gitan, avec ses bottes, sa veste élimée et son foulard qui bat au vent. Il est effectivement coiffé d'un assez petit chapeau de feutre à bords étroits.
On the road again
« Mais non, m'assure Tchandji qui est monté avec Manzi
et moi, la Grèce n'a pas marqué profondément l'Asie.
C'est le contraire. Tu crois cela parce que tu pars de la philosophie
grecque, et tu en pars parce que tu la connais. Si tu achètes tous
les livres qui contiennent le nom de Protagoras, il est probable que tu
vas déduire que le Sophisme tient une place considérable
dans l'Histoire. Tous les Grecs dont tu parles venaient déjà
d'Asie, et ils s'y sont même enfoncés beaucoup plus loin
à partir du lieu où ils étaient nés. Démocrite
a passé de longues années d'études entre la Caldée
et le Panchir. »
« Songe au Tetrapharmacum, les quatre principes d'Épicure : Rien à craindre des dieux. Rien à craindre de la mort. On peut supporter la douleur. On peut atteindre la félicité. Ne te semblent-ils pas plus en résonance avec les Nobles Vérités du Bouddha Gautama qu'avec la tradition présocratique ? Quatre principes, ce n'est d'ailleurs pas un nombre très occidental. En Europe, tous les grands principes vont par trois. On n'y aime pas quatre, contrairement à la Chine. »
« À propos de Chine, tous les Européens sont convaincus que cynisme vient de chien, sans paraître s'étonner que le nom soit curieux pour une école de philosophie. Personne ne suppose qu'il pourrait venir de Qin, l'Empire Qin : l'Empire Chinois de l'époque, qui a donné définitivement le nom occidental de la Chine. »
« L'homophonie avec chien a été exploitée par ses détracteurs, même si les philosophes cyniques n'ont pas hésité à la reprendre à leur compte. Les Cathares d'ailleurs n'appelaient-ils pas les dominicains Domini Canes, les chiens de Dieu, sans que personne ne mette en doute que le nom venait de Dominique, le fondateur de l'ordre. »
« Je suppose, lui demandé-je, que tu vas me dire que
toute la civilisation vient de la Chine. — Pas du tout.
Elle vient de la steppe. Il n'y a pas qu'à Iéna où
l'esprit allait à cheval. L'esprit de la Chine soufflait de la
steppe. — Je suppose que pour Manzi l'esprit souffle des montages,
et pour moi, il doit être un vent du large. »
Tchandji rit : « Tu m'as parfaitement compris, l'esprit souffle d'où l'on vient. »
Peut-être est-ce parce que je tiens le volant, l'idée de territoire ne cesse de me traverser l'esprit pendant la conversation, sans que je perçoive entre les deux un quelconque rapport, ni n'en cherche.
J'ai entendu dire que les Aborigènes d'Australie avaient des chemins qui correspondaient à des récits, ou peut-être à des sagesses, je n'en sais plus rien. En tout cas, ils étaient comme une forme d'écriture : une écriture avec des pas, dans un territoire.
Le concept de territoire est peut-être moins simple qu'il n'y paraît. Une surface non plane : voilà une idée sans aspérité, mais que la seule géométrie fractale peut venir sérieusement compliquer. Une telle surface est définitivement incommensurable. De toute façon, elle reste une abstraction tant qu'on ne considère pas ce qu'elle contient, ou qu'elle supporte.
Et d'abord, comment distinguer l'un de l'autre ? Le caillou, par exemple, est-il sur le territoire, ou en fait-il partie ? Et qu'en est-il de ce qui vit sur le territoire, de l'homme, et de tout ce qu'il y construit, son architecture, son agriculture, sa culture ?
Jusqu'à quel point alors ne peut-on pas penser que le travail humain produit lui-même son territoire. C'est le fondement même du droit romain dont s'inspirent directement les institutions modernes. Je ne crois pas qu'aucune autre civilisation ait eu une telle conception du territoire, ni en ait moins encore tiré sa tradition juridique.
Celui-ci n'est pas supposé exister avant la colonisation par l'homme. Et même si des hommes l'habitent déjà, ils ne sont pas sensés exister non plus s'ils ne ressortissent pas des mêmes institutions.
Le territoire n'existe que s'il est colonisé, exploité, aménagé, et dûment partagé entre les membres de la communauté. Et cette communauté elle-même n'existe que dans la mesure où ses membres sont agrégés à partir de l'unité de ce territoire.
Le territoire des États Unis n'est en effet plus tout à
fait le même que les territoires de chasse des peaux-rouges. Oui,
et non. Si un vieil indien revenait d'entre les morts et ne reconnaissait
plus sa terre, ce ne serait pas tant parce qu'elle en serait une autre,
mais parce qu'elle ne se laisserait plus saisir par les mêmes points
de vue. Comme dit le haïku : « La lune est identique
à la fenêtre, mais un rameau d'amandier change tout. »
J'ai souvent remarqué combien des régions assez semblables par la géologie, le climat et la végétation, étaient rendues très différentes par l'urbanisme. Je pourrais même utiliser le néologisme de géo-urbanisme, ou le terme de psycho-géographie, car il ne s'agit pas seulement de l'architecture des villes, mais de leur situation dans le territoire.
Les régions de Provence et de la Chine du sud ont beaucoup de points communs, mais leurs habitants ont de tout autres façons d'en occuper l'espace. Les Chinois aiment les lieux encaissés et humides, qu'ils trouvent apaisants, alors que les Provencaux vont arguer les serpents, les moustiques, les rhumatismes ou Dieu sait quoi pour ne pas dire qu'ils les rendent inquiets.
Où les premiers construisent une pagode, les seconds feront une décharge. À l'inverse, les sites sauvages qui servent de décors dans les gravures chinoises, sont souvent, en Provence, occupés par une agglomération. Non contents de faire les lieux différents, les images, justement, dressent les regards à les voir plus différents encore.
De l'étrangeté du réel
Pour autant, on ne peut nier la persistante réalité d'une entité géologique, au point d'y soupçonner l'ultime réalité.
Une certaine conception du territoire invite à croire aux dieux, aux fantômes, à l'immortalité de l'âme, aux trolls, à la croissance économique ou aux races. Étrangement, ces mirages donnent à la persistante réalité du sol, sur laquelle on peut pourtant toujours poser fermement ses pieds, et dont on tire sa subsistance et ses connaissances, des airs de surréalité. Elle devient proprement le territoire du merveilleux et de l'incroyable.
Quand on trouva des pierres tombées du ciel, les esprits les plus érudits et les plus rationnels prétendirent que cétait impossible et incroyable. Quant on trouva des formes de vie disparues pétrifiées dans le sol, ils dirent la même chose. On crut au serpent de mer et au vaisseau fantôme, mais quand Pithéas décrivit les cétacés des mers du nord, on s'en moqua si longtemps que les Marseillais gardent encore une réputation de menteurs.
Nous conversons donc tranquillement en roulant dans l'incroyable.
Comme annoncé, le paysage est devenu plus vert et plus humide,
mais la végétation est rase, composée de mousse et
de toundra. Nous sommes pourtant cernés de régions séches
ou arrides, mais la réalité ne cherche pas à convaincre.
Elle s'impose et nous laisse le soin de l'expliquer. Si nous y tenons,
nous finissons toujours par y arriver.
En bavardant, j'en apprends davantage sur Tchandji. Il est membre du Parti Communiste Marxiste-Léniniste du Marmat, qui n'est pas un groupuscule dans les régions du nord. On doit notamment à ses élus la politique énergétique des petits barrages, dont le but n'est pas seulement l'autonomie locale de l'énergie avec de très faibles déperditions, et la prévention des crues. Il est aussi la diffusion et la maîtrise des techniques de l'électricité au sein du peuple.
Il a passé plusieurs années en Chine, où il a étudié à l'université de Shangaï, et élevé des chevaux dans le Xinjiang. Il a ensuite enseigné quelques temps le chinois à l'université de Bisdurbal, puis est retourné vivre dans la steppe.
Pour autant, ni Tchandji, ni le PCMLM en général, ne sont particulièrement proches du Parti Communiste Chinois. Ils le sont davantage du Parti Communiste Népalais, le United Marxist Leninist, dont ils soutiennent fermement la guerrilla. Ils le sont aussi du Parti Communiste Indien.
La situation himalayenne
Je ne savais même pas qu'il y avait une guerrilla au Népal, dont je n'avais plus entendu parler depuis l'assassinat de la famille royale au printemps 2001 par le Prince héritier Dipendra, officiellement sous un coup de folie. La proximité de cet événement avec celui du 11 septembre me l'avait fait complètement oublier, alors qu'elle aurait dû au contraire, je l'avoue, susciter mon attention.
Il semblerait que le Pentagone arme depuis une théocratie militaire qui a ôté tout pouvoir au parlement depuis novembre 2001, et le cantonne dans le rôle de négociateur entre l'armée et les territoires libérés.
Toute la zone himalayenne, du Cachemire au Népal est donc extrêmement instable, mais, d'après Tchandji, plus loin que jamais de l'embrasement. Pour lui, seul le gouvernement US le souhaite, donnant ainsi aux Chinois et aux Indiens la meilleure occasion qu'ils aient jamais eue de s'entendre.
« Si les communistes constituent la force organisatrice de la résistance, celle-ci regroupe aussi des composantes hindouistes et bouddhistes. Elle ne permet donc pas non plus d'exploiter facilement les dissensions indiennes. D'autant plus que l'armée US est déjà dans une situation qui ne lui permet pas de se lancer dans une fuite en avant sans y réfléchir à deux fois. »
« Je te trouve bien optimiste, dit Manzi. — Je te trouve bien pessimiste, renvoie Tchandji. Le peuple n'a pas besoin de la lutte armée pour prendre le pouvoir, c'est l'impérialisme qui en a besoin pour le conserver. — Justement. »
Les moines guerriers du monastère Di-o Tche
Les agglomérations sont rares. La région n'est pas peuplée. Peu avant d'arriver au grand lac, nous devons passer à proximité le monastère Di-o Tche.
De loin, le monastère ressemble à une base aérienne. C'est ce qu'il est en réalité. Non, il n'a pas été réquisitionné par l'armée, ce sont les moines qui sont devenus militaires.
Depuis toujours, le monastère abrite des moines guerriers. Au début, on y maniait l'arc et le sabre, et les moines servaient d'instructeurs pour les laïcs. Tout jeune homme passait au moins une retraite de trois ans où il apprenait les Soutras de Gautama, le maniement des armes et les manœuvres de combat.
Le monastère abrite aujourd'hui quelques rampes de missiles, une escadrille de chasse, un régiment de parachutistes et une division blindée. De la route, on ne voit que l'aérodrome, mais il occupe une surface bien plus importante, et une grande part de ses effectifs est constituée des jeunes réservistes de la région, venus s'initier à la quête de la sérénité et à l'art de la guerre.
Les jeunes ont le choix entre le service militaire laïque et ce type de retraite. La plupart optent pour le monastère, bien que la vie y soit plus rude, la discipline plus stricte et l'entraînement plus dangereux.
La formation y est comparable à toute autre école militaire. On y apprend les armes, mais on apprend en même temps à les mépriser. Pour les moines, la supériorité en matériels et en effectifs est une illusion (illusion qu'on doit d'ailleurs apprendre à utiliser contre l'adversaire). Le guerrier vainqueur est celui qui impose la façon de se battre à son adversaire.
Une part importante de l'enseignement concerne la compassion envers l'ennemi. Si le guerrier l'ignore avant le combat, il pourrait être dangereux qu'il la rencontre pendant ou après. Il importe, dans la lutte, de ne pas être perturbé par des passions contradictoires : la haine qui fait perdre de vue les objectifs stratégiques, ou la pitié qui peut retenir le geste.
Les moines de Di-o Tche écrivent aussi des quantités de logiciels de stratégie. J'ai appris tout cela en me connectant sur leur site, et j'ai essayé un petit programme en ligne que j'ai d'ailleurs téléchargé.
Il ne marchera pas sur mon Powerbook, mais on pourra toujours l'utiliser sur les machines de mes amis, et peut-être, pourquoi pas, tenter de le porter sur Mac OS.
Le programme des moines de Di-o Tche
Je ne saurais dire le nom de ce jeu, puisqu'il n'est pas porté en anglais. Les règles en sont cependant si évidentes qu'il n'est besoin d'aucun mode d'emploi.
Au lancement, il ouvre un écran gris sombre sur lequel est tracé un ovale plus clair, et au centre duquel sont deux boules noires. De part et d'autre de l'ovale, dansent deux petites flammes claires.
À l'observation, le grand ovale central se révèle un cercle en perspective. Un clic de souris démarre le jeu. Il consiste à expulser la boule adverse du cercle. C'est un jeu de Sumo extrêmement minimaliste. On déplace les boules à la souris.
L'ambiance sonore tient une place importante. Le bruit des chocs donne très vite une impression de substance — substance métallique, bois, pierre, osier, gomme... En effet, les adversaires changent au fil du jeu, et l'on peut soi-même modifier les propriétés de sa boule, bien que l'aspect en reste toujours celui d'une sphère noire.
Les substances les plus massives ne sont pas nécessairement les
plus difficiles à expulser du cercle. Tantôt celle que vous
affrontez est légère et produit un son creux. Le moindre
choc la projette en arrière. Tantôt elle est lourde et vous
fait rebondir avec un bruit sourd. Tantôt elle est vive et furtive,
tantôt lente et massive. Tantôt elle est souple et élastique
comme de la gomme, tantôt dure comme du marbre.
Les deux flammes qui dansent des deux côtés de la piste varient d'intensité au cours du combat, selon l'énergie des adversaires ou leur degré de fatigue. Je ne suis toujours pas parvenu à comprendre quels algorithmes pouvaient mesurer ceux du joueur, mais j'ai bien remarqué qu'elle faiblissait lorsque je perdais le contrôle du jeu ou me déconcentrais, et devenait plus vive quand je reprenais le dessus.
Il se passe alors au cours de la partie quelque chose d'étrange. Votre main qui guide la souris disparaît, et aussi l'image sur l'écran. Vous devenez la boule, vous ne percevez plus que les chocs mécaniques, sonores et tactiles, et vous avez une sensation physique de l'espace de la piste.
Tout effet de texture et de relief serait bien inutile, et surtout moins efficace que cette piste grise et ces boules noires que l'on apprend à reconnaître. À proprement parler, nous n'avons plus de représentation : nous sommes. C'est une expérience fortement troublante.
|