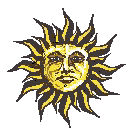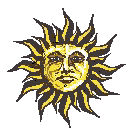Cahier XIII
Vers Algarod
Le 22 juin
En route
« Je n'écris pas pour une petite élite dont je n'ai cure, ni pour une entité platonique adulée qu'on surnomme la Masse. Je ne crois pas à ces deux abstractions, chères au démagogue. J'écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps. »
Fait exceptionnel, j'ai trouvé un livre en français, Le Livre de Sable de Jorge Luis Borgues, dans la station-service à la sortie de Bolgobol. Je ne l'avais jamais lu. Je n'en connais maintenant que ces quelques lignes sur la quatrième de couverture, que Manzi tente d'interpréter. Il a déjà fait de réels progrès dans notre langue.
Nous roulons vers le nord. Nous avons décidé de monter avec deux voitures, ce qui double nos frais mais accroîtra notre autonomie sur place. Nous nous relaierons par deux au volant.
Je conduis la voiture de Ziddhâ, qui est montée avec Douha.
Elle n'est toujours pas convaincue par mon réglage du carburateur
et de l'embrayage, mais Manzi apprécie beaucoup les reprises sur
les routes de montagne. Nous nous sommes donc momentanément appropriés
son véhicule, et je réglerai l'embrayage à mon départ
pour qu'il soit plus souple — je n'ose pas dire plus mou.
Ces lignes semblent te plaire, me demande Manzi.
J'avoue écrire moi aussi pour moi-même et pour le plaisir de mes amis, mais je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent de distinguer une élite de la masse dans le cas contraire. Pourquoi n'emploie-t-il pas le terme plus général de public ou de clientèle ? Que cette clientèle soit une élite ou une masse ne change à vrai dire pas grand chose. Je me demande aussi s'il y a beaucoup de sens à préciser qu'on n'écrit pas pour un public. C'est comme annoncer qu'on ne parlerait pas à la cantonade. En somme, Borges emploie beaucoup de mots pour dire tout simplement qu'il écrit.
À propos, qui sont les poètes invités à ces rencontres ? Tous les poètes du monde qui veulent venir, me répond Manzi. Et quel sera le public ?
Manzi tourne vers moi un regard amusé : « Je te trouve parfois très inconséquent. »
Nous approchons d'Algarod
Pour rejoindre la République du Gourpa, dont le lac d'Agghadar dessine une bonne part de la frontière, nous devons d'abord monter vers le nord et atteindre la ville d'Algarod, à deux mille cinq cents mètres d'altitude. La végétation est devenue moins dense : des bosquets de sapins au milieu de prairies à l'herbe très rase, du type toundra, des éboulis, et une merveilleuse odeur que je ne saurais définir, mêlant résine et pierre humide.
Nous contournons par l'est le massif du mont Iblis. En trois heures, le radiateur de la voiture a déjà consommé une bonne dizaine de litres d'eau, qui, heureusement, ne manque pas le long de la route. Où que nous tournions nos regards, l'horizon est barré d'immenses massifs rocheux qui me donnent le vertige à seulement les contempler.
Les fréquents arrêts pour remplir le radiateur et laisser refroidir le moteur nous retardent, et je ne garde plus beaucoup d'espoir de déjeuner à Algarod. Nous approchons de midi, et j'estime la chaleur à quarante degrés. Manzi m'apprend pourtant que la route est verglacée à l'aube en cette saison.
Nous atteignons le Col du Gargon vers midi et quart. Il nous reste encore vingt-cinq kilomètres à parcourir, ce qui, même à la descente, nous prendra certainement plus d'une demi-heure.
Le Col du Gargon
Nous faisons une pause pour remplir nos jerricanes, laisser reposer les
moteurs et sécher notre sueur. Un vent d'est très sec souffle
ici, dont nous ne sentions rien dans la côte.
Le lieu paraît désert, malgré quatre grandes bâtisses
dont une seule n'est pas en ruine : un rez-de-chaussée de
murs épais, sans fenêtres, deux étages en bois, et
un toit d'ardoise dont la surface est bien plus large que la base de la
construction, et dont les extrémités sont légèrement
recourbées vers le haut à la manière extrême-orientale.
Elle a des volets de bois fermés, de grandes portes au rez-de-chaussée,
fermées aussi, taillées pour donner le passage à
des camions. Des traces de pneus ont d'ailleurs séché dans
la terre. Sa sobriété a quelque chose de militaire.
Une autre bâtisse n'a plus de toit. Des deux autres, il ne reste que le rez-de-chaussée de pierres massives. Celle qui est intacte est presque au niveau de la route, les autres, plus haut, sur un début de pente où des herbes rares poussent parmi des cailloutis. Elles surplombent la très grande esplanade de terre battue où nous nous sommes garés près d'une fontaine et d'un bassin de pierre.
Nous nous dégourdissons un peu les jambes. L'eau s'écoule par la bouche d'un darlabat rigolard grossièrement taillé dans la pierre de la fontaine.
Mon attention est attirée par des plantes grasses, assez minuscules. Les tiges, faites de petits manchons enchâssés qui tirent sur le jaune, le rouge et le bleu, ne montent pas au-delà de dix ou quinze centimètres, où elles s'épanouissent en d'étranges fleurs en forme d'étoiles de mer. Elles poussent entre des jointures de pierres, presque sans terre.
« Le temps de rejoindre Algarod, dit Douha, d'entrer en ville, de trouver un restaurant et d'être servi, cela nous mènera au moins jusqu'à une heure et demie, si ce n'est deux heures. » Manzi propose de s'arrêter pour déjeuner aux sources chaudes. Les femmes trouvent l'idée bonne. Nous entamerons nos provisions, et les renouvellerons en ville.
Les sources chaudes
La route descend en lacets jusqu'à une vallée pierreuse, avec quelques bosquets de sapins seulement, à droite sur l'adret, au pied des parois rocheuses. Après quelques kilomètres, notre petit convoi ralentit pour emprunter un chemin de terre vers une construction de pierre qu'une brume estompe de la route.
L'architecture en est occidentale, elle m'évoque même le
pur classicisme français. La forme en est approximativement celle
d'un petit temple grec, mais sans colonne, ni décoration d'aucune
sorte, un œil-de-bœuf ovale seulement surmonte l'unique porte.
La pierre est du mauvais calcaire, légèrement poreux, que
le temps et l'humidité ont déjà dégradé.
La brume qui baigne le lieu vient de plusieurs sources qui coulent dans de petits canaux en amont de la construction. L'une alimente un bassin de forme irrégulière devant l'entrée, l'autre plus bas, un lac dans une dénivellation de la roche. Il n'y a pas de végétation, même pas de terre, seulement du calcaire rose.
Les sources ne sont pas très chaudes. L'eau doit peut-être sortir de terre aux environs de vingt-cinq degrés. Elles rafraîchissent et humidifient plutôt l'atmosphère, surtout dans la construction qui se révèle abriter un bassin.
— Ce lieu était sacré dans l'antiquité, me dit Ziddhâ. Il était dédié à Parvati, la compagne d'Indra, qui fut, plus tard, assimilée à Arthémis.
— La construction ne me paraît pourtant pas très ancienne, remarqué-je.
— Non, elle ne date que de la fin du dix-septième siècle.
Le temple était plus bas, près du lac. Il fut détruit
par des croyants. Il n'avait alors plus aucune signification pour les
Bouddhistes. Il ne servait qu'à délasser les voyageurs.
Les oulémas condamnèrent cette dégradation. Cela
donna lieu à une fatwa de l'imam Basry qui fit jurisprudence. Elle
disait que ce n'est pas l'idole qui fait l'idolâtrie, mais l'idolâtre,
et qu'il suffit au fidèle de consumer l'image au feu de l'intelligence
et de l'interprétation.
— Belle formule, commenté-je.
Al câlam al Mithâl
Après le voyage que nous venons de faire, comment se retrouver devant un bassin sans s'y baigner ? Pendant que nous nous déshabillons, Ziddhâ s'est déjà jetée dans le plus proche. « C'est un des fondements de l'Ismaélisme Réformé, ajoute Manzi en arabe. Le monde créaturel (al câlam al khalk) doit être dissout dans celui de la présentation immédiate (al câlam al mithâl). »
« C'est bien idéaliste » dis-je en français, tandis que nous nous dirigeons vers le plus grand bassin en contrebas.
« Non, répond-il en anglais. Quand je te parle, tu n'entends pas proprement les objets sonores, mais tu perçois immédiatement leur signification. Moi-même, je ne suis attentif qu'à ma parole et non pas aux mouvements de mes organes qui produisent les sons. Quand tu reçois un courriel de moi, tu n'es pas plus préoccupé des impulsions que démodule ton modem. Tu ne te soucies même pas du charset, tu en confies la conversion à un programme. »
« Encore faut-il avoir appris à parler, tiré des lignes téléphoniques, construit des modems et écrit des programmes. » Dis-je en brassant.
Les poissons des sources chaudes
« Qui dit le contraire ? Poursuit-il. Encore doit-on
d'abord avoir produit des langages pour faire tout cela. La structure
du langage n'est pas à proprement parler celle du dispositif matériel,
elle en diffère comme la presentational immediacy de la
causal efficiency, pour reprendre la terminologie de Whitehead
que tu connais bien. »
Je sens soudain comme une très légère piqûre
à la jambe. En me retournant, je vois un minuscule poisson, de
la taille d'un doigt, qui revient à la charge. Il est tout en longueur,
d'une teinte saumonée piquée de pigments plus rouges dans
ses zébrures. Je sens une nouvelle piqûre à l'épaule,
et je vois qu'il y en a plusieurs. « Eh ! Il y a des poissons
carnivores ici, lancé-je. »
« Aucun danger, répond Douha, qui nage un peu plus loin. Ils se contentent de nos peaux mortes. Tu n'as qu'à ne pas t'en occuper. Il paraît qu'ils guérissent les maladies de peau. Les gens, avant, venaient faire des cures. »
Mais comment peuvent-ils vivre ici ? D'où viennent-ils ?
Al câlam al mithâl et presentational immediacy
Tandis que je reviens vers Manzi, il se cale contre des pierres en s'asseyant dans l'eau, et poursuit son propos : « Le monde créaturel (al câlam al khalk) est l'empreinte du monde de l'intuition (al câlam al mithâl), comme l'encre sur le papier est l'empreinte de ton texte. Naturellement, il doit s'imprimer pour exister. Il ne peut faire l'économie de son existence créaturelle, mais il n'existe aussi qu'en s'en émancipant, c'est à dire en faisant de cette existence un travail, l'œuvre qu'il accomplit. »
« Si l'existence de la création cesse de dépendre de son créateur, si l'existence du créateur se met au contraire à dépendre de l'œuvre, il ne tardera pas à disparaître avec elle. Est-ce si idéaliste ? »
« Je ne sais pas ce que penseraient les islamologues de ta traduction de al câlam al mithâl par presentational immediacy, dis-je en m'asseyant près de lui. Henri Corbin propose le Monde Imaginal, et Michel Chodkiewicz traduit mithl par likeness. »
« Oublie les islamologues et parlons de grammaire, me répond-il. Câlam, monde, a la même racine que science, câlim, qui renvoie à camal, travail, œuvre, qui est de la même famille que calâma, signe, symbole, voire caractère pour l'écriture. Tout ce qui peut se dire en une langue peut aussi se dire en une autre, mais les penseurs ismaéliens ont choisi l'arabe et le farsi, et nous devons bien tenir compte des jeux (sets) de langage qu'ils ont mis en œuvre et qui sont spécifiques à ces langues. »
Je commence à le connaître maintenant assez pour deviner où il veut en venir. Je choisis donc de l'interrompre. « La question est plutôt de savoir jusqu'à quel point un signe a besoin d'un référent, et s'il n'a pas besoin d'abord d'un support, disons d'une forme matérielle. C'est ce qui m'a d'ailleurs causé beaucoup de scrupules pour accepter le choix de Dominique Janicaud et de Maurice Élie de traduire presentational immediacy par présentation immédiate, et non par immédiateté de représentation. On n'emploie pas le mot présentation dans cette acception-là en français. On dit représentation. Pourtant ce préfixe "re" est très gênant chez Whitehead, en ce qu'il suppose une relation qui n'est plus du tout immédiate. Il aurait mieux valu alors un autre mot, comme figuration ou intuition. L'idée, c'est qu'il n'y a pas une chose qui serait mise pour une autre, comme un signifiant pour un signifié, par exemple. »
Tout en poursuivant notre conversation, nous sommes revenus vers la voiture pour chercher de quoi manger. Nous nous sommes installés dans le petit temple, et les femmes se sont remises à suivre nos propos. Cependant la discussion est devenue trop savante au fur et à mesure que s'estompait la remarque qui l'avait suscitée et, le repas aidant, elle est retombée presque immédiatement.
Algarod
La température baisse nettement depuis le Col du Gargon. Entre les descentes et les côtes, nous n'avons pas dû perdre plus de trois cents mètres. Le paysage est plus pelé qu'au sud, dans la région de Bolgobol, et les massifs rocheux plus imposants, mais on voit encore de belles forêts de sapins et de mélèzes sur le flanc des vallées.
On aperçoit depuis le fond de la vallée d'Ar Roula les murailles d'Algarod, étendue sur le flanc sud d'un massif surmonté de trois pitons rocheux, chacun coiffé d'un fort.
La situation de la vieille ville concilie parfaitement la recherche de l'ensoleillement et l'intérêt stratégique. Ce massif ferme la vallée, contrôlant le passage vers le Col du Gargon. Il tombe presque à pic, au nord, sur l'Af Fawourâh qui coule quelques centaines de mètres plus bas. Une nouvelle ville industrielle s'est construite là, autour de ses rives.
Les Asghods ne sont jamais parvenus à prendre ses remparts pendant la Guerre de Quarante ans, et durent contourner la ville pour envahir les régions du sud. Ils n'arrivèrent pas davantage à l'isoler durablement de son arrière-pays, ni à circuler en toute sécurité dans les vallées avoisinantes. Plusieurs fois dans l'Histoire, face aux Scythes, aux Parthes, aux Huns blancs de l'Altaï, aux Mongols, aux Tatares, Algarod fut la clé de l'indépendance du Marmat.
La ville ne connut pas davantage les bouleversements de la Réforme. Fait exceptionnel, l'Islam y pénétra immédiatement sous la forme de l'Ismaélisme Réformé.
La Place des Darlabats
Les gens d'ici éprouvent un impérieux besoin de se retrouver seuls ; pas entre amis, pas en famille, pas en couple, mais seuls. Même les forteresses n'ont jamais eu de cantonnements en chambrées. Les militaires y disposaient de cellules, comme dans des monastères.
Cette coutume ne me déplaît vraiment pas, et après la route que nous venons de faire depuis ce matin, je trouve excellente l'idée de nous séparer. Nous nous retrouverons d'ici une heure à une heure et demis Place des Darlabats.
Comme je ne connais pas la ville et que je ne parle pas la langue, on m'y dépose le premier en y garant la voiture de Ziddhâ. Puis ils partent tous les trois dans l'autre. Douha s'occupera de renouveler les provisions de route, Manzi ira chercher je ne sais quel appareil électrique oublié, et Ziddhâ n'éprouve même pas le besoin de se trouver un prétexte.
Façades de pierres sombres, toits d'ardoise grise, volets de bois plein teintés au brou de noix, peu de décoration, la ville a quelque chose d'austère que contraste l'abondance de végétation : jardins, arbres, fleurs aux fenêtres. Elle doit cependant paraître assez triste en hiver.
La Place des Darlabats doit son nom à sa grande fontaine. On y voit des faunes de pierre dans un décor étonnamment baroque. On se croirait en Italie, et non plus en Asie Centrale.
Le rideau d'une cascade couvre les ouvertures d'une grotte qui parcourt toute la largeur du bassin. On peut y pénétrer par les deux extrémités. Au milieu du plan d'eau, assis sur un rocher, un faune apprend à jouer du sytrenx à un adolescent efféminé, qui pourrait ressembler au jeune Dionysos, s'il n'était paré de bijoux et n'avait la tête cernée d'une auréole, évoquant plutôt un bodhisattva.
Je décide de m'installer au grand café qui fait face à la fontaine pour tenir mon journal. Les tables de bois offrent toute la place souhaitable pour un powerbook, une blague à tabac, le lourd cendrier de métal qui m'attend déjà, et le café et le verre d'eau que j'envisage de commander.
Je regarde d'abord les tourniquets de cartes-postales. Beaucoup sont des vues des remparts et des citadelles que je visiterais volontiers si j'en avais le temps. D'autres montrent les sources chaudes. L'une représente le grand bassin ; une autre, la roche poreuse baignée de vapeur.
Quelques livres sont rangés dans des présentoirs ou des boîtes de carton. La plupart sont en palanzi, et je n'en vois aucun dans une langue européenne. J'en feuillette un en arabe, et quelques lignes d'un dialogue qui oppose la raison aux sens, retiennent mon attention :
— La couleur n'existe que par convention ; de même le doux, de même l'amer.
— Pauvre raison, qui prend chez nous tes arguments et t'en sers pour nous calomnier. Ta victoire est ton échec.
Ceci me rappelle quelque chose. Je regarde la couverture : Risalat (Lettres, Épîtres) en gros caractères koufiques surmontent deux noms écrits sans leurs voyelles : Ad Dmkrt wa Af Frtgrs.
J'identifie dans le second la translittération de Protagoras. Le premier serait-il celle de Démocrite ?
|