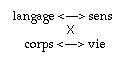Sixième Cahier
Sensation et cognition. - Comment se servir d'un corps ? - Automatisme et connotation. - Le tombeau d'Edgar Poe. - En quoi le sens serait-il une forme de vie ? - Dénotation, connotation, morphologie et syntaxe.
---------------------------------------------------
Le 5 octobre
J'ai découvert - car l'on découvre autant chez soi que n'importe où - que j'avais tendance à associer aux nombres des dates.
Mettons que je tienne à me souvenir de la page d'un livre : disons la page 128. L'an 128 ne me disant rien, je vais donc carrément lui ajouter 1800. Je penserai donc à l'année 1928.
L'an 1928 a immédiatement pour moi une valeur moins abstraite que la page 128. Il a une signification pour l'histoire universelle aussi bien que pour ma propre histoire : vingt-cinq ans avant ma naissance, vingt et un après celle de mes parents, un an avant la grande crise, point charnière entre les deux guerres mondiales.
Le principal intérêt de ces sortes de translation est qu'elles ne se contentent pas d'associer un (des) point(s) à un (des) autre(s), mais un flux à un flux. Elles renvoient un jeu d'inter-relations à un autre : celui du texte et celui du temps de l'histoire, qui se déroulent tous deux d'une manière plutôt identique.
Le temps du texte, pris à la fois comme durée (écoulement) et comme tempo, est associé à celui de l'histoire.
Ce genre d'association, que j'ai fini par faire automatiquement, me permet de retrouver facilement tout ce que j'ai lu au fil d'un livre, et ne me demande qu'un travail de mémoire somme toute minime, puisqu'il se fait pour ainsi dire seul.
On pourra, évidemment, se dire que cette méthode nécessite une bonne connaissance de l'histoire ; surtout pour des ouvrages composés de plusieurs centaines de pages et qui feront partir la datation de 1700, 1600, ou plus loin encore. Elle ne demande en fait que les connaissances que tout le monde a, mais elle a par contre ce grand avantage de les charpenter substantiellement. L'effet jouant dans les deux sens, chaque lecture est aussi une manière d'expérimenter l'ordre et la durée historique à travers le temps de lecture.
*
A priori, une date, 1928 par exemple, considérée pour elle même, n'offre pas plus de prise à notre esprit qu'un numéro de page, 128 en l'occurrence, ou que n'importe quel chiffre considéré pour lui-même.
Pourtant tout chiffre est déjà une relation numérique, et 128 est un classement en centaine, dizaines et unités. 128 est aussi 27. Un mathématicien s'en serait sans doute tout de suite aperçu. Moi, je ne m'en aperçois que maintenant, après un rapide calcul. J'avais pourtant choisi ce chiffre tout à fait par hasard.
En attendant, reconnaître 27 dans 128, ne me dit rien de la page que je lis. Ce n'est que le hasard de la mise en page qui associe le fragment de texte à ce chiffre. De même, le seul arbitraire de la datation chrétienne associe 1928 à des événements historiques.
Je montre là que la relation numérique que j'établis (entre une date et un numéro de page) va au-delà de la seule relation numérique et de son arbitraire. J'associe en fait, à travers le nombre (et son arbitraire), le déroulement d'un discours à celui d'événements, et cette relation, elle, n'est ni hasardeuse ni arbitraire, une fois qu'elle est établie.
*
Les pages passent comme les ans. C'est la même relation que celle qui est établie entre les jours et les feuillets détachables d'un calendrier, ou encore avec les pages d'un agenda. (Si ce n'est que, dans ces derniers cas, il n'y a plus de comme. A moins qu'il n'y en ait peut-être encore un ?)
D'ailleurs, aux jours, aux mois, aux semaines, aux ans, sont traditionnellement attachés des éléments qualitatifs, qui les personnalisent, comme les saints du calendrier (ou peut-être encore les blagues, les proverbes, les paroles saintes qui vont généralement être associées aux feuillets détachables des calendriers).
*
Lorsqu'enfant on apprend l'histoire, on regrette que toutes les dates ne soient pas aussi faciles à retenir que celle de la bataille de Marignan. Toutes ces dates n'ont encore, pour l'enfant, aucune signification. Elles ne sont que des chiffres aussi arbitraires qu'ils sont fastidieux à retenir. Ils ne signifient rien ; ils ne signifient pas ce qu'ils devraient signifier : des durées, des durées vécues, faites de naissances et de générations qui vieillissent, faites de luttes, d'attentes, de plaisirs, d'espoirs et d'épreuves spécifiques, de modes qui passent, de conceptions du monde qui changent d'elles-mêmes sans que nul ne perçoive comment...
Le sentiment de la durée, la conscience de la durée, le sens de la durée - on ne saurait bien dire - est un objet très complexe - ou peut-être trop simple, parce que, d'une autre part, trop immédiat.
Le sens de la durée est surtout complexe parce qu'il est associatif : il combine le continu et le discontinu. Sans discontinu, la durée se défait, se spatialise en étendue. Mais ce discontinu lui-même est fait de régularités (rythmes) et d'irrégularités (mélodies ?) ; il est nécessairement les deux, comme la musique.
Sans doute la théorie de la relativité ne saurait demeurer étrangère à l'expérience humaine de la durée ; et cela serait peut-être véritablement comprendre ce qu'elle veut dire - comprendre la signification exacte des termes dont nous maîtrisons si bien la syntaxe et la grammaire.
*
Le 6 octobre
Le sens de la durée ne s'identifie pas à la durée. La durée, sans le sens de la durée, est parfaitement réductible à une dimension de l'espace. Mais le sens de l'espace est lui-même inséparable du sens de la durée.
Je cherche en fait, ici, du côté d'une solution de continuité entre perception et cognition.
Je suis conscient que tout ce que j'entreprends de dire ici depuis bientôt trois mois est tâtonnant, maladroit et sans doute naïf, quoique non dépourvu malgré tout d'une virtuosité certaine. Une agilité, devrais-je plutôt dire, qui fait pendant à cette naïveté ; cette verdeur.
*
Nos conceptions courantes séparent beaucoup trop la perception et la cognition. Il faut dire que cette séparation est toute dépendante de la façon dont la perception et la cognition ont été étudiées. Il s'agit plus d'une division de méthode que d'une division d'objet.
Le cognitif a d'abord été pensé et étudié à travers la philosophie première, alors que la perception l'a été à travers l'anatomie.
Bien sûr on a très tôt, sans doute toujours, tenté de recouper les deux.
Le 7 octobre
Les concepts de perception et de cognition se distinguent très bien, et nous ne saurions les confondre, mais on observe qu'ils se recoupent partiellement, et qu'on ne saurait décrire exactement où s'arrête la perception et où commence la cognition.

Ce genre de petits dessins sont généralement utilisés pour mettre en évidence l'imprécision de la frontière.
On essaye alors d'aborder la cognition par la voie de la perception, ou la perception par la voie de la cognition.
Or il n'y a pas entre les deux une simple différence d'objet, mais une différence de méthode. C'est l'approche ici qui détermine son objet, et il se trouve que c'est plutôt l'approche de la perception qui sert de méthode pour investir le cognitif que l'inverse.
*
Les organes des sens et le système nerveux : voilà les organes de la perception. Et les organes de la cognition ? - Le cerveau ; les parties du cerveau.
On n'a pourtant jamais rien trouvé de très utile à la connaissance mathématique en étudiant la structure du cerveau ; ni davantage qui nous permettrait de mieux comprendre ce qu'est l'harmonie musicale. Tout au plus a-t-on cru discerner que telle part de cerveau semblait être le siège de telle activité cognitive plutôt que de telle autre. Admettons╔ Mais demeure que nous avons le plus grand mal à définir et expliquer cette activité cognitive dont nous croyons pourtant trouver le siège.
« Voyez, c'est là que ça se passe. - Oui, mais qu'est-ce qui se passe là ? - C'est bien ce que nous ne savons pas. »
* Le 8 octobre
L'irrigation du cerveau ; la respiration, le battement du coeur : de façon évidente, cela change la façon de penser.
Observons la respiration de celui qui se livre a un intense travail intellectuel. Il retient son souffle, aspire profondément╔ Nul doute que sa respiration participe à sa pensée. Est-ce en irriguant la cerveau ?
Ce jeu avec le rythme respiratoire a nécessairement des conséquences sur l'alimentation en oxygène du cerveau. Peut-être le cerveau le commande-t-il aux poumons par le plexus solaire.
On peut comparer le souffle qui accompagne cette activité purement intellectuelle avec celui de la parole. L'activité pulmonaire qui accompagne la parole est nettement plus déterminée par l'articulation des phrases que par l'irrigation du cerveau.
*
Que se passe-t-il si l'on respire mal en parlant ? - On perd son souffle. De celui qui respire mal en parlant et perd le souffle, on dit qu'il est intimidé, qu'il a le trac. On peut apprendre et s'entraîner à maîtriser son souffle pour vaincre le trac.
Dans tout cela, est-il question d'un processus physiologique ou psychologique ?
Si je m'essouffle trop en montant une côte en vélo, où trouvera-t-on un processus psychologique ? Pourtant, ne pas m'essouffler dans une côte n'est pas seulement une question qui concerne mes capacités physiques. Sont davantage en jeu, ma connaissance de la route, celle de mes forces. Je dois savoir jusqu'à quel point je dois forcer sur le pédalier, rétrograder, conserver mon élan, lever les fesses de la selle, m'appuyer sur le guidon. Chacun de ces mouvements effectués quelques secondes trop tôt ou trop tard pourra suffire à m'essouffler définitivement, à me « scier les jambes ».
Dans ce cas, l'émotion paraît n'intervenir d'aucune façon. Ce n'est pas le cas avec la parole. Quand la respiration qui accompagne la parole n'est pas juste, c'est généralement sous le coup d'une émotion. L'émotion paraît commander à la fois la respiration, et la plus ou moins bonne clarté d'esprit.
On peut distinguer alors une paire de processus psychologiques - pensée et émotion -, et une paire de processus physiologiques - l'un associé au système nerveux, l'autre au système circulatoire.
*
Il serait pourtant faux de croire que l'émotion n'ait qu'un effet funeste sur la clarté d'esprit. Ce serait comme croire que l'accélération cardiaque n'ait qu'un effet funeste sur le cycliste.
Il est peu probable qu'une parole de quelque force, pût être prononcée, qui ne fût sous le coup de quelque émotion.
Celui qui pense - pense en silence - que semble-t-il chercher, vers quelle sorte de point son attitude et sa respiration semblent-elles tendre ? Cela peut-être variable. Celui-ci semble chercher une quiétude et un silence intérieur, celui-là trouve une transe, cet autre la calme tension du chasseur, tel regard est errant, cherchant un point lointain où se fixer, un autre est rivé, fixe, sur un point immédiat, un troisième, paisible et clos, un autre encore, soucieux sous des sourcils plissés, un autre enfin, comme lisant sur les lèvres d'un visage invisible en face de lui ; le sien peut-être.
*
« Comment est-ce que je m'y prends pour pédaler plus vite ? - Comment est-ce que je m'y prends pour respirer plus profondément ? - Comment est-ce que je m'y prends pour déplacer mon regard de la feuille blanche jusqu'à la fenêtre ? - Comment est-ce que je m'y prends pour me poser ces questions ? - Comment est-ce que je m'y prends pour écrire cette phrase ? »
Quelle sorte de réponse pourraient appeler de telles questions ? Je le fais, c'est tout.
- Pour avoir un sens, elles devraient appeler des réponses techniques. Par exemple : « Pour pédaler plus vite, je devrais déplacer mon centre de gravité en avant ». Ou encore : « pour respirer plus profondément, je devrais remonter mon buste, redresser ma tête, abaisser mes épaules... ».
- Mais ce n'est bien évidemment pas le déplacement de mon centre de gravité qui me fera pédaler plus vite, ni le redressement de mon corps qui me fera respirer plus lentement.
- Tout au moins, le processus ne se fera pas mécaniquement : mécaniquement, comme le changement de vitesse fera sauter la chaîne d'un pignon.
- Quoique...: se pencher en avant ne ferait-il pas pédaler plus vite « mécaniquement » ?
- Soit, mais comme pédaler plus vite fera « mécaniquement » pencher en avant. Or, ce n'est pas la chaîne, en changeant de pignon, qui changera la vitesse. C'est là la différence entre le concept de « mécanique » et d'« automatique ». Bien que l'on emploie souvent le second pour le premier. Aussi n'est-ce pas « mécaniquement » que, me pencher en avant, me fait pédaler plus vite, mais « automatiquement ».
- Celui à qui l'on dirait : « pour mieux respirer, lève la tête », pourrait nous répondre : « et comment je fais pour lever la tête ? »... et ainsi de suite.
--------------------------------------------
Le 9 octobre
La perception est étudiée sous la forme d'un mécanisme. Cela, parce que les sciences - les sciences naturelles (y a-t-il des sciences artificielles ?) - ont pour vocation d'étudier des mécanismes. Ou encore : la mécanique est depuis l'origine le modèle même de la science : la reine des sciences (Archimède).
Qui dit mécanique, pense moteur. D'Aristote au garagiste du coin, tout le monde sera d'accord.
Il faut, à la plus complexe mécanique, un moteur pour l'animer (un automate). Cela fait problème : toute science mécanique tente de démonter les mécanismes du moteur.
Le travail de Newton est exemplaire en ce domaine, et non moins exemplaire la conscience de son échec. Peu d'esprits ont atteint la lucidité de Newton sur ce point. Son sublime système de gravitation tend à faire oublier l'impasse ; lui n'a jamais oublié que son approche laissait intact le mystère du moteur. Mieux, sans doute : qu'elle le produisait.
*
Le mythe de l'automate, depuis Aristote, ne cesse d'inférer avec la mécanique. Car l'automate, l'automatisme, ne cesse d'être d'abord un mythe.
La mécanique bute sur l'automate :
- Tantôt elle y voit un siège vide, comme un sauvage qui découvrirait une voiture, la démonterait, l'étudierait sous toutes ses coutures, chercherait à comprendre, comprendrait enfin, mais resterait perplexe devant le siège vide, et finirait par le voir comme un trône divin.
Le dieu des philosophes a toujours été un siège vide. La tentation était forte d'y faire s'asseoir le Dieu des Hébreux.
L'image est plutôt grotesque, blasphématoire. Je ne peux que comprendre ceux qui ont accusé Al Jîlî d'hérésie (quel que soit par ailleurs l'intérêt que je lui porte). Le premier agent d'Aristote n'est pas le Dieu des Prophètes.
L'un parle, est parole ; n'est peut-être que parole, mais nul ne peut douter que cette parole ait quelque force et ne produise ses effets. Les témoins ne manquent pas qui l'aient entendu, et même rencontré, et ces témoins ne cessent de bouleverser le cours du monde dans la mesure où leur vie l'a été.
L'autre n'est qu'absence, siège vide ; conjecture à partir d'un siège vide. Si jamais il est quelque chose d'émouvant, quelque chose de grand, dans ce siège vide, c'est bien son vide (1). C'est ce vide qui devrait bien plutôt nous émerveiller, et non l'idée grotesque d'un être qui pourrait l'occuper.
- Tantôt elle donne une fois pour toute le nom d'automatisme au mécanisme.
Il n'est pas étonnant qu'à tenter de réduire un automatisme à un mécanisme, reste toujours un point aveugle.
Il est une autre façon alors de rejeter l'évidence : donner une fois pour toutes le nom d'automatisme au mécanisme.
le paquet de papier avec lequel je viens de rouler ma cigarette arbore fièrement en majuscules : AUTOMATIQUE.
* Le 10 octobre
Le pompeux « AUTOMATIQUE », sur mon papier à cigarettes, avait déjà depuis de longues années attiré mon attention :
Bien jeune d'abord, lorsque je commençai mon exploration du surréalisme, mais sans me poser alors aucune question. Un peu plus tard, lorsque je tendais à me consacrer exclusivement à la peinture (1976-1977 - j'y roulais alors du scaferlati bleu.)
Aux environs de 1980, je fus entraîné à m'interrogé sur l'automation dans l'industrie.
L'automation et la commande numérique étaient, au tournant des années soixante-dix &endash; quatre-vingts, le principal problème de l'industrie de l'économie et de la politique.
J'ai toujours pensé que la critique marxiste de l'économie politique manquait de radicalité (2). Tout d'abord parce qu'elle n'était qu'une critique. Si l'économie est un leurre, encore devrait-on dire de quoi. Répondre : « de la lutte de classes », ne me satisfait pas. La lutte des classes pourrait n'être qu'une lutte économique ; dans le même sens où Clausewitz dit que la guerre est une forme plus brutale du commerce.
Je reste perplexe devant le schéma d'une lutte de classes qui serait d'abord économique - revendication du salaire et du niveau de vie - pour sauter de là dans le politique et le juridique - ce schéma est trop oublieux de la technique ; ignore trop la part de lutte en jeu dans l'organisation technologique du travail. Or la technique aussi s'élève jusqu'à la loi - mais la loi scientifique, pas juridique.
A mes yeux, toute la faiblesse du marxisme tient à cela : limiter le champ à des infrastructures économiques et des superstructures idéologiques et juridiques, là où sont des infrastructures technologiques et des superstructures scientifiques. Entre les deux : le langage, le signe, l'épistémé. (3)
Toute la conception des classe est amenée à changer selon ces points de vue. Ce n'est plus alors la dépossession qui caractérise la chasse porteuse d'une dynamique, mais plutôt le rôle actif joué dans l'organisation technique du travail. Ce n'est plus le caractère « prolétarien » mais « ouvrier » qui est déterminant d'une posture de classe.
C'est parce que la bourgeoisie a été une classe « ouvrière », avant tout et constitutionnellement, qu'elle a été révolutionnaire. Cessant d'être ouvrière pour devenir marchande, elle perd son rôle progressiste.
On peut mesurer alors la différence entre un syndicalisme principalement marchand, soucieux de négocier au plus haut la force de travail, et un syndicalisme préoccupé de maîtriser la technique. (4)
Il ne s'agit bien évidemment pas de condamner ici les revendication économiques. Il est d'ailleurs évident que les augmentations de salaire et la baisse du temps de travail font l'effet de coups de fouets sur l'innovation technique. Mais on s'illusionnerait en croyant qu'il suffit de revendiquer pour pousser l'industrie à enrichir le travail de telle sorte qu'il puisse satisfaire les revendications. D'autant que, et c'est bien ce qu'on a commencé à voir dans les années soixante-dix, l'innovation technologique peut très bien servir à se passer de travailleurs.
C'est dans ce contexte qu'avait lieu un important brassages d'idées sur l'automation et la commande numérique. (5)
Et c'est à cette époque là que les lettres majuscules « AUTOMATIQUE », sur mon papier à rouler, ont recommencé à m'intriguer. Mais, cette année, la réponse m'a peut-être été donnée par le paquet lui-même. Sous
« AUTOMATIQUE », est écrit, toujours en majuscules :
« 1894 &endash; CENTENAIRE &endash; 1994 ».
* Le 11 octobre
Automatique n'est qu'un slogan publicitaire.
AUTOMATIQUE n'est qu'un slogan publicitaire, contemporain à « automobile ».
Ce slogan est en fait une figure de rhétorique : le slogan est un trope moderne. On est souvent dépité d'avoir pris un slogan au sérieux ; au pied de la lettre. Un slogan n'est pas fait pour ça. On aurait tort de penser qu'il soit fait pour tromper. Quand on entend parler d'une nouvelle « voiture révolutionnaire » on sait bien qu'elle n'a rien a voir avec « la grande Révolution Prolétarienne ». C'est pourquoi d'ailleurs on la photographie sur la Grande Muraille de Chine avec force drapeaux rouges. C'est dire à ceux qui la voient : « cherchez le rapport entre ces deux réalités éloignées ».
Mais pour que la figure fonctionne, il faut bien que deux réalités continuent à être perçues comme éloignées. Si « révolutionnaire » se met à vouloir dire « dernier cri de progrès », ce n'est plus une figure, mais une simple information.
*
L'usage politique de « révolution ».
L'usage politique de « révolution » a d'ailleurs la même origine et le même fonctionnement : « cherchez le point commun entre soulèvement populaire et tour complet sur soi-même ».
On pourra dire que, faire un tour complet sur soi-même, ce n'est jamais que revenir à son point de départ. C'est vrai, mais ce n'est pas sur cela que l'usage publicitaire (6) de « révolution » - son utilisation en slogan - veut attirer l'attention : c'est sur son côté mécanique des sphères. Le slogan prétend réconcilier (ou, admettons, dépasser) mécanique et messianisme. (Newton et Münzer ; mysticisme et positivisme.)
Cela est clair tant que « révolution » est d'abord un terme physique, astronomique. Lorsqu'il devient principalement politique, il ne dit plus rien ; il ne signifie rien d'autre que sa dénotation, et il peut alors être détourné en publicité automobile.
Le même processus s'est déroulé avec « automatique » : à force de nous faire chercher en quoi un mécanisme pouvait être automatique, automatisme a fini par s'associer à mécanisme ; et l'on en est venu à parler « d'automation » sans que plus rien n'appelle à chercher dans l'usage de ce terme la moindre figure de rhétorique ni la moindre connotation.
*
Encore une fois je sens que la piste que je suis bifurque. Dois-je continuer à chercher du côté d'une continuité entre perceptif et cognitif, ou dois-je suivre la piste qui va me conduire à parler de connotation et de dénotation ?
Ma méthode peut paraître quelque peu désordonnée, incohérente. C'est qu'elle mise au contraire sur une toute autre cohérence (aventureuse, sans doute). Ce n'est pas pour rien que je compare ce journal à une chasse. Chasser demande de bons mollets et le sens de l'orientation.
*
Je ne partage pas certains points de vue de Jakobson sur le langage. Tout d'abord, parce que je ne pense pas que le langage ait pour principale fonction la communication. Le langage ne se prête qu'accessoirement à la communication, et il s'y prête assez mal.
Poser le langage comme un outil de communication entre un émetteur et un récepteur est une figure tout à fait trompeuse.
Au coeur de cela sont les notions de dénotation et de connotation, auxquelles la linguistique moderne fait subir de trompeuses mutations.
*
Une publicité pour une voiture « révolutionnaire ».
Dans l'exemple d'une publicité pour une voiture « révolutionnaire », que je citais précédemment, où sont la connotation et la dénotation ? On pourrait dire que la dénotation renverrait au renversement politique - Révolution Française, Révolution d'Octobre, etc... - et que la connotation renverrait au débridage festif de l'imagination de mai soixante-huit. (7)
- Mais, quand Marat ou Cabet emploient le terme de « révolution », la dénotation serait alors astronomique.
*
La dénotation et la connotation.
Quand Jakobson définit la dénotation et la connotation ou, après lui, André Martinet, Georges Mounin ou Henri Meschonnic, la dénotation correspondrait à une valeur reconnue par tous - une sorte de signification admise du terme -, et la connotation serait un supplément subjectif ajouté (plus-value affective).
Ce point de vue est modulé de façons diverses chez chacun, et avec des intelligences inégales.
« Pour comprendre ce que représentent la dénotation et les connotations d'un terme, il faut essayer de se représenter la façon dont tout enfant apprend sa langue : les données de départ sont, pour lui, des suites de sons d'un type particulier articulées par les gens qui l'entourent dans des circonstances déterminées ; il remarque un jour la récurrence d'un certain segment de la chaîne de la parole dans certaines situations qui comportent la présence d'un certain objet, disons le segment [lãp] dans une situation où figure l'objet lampe. Il n'est nullement certain que l'identification se fera correctement du premier coup. Correctement veut dire, bien entendu, selon la norme de la langue. Il se peut que le rapprochement se fasse entre l'objet et [lalãp] ou encore entre [lãp], [lalãp] et le cône lumineux qui éclaire la table de la sale à manger. [...] Finalement l'enfant identifiera son comportement linguistique à celui de la communauté. Il saura distinguer entre [lalãp] et [ynlãp] ; il identifiera la lampe non plus avec le cône de lumière, mais avec l'appareil qui est à sa source. Il saura que l'allumage de la lampe ne coïncide pas nécessairement avec tel ou tel rite familial, avec telle joie ou telle contrariété. Lorsqu'il était tout petit, [lãp] « voulait dire », pour lui, aussi bien « lampe » que tout ce qui se rattachait à l'allumage de la lampe, maintenant qu'il est grand, il sait que [lãp] veut dire « lampe » et rien de plus. Mais il restera peut-être à jamais sensible à tout ce qui s'attachait à ce mot avant qu'il ait commencé à faire le dur apprentissage de sa vie d'adulte dans un monde où l'on doit se conformer aux règles, celles du langage et les autres. » (8)
*
« A l'époque de la publicité automobile, "révolution" avait une connotation spécifique, toute chargée de gauchisme et de maoïsme. Une connotation toute différente de celle qu'elle avait pu avoir en 1789, en 1844, en 1871, en 1917, ou en 1945. »
- ... Et de celle qu'elle avait chez Newton. Mais en quoi cela relève-t-il plus de la connotation que de la dénotation ? Ou encore : en quoi de telles connotations seraient-elles distinctes de la définition, en quoi seraient-elles subjectives ?... Existe-t-il vraiment des dénotations distinctes de telles connotations ?
Ces connotations ne seraient-elles pas comme des pelures d'oignons qui, si on les épluche pour en dégager la dénotation, ne laisseront plus rien au milieu ? ( si ce n'est peut-être l'étymologie, et encore (9)).
*
J'ai qualifié plus haut la bourgeoisie de « classe ouvrière ».
On pourrait me dire que « classe ouvrière » est un terme déjà très connoté.
Je ne conteste pas l'emploi du terme « connoté » dans cette acception là, car elle est tout à fait claire et sans ambiguïté. Mais je mets au défi d'en systématiser l'usage de façon rigoureuse à partir de cet emploi seul.
*
Comment et par qui les termes sont-ils connotés ? Par l'usage ?
- En quoi cette connotation de « classe ouvrière » sert-elle à mieux comprendre mon propos ? - En rien. Au contraire, elle ne peut que gêner, et c'est pourquoi on pourrait t'en faire reproche.
- Mais en quoi mon propos fait-il appel à cette connotation ? Alors que me reproche-t-on ? Que mon lecteur pourrait ne pas savoir me lire ? Qu'y puis-je ?
- A moins que cette connotation n'importe avec elle sa propre critique du langage ? Tu emploies sciemment des termes « connotés » pour démasquer ce qu'ils ont de fallacieux.
- Peut-être mais, quand bien même, il faudrait déjà pouvoir me lire en en faisant abstraction ; comprendre la dénotation indépendamment de la connotation. En définitive la question est là : « cette connotation doit-elle être (re)connue pour pouvoir me lire ? - Dans ce cas, la réponse est non. (10)
*
J'oppose à Jakobson d'autres définitions. Je veux bien associer dénotation à l'usage du terme tel qu'il est établi et tel qu'il est supposé connu ; mais je renvoie la connotation à son emploi dans un contexte particulier. (11)
Ainsi, au dix-huitième siècle, la dénotation de révolution renvoyait à la rotation complète sur soi et, de là, à la mécanique céleste aussi bien qu'à la figure de « La Roue de Fortune » du tarot. (Et je dis bien que cela relève de la dénotation et non de la connotation.)
La connotation de révolution dans un discours politique, à la fois restreignait et étendait sa signification.
D'une part, il y a restriction de l'acception - quoique cette restriction agisse quelque peu à la manière d'un trope -, et d'autre part, extension - dans le sens où la dimension scientifique et déterministe (mais aussi bien messianique : révolution contient l'idée de retour, retour éternel, éternel retour) est associée à l'idée d'insurrection. Toutes choses que le discours révolutionnaire de l'époque spécifie. (Morelly, Code de la Nature, ou Condorcet, La Mettrie, Saint Just, Robespierre ou Sade.)
* Le 12 octobre
Voilà ce que je retiens et qui me semble essentiel dans les notions de dénotation et de connotation : la première renvoie à un « hors-texte », la seconde au « jeu » (à comprendre peut-être comme le che chinois) du terme dans son contexte.
Mais voici ce qui me gène : je ne sais pas ce qu'est le « hors-texte » (si ce n'est les définitions des dictionnaires - mais quels dictionnaire ?), ni je ne sais pas beaucoup plus ce qu'est le « jeu » dans le contexte.
C'est un « comment ça marche » qui fait question : « comment ça marche », et non le polissage d'une définition.
*
Soit, ce que dit Jakobson tient, se tient : on a des descriptions et des définitions qui n'entrent pas en contradiction immédiate les unes envers les autres ; mais c'est techniquement trompeur.
La connotation, pour Jakobson, ça fonctionne comme les madeleines de Proust. Le mot est chargé pour moi de toute l'histoire de ma relation à ce mot ; comme ses madeleines le sont pour Proust.
*
Le mot comme déclencheur (automatique) d'images intérieures.
Prenons le mot « camion ». Il déclenche chez moi la saveur de départementales du Vaucluse, de files d'arbres contre des talus, des ruisseaux, des canisses, des haies de cyprès, peu importe.
Oui, justement, peu importe : nul ne pourra le pressentir si je ne le dis pas. Je veux bien que cette charge affective puisse guider ma plume ou ma langue, mais elle est, en elle-même, intransmissible. Je ne puis employer ce mot comme s'il était, de par lui-même, déjà chargé de ces saveurs. Si je le fais, nul ne me comprendra.
*
- Qu'importe : je dis moi-même que la fonction du langage n'est pas de communiquer, mais d'induire.
- Soit : la charge affective des mots induit mon discours. Cela n'est peut-être pas sans intérêt d'un point de vue psychanalytique. Mais à partir de là, elle est passée dans le discours, et il n'y a plus aucun sens à la chercher ailleurs. Cette charge est dans l'articulation même des mots que je tisse et dans les rapports qui s'y entretiennent. C'est là qu'on la retrouve si l'on doit la retrouver. Si elle n'y est pas, il n'y a aucun sens à dire qu'elle serait « dans mon esprit ». (12) (Et cela, même si je ne fais que me parler à moi-même, ou prendre des notes privées.)
Cela peut se dire aussi : il n'y a pas de langage privé.
*
Disons que, la notion jakobsonnienne de connotation, j'en fais la translation de l'esprit à la lettre (au texte).
C'est à dire que je n'entends plus parler d'une valeur qualitative que le mot aurait pour moi.
- Le mot ou la chose ? De quoi parle-t-on alors ? Dans l'esprit de Proust, y a-t-il le mot « madeleine » ou des madeleines, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre ? Et qu'est-ce que cela voudrait dire ? Comment en parler ?
Je n'entends retenir que la valeur spécifique que le mot prend dans mon discours : la valeur spécifique qu'il prend dans un contexte. Si l'on doit donner un sens objectif au terme de connotation, on ne peut le définir qu'à l'intérieur d'un cadre strict du jeu de langage.
*
Le terme même de « jeu ».
Ainsi, le terme même de « jeu » prend une connotation précise quand il est placé dans ce contexte, et en prend une autre quand on parle de « jeu éducatif », une autre encore dans « passion du jeu », et une troisième dans « jeu de clés ». Et « jeu de clés » prend encore des valeurs distinctes lorsqu'il s'agit de clés de portes ou de clés d'écrous. Seul le rapport aux autres termes nous permet de percevoir immédiatement la valeur spécifique. (Je dirai : connotative.)
(Ce qui me trouble ici - ce qui est dans tous les cas troublant -, c'est que les définitions de « connotation » et de « dénotation » auraient tendance à s'inverser : connotation finirait par signifier ce que Jakobson nomme dénotation : définition exacte.)
*
« Percevoir immédiatement la valeur spécifique ».
- Il s'agit bien, en effet, de perception immédiate.
Nous ne commençons pas par interpréter le mot comme un large concept dont nous déduisons après coup l'acception précise. C'est l'acception que nous percevons d'abord. (Je dis bien « percevons » - voilà que la piste repasse sur les traces de juillet. (13))
*
Un Anglais sera peut-être troublé par la locution « jeu de clés ». Dans sa langue il dit bunch (bouquet). Il va alors vérifier « jeu » dans le dictionnaire, et découvrir les dénotations précises du mot en Français. De là, il déduira le sens exact de « jeu de clés », et de là encore, la connotation, plus précise et plus large à la fois, que prendra peut-être le mot dans l'ensemble de son contexte.
Ce n'est pas du tout ainsi que fonctionnera l'esprit de celui qui maîtrise bien la langue française : il sautera immédiatement à la connotation, et si rien ne vient les lui rappeler, il ignorera les dénotations. (14)
Quand nous lisons « arbre de direction », nous ne pensons pas aux différentes acceptions du mot arbre, mais un trope pourrait venir nous les rappeler.
Par exemple : « Chaque mot qu'emploie Mallarmé est comme un jeu de clés, dont nous avons à retrouver les serrures ». (15)
----------------------------------------------------
Le 13 octobre
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change
Le poète suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange.
Le premier quatrain du Tombeau d'Edgar Poe de Stéphane Mallarmé est très connu. Il a été abondamment cité, commenté et expliqué : c'est après sa mort que le poète se révélerait définitivement pour ce qu'il est. Ce n'est pourtant pas ce que j'ai compris quand, lycéen, j'ai lu pour la première fois ce poème.
La proposition principale est : Le poète suscite son siècle. Ce sont les trois termes qui articulent le quatrain : un sujet, un verbe, un complément d'objet direct. On notera ce dernier point que le complément d'objet est direct, et que le poète ne suscite rien à son siècle, mais le suscite.
C'est un emploi inattendu du verbe susciter, et qui renvoie à sa racine : citer. Préfixe et racine fonctionnent comme dans prédire. Mais c'est plutôt susdire, surdire que préciter, ou prociter. Non dire en avant, à l'avance, mais dire plus haut, dans un sens plus élevé.
Il suscite donc son siècle, comme il prédiquerait ? - Mais cela n'explique pas mieux la forme directe : Moïse prêche aux Hébreux la Terre Promise, mais il ne prêche pas les Hébreux.
Plutôt suscite-t-il son siècle comme Moïse prophétise la Terre Promise et le Peuple Élu. (16)
Au verbe est associé, comme locution adverbiale, « avec un glaive nu ». « Un glaive » se rapporte bien entendu au sujet, mais qualifie principalement sa façon d'agir, de susciter, c'est à dire : brutalement. L'image de l'ange est évoquée, qui sera reprise dans le quatrain suivant :
Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu
Proclamèrent tout haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
Nous sommes passés de l'épée de Michel au verbe de Gabriel. Reste à savoir ce qui, dans le premier quatrain est attribut du sujet, et ce qui l'est du complément.
Il est assez clair que c'est le siècle qui est « épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange ». Mais peut-on être aussi sûr que « Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change », se rapporte au poète, comme chacun semble vouloir le lire ? Je n'en ai jamais été convaincu.
*
Du point de vue de l'articulation syntaxique, le premier vers :
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change
fait manifestement épithète au premier nom du second :
Le poète suscite avec un glaive nu.
Mais une phrase se comprend-elle vraiment par sa seule articulation syntaxique ? « Il marche avec les mains derrière le dos », cela veut-il dire que c'est à l'aide de ses mains (derrière le dos) qu'il marche ?
*
Ce que je pose là est un aspect essentiel de la langue, et qui la distingue de tout langage formel (le langage mathématique par exemple). Du point de vue du langage formel, c'est ce qui fait l'imperfection des langues naturelles. (Mais tout aussi bien du point de vue de la grammaire de Port-Royal.)
Mais c'est aussi bien ce qui fait sa supériorité - qui fait qu'utiliser la langue naturelle est immédiatement penser (et aussi bien percevoir - justement à cause de cela -, et agir aussi : opération qui suppose son agent), alors que ne l'est pas le langage formel (qui peut être intégré à un mécanisme).
*
Inutile de préciser que ce que dis là est le propos même du discours mallarméen ; du discours mallarméen en général, et du Tombeau d'Edgar Poe en particulier.
De toute façon, l'usage que Mallarmé fait des mots éclate complètement la syntaxe. La syntaxe n'est plus alors que mouvement, rythme, flux, souffle de la pensée - et non pas seulement chaîne de dérivation. Sa ponctuation, (notée ou non) n'a pas une fonction d'embrayeur logique, mais rythmique - elle tempère la phrase et, de là, l'étymologie.
* Le 14 octobre
« Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change » se rapporte à siècle. Aucun commentateur ne m'a convaincu du contraire. Pourquoi ?
Les deux lectures on un sens. Si le poète est changé par l'éternité, la remarque devient triviale. Si c'est le siècle, l'idée devient nettement plus riche et plus profonde.
La première interprétation, relative au « personnage » qu'est le poète, « l'auteur », s'accorde mal avec son assimilation à un ange. A moins de le comprendre comme si l'éternité changeait le poète en ange. Mais tout le sens du poème se met alors à tourner sur lui-même : le poète est un ange dont le message consiste à dire qu'il est un ange.
*
Du point de vue syntagmatique comme du point de vue paradigmatique, la langue de Mallarmé semble obscure. Mais elle n'est pas obscure, elle est floue, comme l'est la peinture impressionniste qui lui est contemporaine. Floue, mais limpide. Comme sur les taches où je vois apparaître un visage, de son hermétisme peut naître une image nette.
Son hermétisme est ce qui interdit de chercher une netteté dans la seule articulation d'une syntaxe logique. L'image ne se laisse pas déduire d'un tel déchiffrage, mais surgit tout à coup. Comme dans un tableau de Van Gogh : d'une simple tache noire dans le bleu, on sent le vol nerveux d'un corbeau.
C'est ainsi que se lit Mallarmé. C'est ainsi qu'il est limpide.
*
Relisons le premier quatrain en intervertissant le premier et le second vers :
Le poète suscite avec un glaive nu
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange.
Je suis persuadé que, si on lisait les brouillons de Mallarmé, c'est à peu près dans cet ordre que l'on découvrirait le premier jet.
*
On sent que ce « Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change » ne sait pas où se placer. Cette proposition est à la fois aparté et proposition essentielle du quatrain, clé du poème entier. Sa célébrité, les perpétuelles citations en témoignent : ces quelques mots sont proprement sibyllins, ils travaillent d'autant mieux qu'on en épuise mal l'interprétation ; qu'ils semblent toujours conserver un excédent de sens.
Où qu'on les place, ils s'extraient de la phrase de quarante-huit syllabes qui forme le quatrain, se déplacent d'eux-mêmes au-dessus. Ils sont en fait plus « au-dessus » que « devant ». C'est ainsi que je les lis.
*
Mallarmé inaugure le temps à deux dimensions. Au-dessus, par dessus - qui vient se superposer à l'avant et l'après : au « plus haut » et au « plus bas » du texte.
Lisons Un coup de dé : le texte se déroule sur deux dimensions et, là, c'est inscrit dans la mise en page et la typographie.
Le premier quatrain du Tombeau d'Edgar Poe contient déjà cette construction du Coup de dé. Elle n'est pas notée, pas marquée ; mais elle est lisible, de même qu'une ponctuation peut être sensible, et devra se marquer, même si aucun signe de ponctuation ne l'indique.
*
Observons la structure symétrique des deux quatrains : chacun a un sujet, qui est l'objet de l'autre : « Le poète », « Eux ».
Si ma lecture est bonne, ces sujets se suffisent entièrement à eux-mêmes ; ils n'ont besoin d'aucun complément, d'aucune proposition relative.
Relisons dans l'ordre que j'ai proposé :
Le poète suscite avec un glaive nu
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange.
Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu
Proclamèrent tout haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
Le poète suscite -> [l'ange] donn[ant] un sens plus pur aux mots de la tribu.
Eux proclamèrent -> son siècle tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change.
Nous sortons de la trivialité pour saisir la pensée mallarméenne du langage (du verbe) : ce rapport du prophétique, de l'hermétique et de l'historique. (17)
Interprété ainsi, le poème n'exclut pas entièrement la lecture convenue. Cependant, la lecture convenue ne contient pas cette interprétation.
* Le 19 octobre
Il serait peut-être aussi intéressant de comparer les verbes : susciter, proclamèrent. « Suscite avec un glaive », « proclamèrent tout haut ».
Suscite dans la matière ; fait surgir (comme le sculpteur avec son burin).
Proclamèrent tout haut, comme « les chiens aboient, la caravane passe ».
Comme un vil sursaut fait ici manifestement fonction de locution adverbiale pour proclamèrent, comme avec un glaive nu, pour suscite. Le second verbe n'est que réactif, comme l'autre est actif et créateur.
Il y a une symétrie inversée :
Lui (le sujet singulier) suscitant (à la fois énonçant, donnant forme, réalisant - changeant en lui-même) son siècle (l'objet collectif).
Eux (sujet collectif) déclarant (comme un simple sursaut, un ressort qui se détend) le sujet de l'énonciation (comme) simple jouet (l'objet) de l'ivresse et du délire.
« Comme », apposé juste après le sujet, a une fonction essentielle qui commande tout le second quatrain.
Le sujet y est pris comme objet - mais demeure sujet : l'ange donnant un sens plus pur aux mots de la tribu - et l'objet comme sujet : le « siècle » devient « Eux », dans cette inversion.
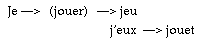
----------------------------------------------------
Le 15 octobre
A plusieurs reprises Wittgenstein parle de « forme de vie » pour qualifier le fonctionnement du langage et de la pensée. (Dans De la certitude, Fiches, Investigations╔) Cette formule a été abondamment discutée par les commentateurs (Bouveresse, Meschonnic (18), J. Schulte (19)...).
J'ai découvert Wittgenstein quand j'étais adolescent, et donc bien avant qu'on ne le commente beaucoup.
Je comprenais, dans sa locution « forme de vie », que la langue et la pensée entretenaient ensemble une forme de vie autonome (automatique), du même ordre que celle de la vie biologique et de l'organisme. (Un peu dans l'esprit de ce que tentait de montrer Descartes dans Les Passions de l'Âme, ou Le Traité de l'Homme).
Il me semblait que Wittgenstein évoquait ainsi le passage d'un mécanisme, voire d'une dynamique, à un automatisme : à ce que l'on pourrait appeler « vie ».
J'ai découvert depuis que c'est tout autrement que ses commentateurs l'entendent. Pour eux, Wittgenstein veut dire qu'il n'est de signification qu'associée, immergée dans une forme de vie. C'est à dire qu'elle n'a pas d'existence indépendante d'un comportement et de la relation au réel et aux autres.
C'est sous certains aspects le contraire de ce que je comprenais. J'avais pourtant, bien sûr, parfaitement saisi que Wittgenstein disait cela - tout particulièrement dans la première partie des Investigations : que le « dire » n'est jamais séparable d'un « faire » et d'un agir ; et même que le « vouloir-dire » n'est jamais indépendant d'un « vouloir-en-venir-à ».
Mais il me semblait que « forme de vie » voulait en dire plus. Car Wittgenstein ne dit pas (seulement) que la parole participe à « une forme de vie », ce qu'on a déjà très bien compris, mais qu'elle est comme « une forme de vie »... ou qu'il y a « là comme une forme de vie ».
*
L'image que fait spontanément naître en mois la locution de Wittgenstein, est celle de branchages et de feuillages. Les branches et les feuilles - j'en ai là, devant les yeux, de la terrasse où j'écris - poussent et croissent régulièrement. Cette régularité se lit en elles : noeuds réguliers sur les branches, nervures sur les feuilles.
- La vie végétale obéit-elle à cette régularité ?
- Comment pourrais-je distinguer l'une de l'autre ?
* Le 16 octobre
Je suis revenu au texte pour vérifier que je ne « m'inventais » pas une philosophie de Wittgenstein selon mon propre désir de la lire.
Il est clair que ni Bouveresse, ni Meschonnic, ni Schulte ne prêtent à Wittgenstein des intentions qu'il n'aurait pas, ou qui m'auraient seulement échappé. Je lis très clairement, comme ils le font, que Wittgenstein associe tout phénomène linguistique, mental et cognitif à une façon de vivre dont il participe ; une façon, une manière de vivre, une forme de vie.
La lecture que je fais ne s'oppose en rien à cette interprétation, elle la prolonge. Reste à savoir si c'est ma seule lecture qui va plus loin, ou le propos de Wittgenstein.
Il n'est pas facile d'en être certain, à cause de la façon dont Wittgenstein use de son vocabulaire.
*
Wittgenstein invente des notions qui ont tous les couverts de termes techniques, mais qu'il n'emploie pas comme des termes techniques : « forme de vie », et aussi « jeu de langage », « expérience privée »... C'est à dire - et je continue à « tresser » le fil de ma pensée, plutôt que de le « dérouler » - qu'il ne protège pas leurs dénotations des contagions connotatives (comme cherche à le faire tout philosophe normal).
Évidemment : ce n'est pas parce qu'on invente la notion de jeu de langage, que « jeu de langage » échapperait au jeu de langage dans lequel il est employé ; ce n'est pas parce qu'on invente la notion de connotation, que « connotation » échapperait à toute connotation.
(L'analytique aristotélicienne manifeste bien ici toute son insuffisance, sans pourtant se révéler proprement « fausse », ni même cesser d'être géniale.)
*
Est-ce ma propre imagination qui lit chez Wittgenstein le principe d'une vie autonome du sens ?
Ma découverte de Wittgenstein est à peine postérieure à ma découverte d'André Breton, à l'âge où l'esprit est comme une branche verte de frêne, et où l'on pressent d'autant plus vivement que l'on comprend moins. N'aurais-je pas un peu brouillé les lectures ?
Cette vie autonome du sens, je la connais bien et la pratique. J'en suis un professionnel ; elle me nourrit, je gagne ma vie à la cultiver, et la connais comme un paysan connaît sa terre.
Que je découvre cela chez Wittgenstein n'est pas très étonnant. Je le lis, mais lui, l'a-t-il écrit ? C'est bien la question que ses commentateurs me font me poser.
* Le 17 octobre
A l'analyse, la question que je me pose se dédouble : 1) l'auteur a-t-il bien dit ce je lis ? 2) l'auteur a-t-il bien voulu dire ce que je lis ?
Je suis revenu au texte et, ma foi, je lis bien ce que j'y ai toujours lu. Wittgenstein y montre bien une vie autonome du sens. D'ailleurs, à vouloir dire autre chose, son expression serait curieuse, obscure.
Je pourrais extraire ici des séries de citations disant que l'acte de langage est inséparable de la situation dans laquelle il s'inscrit, ce que Wittgenstein exprime à plusieurs reprises avec une parfaite limpidité, et tenter de montrer que ces passages servent bien davantage de présupposés à des propositions telles que « n'y a-t-il pas là comme une forme le vie ? », plutôt que ces derniers n'en seraient des raccourcis sibyllin.
A supposer que Wittgenstein n'ait désiré rien d'autre, là, que condenser sa pensée, alors il n'y parvient pas, ou mal. Il condense une pensée déjà clairement compréhensible dans une formule qui ne l'est plus, et qui justement ne l'est plus parce qu'elle contient, ou génère, un excédent de sens, qui va bien plus loin que ce qu'elle prétendrait condenser.
*
Un texte difficile. Qu'est-ce qu'un texte difficile ? Cette suite me fait m'interroger sur ce qu'est un texte difficile.
Je suis un jour monté sur une moto que l'on m'avait prêtée, et qui avait une vitesse de plus que toutes celles que je connaissais - c'était une moto de trial. Cela me faisait une curieuse impression de conduire un engin sans passer la dernière vitesse ; je trouvais le moteur un peu « bizarre », mais je me disais « c'est une moto trial, ce doit être normal ». C'est un peu la même chose lorsqu'on se dit qu'un texte est « difficile ».
On ne soupçonne pas qu'on n'est pas sur la bonne vitesse, le bon pignon, le bon « niveau », et on se dit « c'est un texte difficile ».
Nous connaissons beaucoup d'auteurs qui sont « difficiles » de cette manière : Mallarmé, Hegel, Wittgenstein, Lacan... (20)
En général, ce qu'on trouve « difficile » dans un auteur, c'est l'effort intellectuel qui consiste à ramener tout ce qu'il dit d'inédit, ce qu'il montre d'inconnu, à des conceptions qui nous sont déjà familières. C'est souvent beaucoup plus difficile que de se laisser entraîner dans leurs visions.
Un auteur « difficile » est généralement surpris d'être trouvé difficile.
* Le 17 octobre
J'ai écrit avant-hier : [Je comprenais que] la langue et la pensée entretenaient ensemble une forme de vie autonome (automatique), du même ordre que celle de la vie biologique et de l'organisme. (Un peu dans l'esprit de ce que tentait de montrer Descartes dans Les passions de l'Âme, ou Le Traité de l'Homme).
Voici un très bon exemple du cas ou le dire va plus loin que le vouloir dire. Cette phrase a été corrigée. J'ai bien cherché à rejeter de ce dire ce qui m'entraînait trop loin de mon vouloir-dire. En voici la première version : [Je comprenais que] la pensée et la langue entretenaient entre elles une relation de vie autonome (automatique), du même ordre que celle de la vie et de l'organisme. (Telle que pouvait la montrer Descartes...)
L'idée qui me tape à l'esprit est celle d'une corrélation entre, d'une part, langage et sens et, d'autre part, organisme et vie.
(Mon esprit est très attaché à ces sortes de doubles relations, de double polarisation, de structures quaternaires, surtout depuis que je me suis efforcé de comprendre et d'éprouver l'idée de tercéité de Peirce.)
---------------------------------------------------
Le 20 octobre
Dénotation renvoie à un hors-texte, connotation au jeu du terme dans son contexte. Qu'est ce que ce hors-texte, et ce jeu dans le contexte ?
Un jeu dans le texte, et un jeu hors du texte : voilà exactement ce que je cherche à cerner. Pour cela, je ne veux faire appel à rien d'autre que le texte, le discours, ce qui est dit, ce qui est écrit.
Je ne veux pas faire appel à des éléments insaisissables tels que l'expérience de l'apprentissage de la langue, comme Martinet, ni à quoi que ce soit de psychologique ou de culturel, ni m'appuyer sur des notions de signification ou de signifié, ni même sur des définitions de dictionnaires.
Dans Le Tombeau d'Edgar Poe, j'ai tenté de montrer le jeu des mots dans leur contexte : par exemple, suscite avec glaive nu, ou encore, tout haut avec sursaut.
*
Hors du texte. Le jeu hors du texte.
Tout francophone est parfaitement capable de percevoir la relation entre « citer » et « susciter ». Aussi pauvres que soient ses connaissances grammaticales, il a les moyens de reconnaître le verbe « citer » précédé du préfixe « sus » ; cela même s'il ignore les notions de racine et de préfixe. Il reconnaîtra aussi bien « saut » dans « sursaut ». Il l'admettra ou non, mais il en sera en tout cas capable, du seul fait qu'il connaît la langue.
*
Observons ce qu'il se passe quand nous cherchons à interpréter un mot que nous ne connaissons pas. Nous avons deux types d'indices pour cela.
Il lui insuffla l'idée de partir. Supposons que nous ne connaissions pas le verbe insuffler. Mais nous connaissons six des sept termes de la phrase : Il lui (?) l'idée de partir. A partir de ces six mots connus, nous pouvons déjà imaginer le sens et, de là, quantité de verbes qui pourraient remplacer susciter : inspirer, suggérer, donner, souffler╔ Nous pouvons aussi nous arrêter au mot seul, l'extraire de sa phrase et nous occuper de sa morphologie. On trouve alors sans peine le radical souffle à peine modifié, et précédé du préfixe in. En fait, nous combinons ces deux méthodes.
Nous faisons ainsi quand nous ne connaissons pas un mot, mais aussi bien quand nous le connaissons, car en réalité, nous ne connaissons jamais par avance le sens d'un mot, du moins son sens précis dans un contexte donné.
C'est également ainsi, par ailleurs, que nous apprenons une langue - du moins notre langue maternelle - car nous n'avons pas appris à parler comme nous avons, par la suite peut-être, appris d'autres langues, en mémorisant des listes de mots avec leurs définitions et des règles de syntaxe, pour nous entraîner ensuite à les accorder automatiquement. Nous avons fait l'inverse.
*
Je me souviens, enfant, avoir pour la première fois entendu la locution « il est venu parmi nous... ». Cette tournure ne m'était pas du tout familière, et je l'interprétai ainsi : « il est venu par minou... » - qui correspondait mieux à mon vocabulaire enfantin.
Que pouvait bien vouloir dire « venir par minou » ? Il me suffisait d'imaginer comment un « minou » pouvait « venir » : avec ses pattes de velours, sa souplesse à se faufiler sans qu'on ne le voit. « Venir par minou » ne pouvait signifier que « venir en douce », « arriver subrepticement », sans qu'on ne s'y attende, sans qu'on n'y ait prêté attention et surprendre tout à coup par sa présence. Le contexte - spectacles de musique hall dans lequel mes parents avaient dû me traîner, et où l'on voyait soudain surgir la vedette dans l'émerveillement général - dans lequel j'avais deux ou trois fois entendu cette expression - bizarre mais belle, et au fond pas plus invraisemblable que « tiré à quatre épingles » et tant d'autres - ne me permettait pas de découvrir le contre sens.
*
Nous pourrions comparer cela avec « bayer aux corneilles », ou plutôt « bailler aux corneilles », puisque cette seconde expression a complètement remplacé la première. « Parler aux corneilles », pour dire « parler dans le vide », parler seul, sans être écouté, sans interlocuteur, sans s'adresser à quelqu'un, comme un enfant parle seul en jouant, est devenu « bailler aux corneilles », bailler en regardant le ciel, s'oublier dans la somnolence, à cause de l'homonymie avec l'ancien français « bayer » (parler, raconter, dire).
*
L'étymologie.
L'emploi de l'étymologie demande des précautions. L'erreur consiste à voir l'étymologie comme une simple archéologie des mots : la recherche de leur sens originel. Mais il n'y a pas de sens originel. Où serait cette origine ? Au mieux trouvera-t-on l'origine d'un mot dans une autre langue, mais la même question se posera à nouveau au sein de cette langue.
D'où vient un mot ? - Comment pourrions-nous le savoir ? Et à supposer que nous le puissions, en quoi cela éclairerait-il son emploi actuel ? Et en quoi, surtout, se rapprocherait-on d'un sens plus « vrai » (plus pur) en s'approchant de l'origine.
Pourquoi, à ce compte, n'irait-on pas chercher où va le mot ?
« Cool » est un mot à la mode, tout frais importé de l'Anglais, mais dont on refuse encore la naturalisation (creuser l'emploi de naturaliser). A supposer qu'il ne disparaisse pas aussi vite qu'il est apparu, il finira bien par devenir entièrement français et entretenir des liens de parenté avec d'autres mots français. Peut-être finira-t-il par s'écrire « coul ».
Observons bien déjà l'emploi contemporain de « cool » : en Anglais il veut dire « froid », « frais ». « Keep cool » : restez calme, gardez votre sang froid.
Disons qu'il reste le calme dans l'emploi de « cool » en français, mais déjà plus vraiment la fraîcheur. « Cool » se tiédit en français. Le mot est doux. Ce n'est plus la fraîcheur d'une source de montagne, mais le calme ruisseau, le saule qui se penche. C'est qu'en français, « cool » sonne comme « coule ». « Il est cool » : « il est coulant ». Peut-être un étymologiste futur, oubliant son origine clandestine, le rangera dans la famille de « couler ». Comme on a pu voir dans « algorithme » une origine grecque plutôt qu'arabe.
*
Voir plutôt l'étymologie comme la recherche de réseaux entre les mots - de réseaux actuels, en jeu dans le présent.
D'ailleurs, pour prétendre trouver l'origine, il faut bien que des traces en soient présentes. Le passé ne se cherche-t-il pas dans le présent ? Les vestiges que l'on trouve partout dès qu'on creuse à Marseille, on les trouve bien dans le présent : ils sont alors au grand jour, visibles par tous. Mais avant qu'on ne creuse, c'est comme s'ils n'existaient pas.
C'est la même chose avec le passé d'un mot : ou son étymologie est visible et lisible par tous, parce que son passé est en jeu, est présent dans sa relation aux autres mots (comme les vestiges grecs se trouvent sur le plan de la ville), sinon, il n'y a aucun sens à l'évoquer.
* Le 21 octobre
Syntagmatique et paradigmatique.
« N'es-tu pas en train de confondre syntagmatique et paradigmatique avec connotation et dénotation ?
- Pas du tout : quand j'accorde « tel qu'en lui-même enfin... » à « siècle » plutôt qu'à « poète », je ne me fie pas du tout à la syntaxe. C'est la même chose quand je comprends « il marche avec les mains derrière le dos ».
- Peut-être pourrais-tu dire que tu te fies à une syntaxe logique tout à fait indépendante d'une syntaxe grammaticale .
- Le terme de logique ici est gênant. A supposer une syntaxe au-delà de la grammaire, une sur-syntaxe, une métasyntaxe, on ne pourrait la dire proprement logique.
En arithmétique, si je lis « 4+3 = 12 », je penserai que le signe de l'addition a été mis à la place du signe de la multiplication. Mais je penserai qu'il lui a été substitué par erreur.
- Pourquoi parler d'erreur, puisque la lecture ne fait aucun doute ? A partir de ces trois chiffres : 4, 3, 12, tu ne peux imaginer d'autres connexions logiques qu'une multiplication et une égalité. N'importe comment l'écrirais-tu : « 4, 3 &endash;> 12 » ; « 4-3/12 » ; « 4 v 3 c 12 »... la relation que ces termes entretiennent entre eux est limpide.
- Pas si sûr. Rien ne me dit que 3 n'est pas un 8 mal dessiné.
- Quand bien même : « 4+8 » est exactement équivalent à « 4x3 » : « 4+(2x4) = 3x4 ».
C'est exactement ainsi que nous lisons les langues naturelles.
- Soit, mais pas l'arithmétique. « 4+3 = 12 » n'est pas une figure de style, mais une erreur, car en arithmétique, il n'y a pas de figure de style. Soit 12 = 4x3, soit 12 = 4+8. »
Ce que je veux dire, c'est que cette métasyntaxe, qui me fait associer « tel qu'en lui-même... » à « siècle », est tout ce qu'on veut sauf logique.
Serait-ce à dire que la logique est grammaticale ou n'est pas ? Ou encore, que la grammaire est logique ou n'est pas ?
*
Se peut-il qu'en me lisant on imagine exactement ce que j'imagine moi-même en écrivant ? (Il est peut-être temps maintenant de revenir à cette question laissée de côté le 19 juillet.) Cette question a-t-elle vraiment l'importance qu'on pourrait lui accorder, et quelle est-elle ?
Peut-être l'importance de cette question est-elle toute pratique ; technique.
L'expérience de [lãp] que fait le petit enfant en apprenant à parler, je ne pourrais jamais la partager ; pas davantage ce qui lui en restera quand, adulte, il emploiera « lampe ». (21)
D'autre part, la stricte définition de « lampe » que donne le dictionnaire, ne sera jamais suffisante pour interpréter un discours réel. Au fond, la locution « lampe » ne veut à peu près rien dire en dehors de son emploi. L'objet sonore [lãp], ou les pattes de mouche sur un cahier « lampe », ne veulent rien dire de plus qu'un objet lampe lui-même ne veut dire quelque chose.
Aucun dictionnaire, aucune grammaire, ni aucune expérience de l'apprentissage des mots ne peuvent me permettre de savoir à quoi associer « tel qu'en lui-même... », ou comprendre à quoi se rapporte « forme de vie ».
*
L'emploi curieux de « tautologique » en mathématiques.
« Ceci est tautologique », cela veut quelquefois dire : « ceci ne veut rien dire ».
Rien dire : « tout est dans tout et réciproquement ».
En un sens, une proposition mathématique ne veut rien dire ; ne veut pas vouloir dire.
C'est pourquoi « 4+3 = 12 » ne peut être qu'une erreur.
*
Tous ceux qui ont parlé « d'invention du langage » n'ont rien compris : ils ont confondu langue et langage.
Et si la langue était née de ce que des hommes aient cherché à vouloir dire quelque chose avec un langage ? (Par exemple à interpréter « 4+3 = 12 » autrement qu'en termes de juste ou de faux.) (22)
Vouloir dire ici n'est pas employé dans le sens de communiquer.
*
Le Tautologique : dans le sens d'embrasser la totalité de la signification.
Embrasser : envelopper, déterminer, discerner, limiter╔ Étouffer en embrassant le vouloir dire.
Une thermodynamique du sens. Retenir la dispersion du sens, étouffer le vouloir-dire - mais peut-être pas le sens - en faire une dynamique, une sémiodynamique.
Ce « vouloir-dire » serait-il un démon de Maxwell du sens ? Et cela, doit-on le comprendre comme un processus de consumation, de dégradation de l'énergie ? ou bien de (ré)génération ?
Embrasser, s'embraser - selon où va se placer le S baladeur du sujet.
----------------------------------------- TABLE SUITE -------------------------------
NOTES 1 « Bien que trente rayons convergent au moyeu, c'est le vide médian qui fait marcher le char » (Tao-tê-king).
2 Je veux dire que rien n'est jamais venu contredire mes premières intuitions.
3 Ce que perçoit très bien Peirce, qui exerce à sa manière un renversement de la dialectique hégélienne presque symétrique à celui de Marx. On a tort de ne pas confronter Peirce et Marx.
4 Voir Georges Sorel : Matériaux pour une théorie de prolétariat ; ou encore Bertrand Russell : Roads to Freedom, 1966. (Version française : Le monde qui pourrait être, Socialisme, Anarchisme et Anarcho-syndicalisme, Denoël 1973.)
5 Son importance fut proportionnelle à sa discrétion.
6 « Publicitaire » avait d'ailleurs, du dix-huitième au dix-neuvième siècles, une acception exclusivement politique.
7 Ce qui n'est déjà plus étude de la langue et du sens (grammaire, linguistique, sémantique), mais du signe (sémiologie).
8 André Martinet, « connotations, poésie et culture », dans To Honor Roman Jakobson. Cité par G. Mounin dans Sept poètes contemporains et le langage.
9 L'étymologie qui ne fait que déplacer l'insondable de la signification d'un mot dans une langue à une autre langue plus ancienne.
10 Mais si un lecteur veut y voir la critique de termes utilisés selon des connotations fallacieuses, j'en assume la paternité.
11 Dénotation et connotation seraient, l'un envers l'autre, dans une relation d'universel et de particulier.
12 Ce qui n'est pas non plus dépourvu d'intérêt pour la psychanalyse.
13 Le dessin d'une carafe et d'un verre posé sur un plateau : un dessin au trait par exemple dans un livre de vocabulaire. Est-ce que je vois immédiatement une carafe et un verre, ou bien est-ce que, en quelque sorte, j'interprète d'abord les traits pour y reconnaître ces objets ?
14 Pour le vérifier, il suffit de demander à un groupe de personnes que chacune choisisse un mot au hasard, et qu'elle en donne la définition. Chacune ne donnera de son mot que l'acception précise qui lui viendra spontanément en tête, ou aura tout au moins beaucoup de mal, sans l'aide de dictionnaires, à faire le tour des dénotations. Si, au lieu de faire choisir le mot, on en donne un, le résultat sera déjà sensiblement différent.
15 Ou, d'un autre poète : il fut saisi par la passion du verbe, comme d'autres par celle du jeu.
16 Le dire du Poète-Prophète rend manifeste, fait apparaître╔ Cela renvoie à ce que j'écrivais du pinceau de l'archéologue et du pinceau du peintre.
17 Le verbe mallarméen rencontre ici curieusement ce qu'écrit Christian Jambet dans L'Ange à propos de l'Islam ; jusque dans l'assimilation que fait Mallarmé des terroristes anarchistes avec des anges.
18 Sur Wittgenstein, philosophie du langage et poésie (dans Poésie sans réponse), éd. du Seuil 1972.
19 Lire Wittgenstein, dire et montrer, éd. de L'éclat, 1992.
20 Il en est peut-être d'autres que l'on pense « faciles » parce qu'on ne songe même pas à mettre le contact, et qu'on s'en sert un peu comme des trottinettes : Platon, Descartes... On ne suppose pas, chez ces derniers, que la moindre proposition interroge le langage jusqu'à ses fondements. On se contentera de lire chez Platon un « idéalisme » tout indépendant de son énonciation.
21 Personne ne soutiendra qu'il faut en passer par sa propre expérience d'avoir goûté des madeleines pour lire Proust. Ni même que cette expérience pourrait nous apporter quoi que ce soit dans notre lecture. Peut-être doit-on quand même à un moment où à un autre en venir à retrouver dans la langue quelque chose qui nous renvoie à notre propre expérience, mais ce n'est certainement pas ainsi que ce fait un tel renvoi.
22 De la langue et du langage, quel est l'oeuf et quel est la poule ?
TABLE SUITE