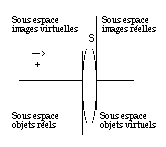Neuvième Cahier
Les « choses » et leur « vertu ». - Qu'est-ce que le travail ? - L'universel et le singulier. - Code génétique ou code générique ? - Nominalisme et langages formels. - Intériorité ou épaisseur.
-------------------------------------------------
Le décodeur, le lecteur de ma mémoire, est le monde lui-même.
Ceci explique en partie pourquoi notre cerveau nous semble tout à la fois si essentiel et si accessoire à la pensée, et dans une moindre mesure à la perception et au mouvement.
Depuis l'antiquité, on a localisé les fonctions du cerveau ; depuis l'antiquité, chaque génération de médecins feint de découvrir le fonctionnement du cerveau. L'utilité de ces découvertes pour expliquer la cognition et la perception est quasiment nulle ; insignifiante, en tout cas, comparée à des approches logiques, sémantiques, sémiotiques...
*
Il est toujours utile de se méfier d'un certain effet du langage qui, en multipliant les termes, semble démultiplier les signifiés.
Nous employons les mots de « chose » et de « réel », de « réalité » ; nous parlons de « choses réelles », de « substances ». Nous disons « la réalité » et nous disons « les réalités ». Nous disons « les choses », et aussi « la chose », « la chose en soi », et même « la choséïté ».
Or « réel » vient déjà d'un néologisme du Latin médiéval : realis, de res, chose. Realis, c'est déjà en Latin « choséïté ». Réel, en Latin se disait déjà verus. Comme en Grec (alétéia), comme en Arabe (haq, haquiqa), le même mot recouvrait le concept de vrai et de réel. Le Latin médiéval a voulu distinguer le « vrai » du « réel » ; l'a distingué dans une référence explicite à la « chose ».
Quant à « vrai » (veritas), il n'est pas nécessaire de si bien posséder le lexique latin pour reconnaître la parenté avec « vertu » (virtus, puissance, de vir, homme, viril). « Vertu », dont notre langue tire « virtuel ».
*
Le 11 novembre
Je dis qu'il y a en nous... des « nous ». Il y a surtout du « je » ... du « jeu »... Il n'est pas du tout évident de dire ce qu'on veut dire : le langage nous joue des tours.
Le jeu sur l'étymologie est l'une des sortes de ces tours. Ces tours, ces tournures sont là, toutes prêtes dans le langage, et tendent à nous arracher la conviction : cela « se dit », se dit bien, cela se dit seul et tend à emporter l'approbation.
L'effet de logique est aussi l'un de ces tours ; l'effet de grammaire.
Heureusement les langues se traduisent. Et la traduction, résistant à la transcription de ces effets de conviction, les filtre. « Gedischte » en Allemand correspond exactement à « poésie » en Français. « Meaning » en Anglais correspond à « intention » et à « signification » en Français. Mais « intention » et « signification » en Français ne sont pas synonymes et n'ont aucune parenté étymologique.
« Être » en Français ne correspond à rien du tout en Arabe, et « laïssat » (n'être pas) en Arabe, ne correspond à rien en Français.
Comment, sans verbe être, Avicenne et Avéroès ont-ils été de si grands commentateurs d'Aristote, et les inspirateurs de l'ontologie scolastique ? Comment penser l'essence (l'être), dans une langue qui n'a pas de verbe être ? Et pourtant leur lecture me laisse croire qu'ils la pensaient mieux.
L'essence : al'ain, la source, et oeil.
Voilà un autre tour de la langue : le trope.
*
Les langues répugnent à la répétition. Un style soutenu la proscrit. Toutes les langues n'ont pas la même exigence à châtier les répétitions, mais toutes, d'une façon ou d'une autre, tendent à les éviter.
Pour quelle bonne raison proscrire les répétitions ? On invoque l'élégance, et leur lourdeur. Pourquoi les répétions alourdiraient-elles le style ? Un style peut bien être lourd sans cela.
A priori, ce serait une question de rythme : tout ce qui revient dans la phrase marque un rythme : rimes, assonances, allitérations, mais aussi structures syntaxiques...
Rythme ou martellement ? La nuance est infime : ou bien ce martellement est fondé, fait fonction de tempo, de ponctuation ; il est un martellement délibéré (marche du sujet). Ou bien il nous échappe, se joue malgré nous, n'est qu'un bruit qui dérange.
En quoi la répétition d'un terme a-t-elle droit à un statut différent de celui de voyelles, de consonnes, de structures syntaxiques, de rythmes ? La poésie et la chanson ne sont-elles pas souvent construites à partir de telles répétitions ?
L'élégance. Que peut bien être l'élégance appliquée au langage ? On dit « élégance de la démonstration » - qu'est-ce que l'élégance d'une démonstration ?
La beauté d'une mélodie, la beauté d'une forme, voilà ce qu'il serait bien dur de définir et d'expliquer. Mais alors, l'élégance, l'élégance du style, ou d'une démonstration, cela semble échapper bien davantage à toute définition.
*
« Quelle élégance! »
Il me semble que élégance désigne toujours un principe d'économie. D'économie, pas d'avarice : un rapport avantageux entre dépense et travail.
Cela suppose une définition du travail qui n'est pas celle de l'économie politique. Une définition qui ne permettrait plus à l'économie politique de parler de « travail improductif ». Dire qu'un travail est improductif, c'est confondre travail et dépense de force.
Quand le rapport est avantageux entre un travail et une dépense, ce qui en est perçu de la manière la plus immédiate et la plus synthétique, on le dit « élégance ».
Le 12 novembre
Ce que j'ai dit hier n'est pas très bien dit. Il me semble que le travail, en physique, n'est pas le rapport dont je parle : il est le produit de la force dépensée et du déplacement produit.
Si l'élégance était la forme visible du travail : l'image du travail ?
Si l'on veut définir l'élégance, on doit expliquer le travail. L'élégance du style : le travail du sens.
*
L'esprit ; le bel esprit - ce dont je parle est autour de quoi ont tourné les grands théoriciens de l'esprit et des lettres de l'époque classique : Vaugelas, Boileau, Guez de Balzac, La Fontaine╔ Ils ont pressenti le travail, mais n'ont vu que l'élégance. Et l'on sent bien, à les lire, qu'une pensée pourtant vive tourne et retourne, danse peut-être, autour d'un point aveugle.
*
Le travail en zoologie. La zoologie et la biologie ne connaissent le travail que d'un point de vue musculaire. C'est pourquoi le travail animal et le travail végétal ne se distinguent pas vraiment. Le travail de la plante qui soulève une pierre n'est en rien différent de celui de l'animal, si ce n'est que le travail de la plante est généralement beaucoup plus puissant.
Mais le travail de la plante n'est pas musculaire. Voilà la grande différence entre la plante et l'animal : le muscle. Et il n'y a pas de muscle sans nerf. On peut toujours étudier le système musculaire et le système nerveux séparément, mais ils ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. C'est à dire qu'il n'y a pas de motricité sans perception, ni de perception sans motricité.
*
Si l'on attelle un âne à une noria, on ne l'utilise pas différemment de la façon dont on utilise le vent ou l'eau pour faire tourner un moulin. On peut aussi bien attacher un homme à une noria.
On observera que le travail humain tend plutôt à utiliser la force mécanique de l'animal de préférence à la sienne, et les forces naturelles de préférence à celle de l'animal (à plus forte raison, de sa propre force animale). C'est à dire, à supprimer du travail musculaire.
*
L'animal, ou même l'homme, attelés à une noria ne font pas un travail différent de celui du vent ou de l'eau, mais cela précisément parce qu'ils sont attelés ; c'est à dire parce que leur travail sensoriel est réduit (artificiellement) à rien. Et peut-être l'âne aura des oeillères.
L'âne, le cheval, l'homme... l'animal, n'était qu'une étape avant d'être remplacés par l'eau, le vent, la vapeur, l'électricité...
*
Pas de travail musculaire sans travail nerveux. Pas question qu'un muscle s'agite si un nerf ne lui transmet une impulsion. Mais un nerf transmet-il une impulsion motrice sans transmettre une impression sensorielle ?
L'arc réflexe. Bien sûr, l'arc réflexe peut couper court dans le système nerveux, mais ce « couper court » n'est jamais qu'un moment dans le fonctionnement complet du système ; et ce système ne se réduit pas à un pur inter-face. (sauf à y être réduit de force dans une noria, un attelage...)
Bref, il n'y a pas de travail des ailes et des serres du faucon sans travail de ses yeux ; et dès qu'on l'encagoule, on arrête les deux.
En cela, la faiblesse du travail musculaire de l'animal, comparé à celui du végétal, est proportionnelle à l'importance de son travail sensoriel.
Il serait peut-être fructueux d'y réfléchir de plus près.
*
Taillant mon chemin à grand coups de serpe, je dirais que le travail du sens est un prolongement du travail des sens : la cognition de la perception. L'achèvement de ce travail serait de rendre sensible (et non plus seulement intelligible) ce sens : l'esthétique.
A ce moment là, il nous arrive de dire, un peu sottement d'ailleurs, « élégance ».
Élégance de la forme, du style, de la démonstration. « Beauté » serait déjà moins sot.
Ou plutôt, la sottise consiste alors à associer la beauté, ou l'élégance, à la seule forme, au seul style, à la seule démonstration.
*
Mais pourquoi la répétition - celle du terme - a-t-elle un statut différent des autres répétitions : de la sonorité, du rythme, de la mélodie, de la rime, de la figure (métaphore, métalepse, métonymie...), du syllogisme (démonstratif, dialectique...), grammaticale, etc...
Du seul point de vue de « la belle langue », de l'élégance du style, son effet peut être, à égalité avec les autres, heureux ou malheureux.
La force de certains poèmes tient, après tout, au retour régulier d'un terme.
*
Le doigt qui montre. La fonction déixique du signe : le « faire signe ».
Les pronoms démonstratifs sont les mots les plus proches du geste (du signe) qui montre, et bien souvent ils l'accompagnent : ceci, cela, celui-ci, ceux-là...
Là, ici, là-bas, là-haut sont encore des mots de cet ordre ; des mots dépourvus de signification si leur référence n'est pas sous les yeux - fût-ce à être la référence à d'autres mots, à d'autres significations que véhiculent des mots ; mais qui doivent être là, sous les yeux, écrits à quelques lignes d'intervalle, désignables du doigt sur la page.
Les termes déixiques constituent le chevillement du langage au réel ; aux choses.
Mais justement, ils sont mis pour la chose ; à sa place. Le problème consiste alors à faire que le doigt qui la montre ne prenne pas la place de la lune. Qu'à trop montrer, le signe ne finisse par cacher.
*
Si le pronom est, par définition, mis pour un nom, le nom est en général mis pour une chose. On peut dire aussi qu'il tient lieu de description d'une chose (1). Généralement, mais pas toujours.
- La vache est dans le pré. - Quelle vache ? - Celle-ci. Cette vache. - Qu'appelles-tu « vache » ? - Eh bien, ceci! (Et je la montre du doigt.)
On peut observer que « vache » n'est pas employé de la même façon dans la troisième et dans la quatrième réplique. Dans la troisième, « vache » pourrait être remplacé par une description : ce gros quadrupède cornu, broutant paisiblement, avec ses lourdes mamelles, aux sabots fendus,... ou encore par un geste, ou par le pronom démonstratif de la cinquième réplique.
Dans la quatrième réplique, le mot « vache » ne désigne que le mot « vache » et sa fonction dans le langage. Le mot « vache » de la quatrième réplique est mis pour le mot « vache » de la troisième.
Mais à la question : « qu'appelles-tu « vache » ? », j'aurais pu répondre autre chose que : « ceci ». J'aurais pu répondre : « j'appelle « vache » un quadrupède cornu, etc╔ » dans ce cas, « vache » n'est plus mis à la place d'une description, mais d'une définition.
« La vache est un ruminant... », est-ce la même que « la vache est dans le pré » ?
La vache qui est dans le pré est bien la vache qui est un mammifère ruminant, mais la vache qui est un mammifère ruminant n'est pas seulement la vache qui est dans le pré.
« La vache n'est pas la vache. »
- La vache est-elle noire ? - Non, la vache qui est dans le pré n'est pas noire, elle est blanche. - Mais la vache qui est un mammifère ruminant, est-elle noire ? - Elle n'est pas nécessairement noire, elle peut être blanche, comme celle qui est dans le pré, ou de nombreuses autres couleurs.
Nous avons là trois usages distincts du nom. Dans une première occurrence il désigne quelque chose de singulier, et pourrait être remplacé par une description ou par un pronom démonstratif. Dans la dernière occurrence, il désigne un universel, et pourrait être remplacé par une définition. Dans l'occurrence intermédiaire, il se désigne lui-même en tant qu'objet et fonction linguistique.
Ces trois usages sont si essentiels et si distincts, qu'on se demande pourquoi aucune grammaire ne les distingue de façon formelle.
*
Si ces trois usages sont si mal distingués par la grammaire, c'est que cette distinction est le travail même du sens dans le langage.
« Qu'appelles-tu « la vache » ? » Au fond, cette question m'interroge sur la fonction d'un mot - fonction au sens quasi algébrique - dans laquelle se rencontrent les coordonnées de l'axe des définitions et de l'axe des descriptions.
Quand je dis « la vache » pour parler de cette vache là, l'usage principalement déixique que je fais du mot n'empêche pas que je me serve du concept de « vache » pour désigner cette vache-ci. Que je le veuille ou non, que je le pense ou non, je mets en relation un « ceci » ici et maintenant avec un pur universel.
Quand je dis « la vache » pour parler de l'espèce de quadrupède ruminant qu'on a pris coutume de nommer ainsi, je ne fais effectivement qu'abstraire les caractère communs de tous les êtres singuliers que je pourrais désigner par ce terme.
Je pourrais avec raison dire que « la vache » n'existe pas (comme Foucault dit que « l'homme n'existe pas »). N'existent que des vaches. Chacune singulière ; unique, mais dotée pourtant des traits communs à toutes les vaches.
Certes, ces traits communs, elles ne les possèdent pas par hasard, mais ce n'est pas la question ici de savoir en vertu de quoi elles les possèdent. La question est seulement de savoir reconnaître ces traits distinctifs dans une ou des vaches particulières. (2)
(Un peu comme, dans l'exemple de Martinet, l'enfant apprend à reconnaître tous les traits communs à l'emploi de [lalãp].)
Le mot, de par sa fonction auto-référentielle de signe linguistique (qu'appelles-tu « vache » ?), fait pivot entre sa fonction déixique (ceci) et sa fonction conceptuelle (un mammifère ruminant).
(Comme la surface optique fait pivot entre l'objet et l'image.)
*
Un peu comme, dans l'exemple de Martinet, l'enfant apprend à reconnaître tous les traits communs à l'emploi de [lalãp].
Ce qu'il importe de bien noter ici, c'est qu'il s'agit moins d'un apprentissage de vocabulaire, de grammaire, de règles en un mot, que d'un apprentissage de choses - comme on dit « leçon de choses » - d'un apprentissage du réel.
(Ni ontologie, ni sémiologie : science, science naturelle - science expérimentale.)
*
Comme la surface optique fait pivot entre l'objet et l'image.
Voilà la clé du statut particulier d'une proscription de la répétition (d'un terme). Elle n'est pas une prescription musicale ; elle est une prescription d'optique.
Varier les termes, c'est changer de focales.
* Le 13 novembre
Connotation et dénotation dans la philosophie et la rhétorique médiévale. La dénotation, c'est la suppositio in recto. La connotation, la supposition in oblico.
La logique et la rhétorique médiévale ont une conception bien définie de l'universel et du singulier. L'universel est du côté du réel ; le singulier en est (comme) une incarnation.
Les essences s'incarnent dans l'existence. On peut reconnaître là une certaine interprétation des « idées » platoniciennes (mais je n'ai pour ma part jamais lu cela dans Platon).
La tentation est grande de faire ici un rapprochement avec la génétique. Si nous pouvons trouver chez toutes les vaches des traits distinctifs, et si nous pouvons observer que toutes les vaches donnent naissance à d'autres vaches qui possèdent ces mêmes signes distinctifs, et naissent elles-mêmes de vaches semblables, n'y aurait il pas comme une « vachéité » qui existerait en toute indépendance de chaque vache - et même de toutes les vaches existantes, ayant existé ou qui existeront -, et dont chaque vache ne serait qu'un manifestation, une réitération ?
Cette notion d'universel n'est pas sans évoquer un code génétique. On pourrait dire « un code générique ».
Le nominalisme et l'empirisme retournent cette conception. Les universel ne sont rien d'autre que des êtres de raison ; des généralisations à partir des caractères communs que l'on trouve dans les singuliers, qui seuls sont réels. Ces êtres de raison sont « dans l'esprit », et nulle part ailleurs.
« Dans l'esprit », cela doit se dire vite car, si l'on s'y arrête, c'est comme si l'on s'arrêtait sur une planche trop fragile pour supporter notre poids.
* Le 14 novembre
Les notions de dénotation et de connotation ont d'abord été appliquées à travers une conception « universaliste » ; c'est à dire qui posait l'essence, ou l'universel, du côté du réel, par opposition à son actualisation, conçue comme une manifestation, une incarnation.
Dans cette conception, le terme dénotatif était celui qui désignait une essence ; la désignait in recto - comme le doigt tendu du maître d'école montrerait un dessin figurant une vache. Le maître d'école alors ne désigne ni un dessin, ni une vache particulière, mais l'idée même de vache : il associe à un nom un universel - un nom qui englobe toutes les manifestations possibles de cet universel.
Parce qu'il est précisément question d'universel, d'essence, il n'est pas utile de distinguer une vache réelle d'une image réelle de vache. Image et objet sont déjà réconciliés dans leur concept : la vache dans le pré, aussi bien que le dessin de la vache, peuvent à titre égal être enveloppées dans le concept universel de « vache ».
Le terme connotatif est celui dont n'est utilisé qu'une facette du concept, pour l'attribuer à une autre essence. Quand je dis « la vache est dans le pré », ce n'est évidemment pas le concept de vache qui est dans le pré - ni la vache dans le concept de pré.
Il suffit que j'assemble ces trois termes : « vache », « pré » et « dans », pour que leurs significations se resserrent.
Si je lis « la vache est dans le pré », je ne sais pas encore s'il est question d'une vache réelle dans un pré réel ou d'une peinture, mais je sais déjà qu'il n'est pas question d'un concept comme si je lisais « la vache est un ruminant ».
Je n'ai besoins ici d'aucun signe grammatical pour faire cette distinction. (Cependant l'Arabe peut la marquer par un changement de genre. Ainsi farassoun (cheval) sera mis au féminin lorsque je parlerai du cheval en général, pour le distinguer du cheval particulier.)
Cette réduction du champ sémantique du terme dans la connotation correspond à un ajustement plus fin au réel - la chose réelle.
S'impose ici l'image de l'objectif que l'on accommode de l'horizon au premier plan.
*
Le réel de la métaphysique scolastique, disons de Thomas d'Aquin à Dun Scott, correspondrait plutôt à
sur les marques de l'objectif.
Pour Guillaume d'Ockham, le bon réglage de l'objectif serait plutôt en sens inverse, sur le gros plan. Ce renversement ne risque-t-il pas d'inverser les définitions de dénotation « in recto » et de connotation « in oblico » ?
*
Nous inversons le mouvement. Nous ne partons plus de l'universel (l'horizon) pour focaliser sur un singulier (gros plan) - en l'occurrence, le concept de vache pour désigner Blanchette dans le pré -, nous partons de l'être-ici pour en induire une essence.
Dans ce cas, les termes les plus dénotatifs - dont la nature les réduirait à une seule fonction dénotative - seraient les démonstratifs, ou encore les noms propres.
*
Il me semble que ce retournement de la métaphysique médiévale devrait conduire à l'élaboration de langages formels : ceux des signes propres aux mathématiques et à la logique moderne. C'est d'ailleurs bien ainsi que les choses se sont passées.
Le langage formel : un langage dépouillé des connotations de la langue naturelle :
*
Chaque pas que je fais dans cette voie soulève des nuages de questions. Balayons-les, regardons sous la poussière des questions.
Sous la poussière, il y a un miroir ; sous toutes ces questions, l'esprit. « Dans l'esprit » : il n'y a peut-être rien de plus « dans l'esprit » que « dans » un miroir.
Il y a seulement des rayons lumineux qui plongent « dans » une surface optique, et des rayons qui émergent hors de celle-ci. « Dans », « hors » ; en Anglais, je ne traduirais pas par « in » et « out » (in put, out put), mais par « into » et « out of ». Il n'y a aucun « dedans » (inside) entre cet « entrer » et ce « sortir » : il n'y a qu'un changement d'orientation.
De part et d'autre il y a du réel, et de part et d'autre il y a du virtuel.
Tout au plus y a-t-il un léger décalage, celui de l'épaisseur de la surface optique, entre les deux paires de sous-ensembles, objets et images.
Mais l'épaisseur du verre est tout aussi réelle que le langage, lui aussi, est réel.
N'y aurait-il pas d'esprit, seulement du langage ?
----------------------------------------------------------------------
NOTES 1 Voir Russell, The Philosophy of Logical Atomism. Russell y parle aussi des démonstratif, ainsi que dans Signification et vérité et problèmes de philosophie.
2 Ensuite seulement on pourra peut-être interroger la biologie, la génétique...
TABLE SUITE